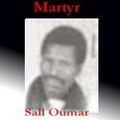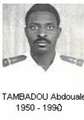Jusque là couverts par une amnistie de fait, les violations des droits de l’homme commises entre 1989-1991 ont fait l’objet d’une loi « no 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie » dont l’article 1er disposait qu’une « amnistie pleine et entière est accordée : 1) aux membres des forces armées et de sécurité auteurs des infractions commises entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992 et relatives aux événements qui se sont déroulés au sein de ces forces et ayant engendré des actions armées et des actes de violence. »
Depuis lors, il est devenu d’usage de faire référence à cette loi pour en regretter l’intervention, expliquer l’impossibilité pour les victimes d’ester en justice ou protester du caractère monolithique du parlement qui l’avait votée, sans, jamais, essayer de la réfuter sur le plan juridique.
Une possibilité de remise en cause de cette loi a semblé se présenter avec la réforme constitutionnelle de 2006 : Une première version du nouvel article 102 supprimait, en effet, l’ancien article 104, mettait en place un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité et imposait l’interprétation des droits fondamentaux des citoyens conformément aux dispositions de la constitution.
Cette version aurait pu permettre aux victimes d’arguer, devant le juge ordinaire, de l’inconstitutionnalité de la loi d’amnistie en raison de sa contrariété manifeste avec les droits et libertés qui leurs sont garantis par la loi fondamentale. La même disposition aurait eu un effet comparable sur un autre dossier : l’affaire des Salafistes, alors pendante devant la justice et dont l’acte d’accusation reposait essentiellement sur une loi de 1963 qui ne pouvait être maintenu que par le truchement de l’article 104.
Il semblerait que c’est en raison de ces virtualités que cette version de l’article 102 a été abandonnée dans l’indifférence générale : l’article 104 fut réintroduit, l’exception de constitutionnalité abandonnée et l’obligation d’interprétation conforme supprimée!
Pourtant, et contrairement à une idée reçue, la loi d’amnistie de 1993 n’est pas valable et nul n’est besoin d’en contrôler la constitutionnalité à cet effet : elle repose sur une conception erronée de la notion même d’amnistie (A) et viole des normes impératives du droit international auxquelles il ne peut être dérogé (B). Elle ne peut, donc, faire obstacle à la recevabilité de plaintes, l’investigation des faits, la poursuite, l’arrestation et la punition des auteurs de ces violations.
A- La loi de 1993 est édictée en méconnaissance de la notion même d’amnistie L’amnistie est définie en doctrine comme étant « l’acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés » ou aussi « la mesure par laquelle le législateur décide de ne pas poursuivre les auteurs de certaines infractions et d’effacer certaines conséquences de celles-ci ».
Cet acte est édicté dans un souci d’apaisement social et de réconciliation et intervient généralement après une période de troubles. Il concerne le plus souvent des infractions dites politiques. Deux caractéristiques se dégagent de cette définition : l’amnistie concerne les crimes passés et non ceux en cours de réalisation (1). Elle doit remplir une fonction sociale en apaisant les esprits et en favorisant la réconciliation (2). Autant de critères qui n’étaient pas remplis par la loi de 1993.
1- Un crime passé, est un crime dont les actes et les effets ont été définitivement consommés. Cela peut, effectivement, s’appliquer aux faits de détentions arbitraires dont les victimes ont été libérées depuis. Toutefois, la majorité des faits visés par cette loi ne sont pas des crimes passés au sens juridique s’agissant de militaires arrêtés par la force publique et dont les familles sont sans nouvelles depuis.
Ces faits sont juridiquement constitutifs de disparitions forcées : une forme d’enlèvement et de séquestration aggravée par la responsabilité de la force publique qui en est l’auteur. Légalement, il s’agit d’un crime continu ou dont les effets se perpétuent dans le temps, jusqu'à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vive. En attendant la réalisation de l’une de ces deux hypothèses, le délai de prescription cesse de courir et toute demande ou décision d'amnistie est considérée comme étant prématurée en raison de l’impossibilité d’établir juridiquement la date à laquelle le crime a été définitivement consommé. La disparition des militaires ayant largement outrepassé la période visée par la loi d’amnistie (avril 1992), il est impossible d'appliquer l'amnistie dans l'affaire en question, le crime étant continu.
2- Loin de remplir la fonction d’apaisement sociale assignée aux mesures amnistiantes, la loi de 1993 use de la notion d’amnistie comme d’une clause de style dans un stratagème destiné à soustraire à la justice les auteurs de certains crimes sans égard pour les droits des victimes. Ce faisant, et contrairement à une règle élémentaire selon laquelle une amnistie ne porte pas atteinte aux droits des tiers, cette loi viole les droits des victimes à l’égalité devant la loi, à l’accès à la justice, à un recours équitable et efficace et à une réparation juste. Son unique objectif est l’aménagement de l’impunité : n’oublions pas qu’elle a été édictée après l’échec des tentatives du régime de faire substituer des simples sanctions disciplinaires aux dispositions du Code pénal, tentatives étouffées dans l’œuf par un avis de la Cour Suprême rendu, sur demande du ministre de la défense, le 15 juillet 1991. Edictée par les auteurs même des crimes voulant s’autoamnistier, cette loi émane d’une autorité qui n’a aucune compétence pour ce faire en vertu d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut être juge de sa propre cause ». Il est constant dans la pratique étatique et la jurisprudence internationale –sur lesquelles nous reviendrons plus loin- que les lois d’autoamnistie n’ont aucune valeur juridique.
Par ailleurs, notre pays a eu l’occasion d’exprimer son acquiescement à cette règle en signant la Déclaration adoptée par la Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme de 1993 et qui dispose (§ 60) : « Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme, telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, conférant ainsi à l’état de droit une base solide ». L’ironie du sort a voulu que le jour même de l’ouverture de cette conférence ait coïncidé avec la promulgation de la loi d’autoamnistie à Nouakchott…c’était le 14 juin 1993. La loi de 1993 use arbitrairement de la notion d’amnistie en en faisant une compétence absolue et sans limites ce qui revient à une conception absurde de la mesure : si l’Etat peut tout amnistier sans égard pour les droits des tiers, sans condition et sans limite, cela reviendrait à lui reconnaître une compétence absolue pour violer les droits de ses citoyens à charge pour lui de s’autoamnistier le lendemain de chaque massacre ! Ces objections faisant sortir la loi de 1993 de la catégorie des amnisties, il convient maintenant de revenir sur la notion même d’amnistie pour en préciser davantage les contours et établir certaines évolutions. Bien que la mesure soit souvent prévue par les Codes pénaux sinon les Constitutions de plusieurs pays, l’amnistie demeure une mesure suspecte qui ne devrait être utilisée –et n’est effectivement utilisée dans les Etats de droit- qu’en des circonstances exceptionnelles. Cette suspicion provient, d’abord, du déni de mémoire impliqué par cette mesure. Venant du grec mnestia qui veut dire souvenir, auquel est ajouté le a- privatif, l’amnistie veut dire, littéralement, interdiction de se souvenir ou obligation d’oublier.
L’article 2 de la loi de 1993 ne fait qu’expliciter cette acception en disposant : « toute plainte, tout procès-verbal ou tout document d’enquête relatifs à cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie, sera classé sans suite ». Historiquement, le caractère ‘’amnésique’’ de la mesure est au cœur même de sa définition. On en trouve une description assez évocatrice dans le traité d’Osnabrück dont l’article 2 dispose : « (…) que toutes les rigueurs, violences, hostilités et défenses qui ont été faites et causées de part et d’autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole ou par écrit, sans aucun égard aux personnes et aux choses soient entièrement abolies : si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prétendre de l’autre à ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli ». Pour être laconique sur ce point, l’édit de Nantes n’en est pas moins systématique quand il stipule que la mémoire des troubles liée aux guerres demeure « éteinte et assoupie comme chose non advenue » !
Le droit à la vérité et le devoir de mémoire s’accommodent mal de cette amnésie. La mesure est, ensuite, suspecte en ce qu’elle remet en cause des principes fondamentaux de l’Etat de droit comme l’égalité devant la loi, la nécessité des peines, la protection de l’ordre public et la séparation des pouvoirs : en édictant une loi d’amnistie, quand bien même cela serait parfaitement constitutionnel, le Parlement ne s’immisce-t-il pas dans le champs de compétence du pouvoir judiciaire en l’empêchant de juger certains faits délictueux ? La mesure est, enfin, suspecte en ce que, contrairement à toutes les autres mesures de clémence – comme la grâce ou la prescription pour ne pas parler des remises des peines et des libérations conditionnelles- l’amnistie, par son caractère anonyme, automatique, visant à la fois le crime et son auteur, ouvre la porte à une impunité qui ne devrait être accordée qu’avec une grande parcimonie. C’est ainsi que de nos jours, le recours à l’amnistie tend à être une spécialité des sociétés en transition ou post-conflictuelles.
Dans les démocraties dites stables ou apaisées, cette mesure est, soit inexistante, soit soumise à des conditions strictes et tend à disparaître dans la pratique : les droits norvégien et espagnol -dans une moindre mesure pour ce dernier- ne connaissent pas l’amnistie. Dans les autres démocraties européennes, bien que prévue par les textes, son usage est soumis à des conditions strictes dégagées par la jurisprudence constitutionnelle. Dans la pratique, après avoir quitté le champ du politique pour ne concerner que des amnisties dites fiscales, immobilière ou pour faire partie des instruments de gestion du surpeuplement carcéral ( !), elle tend tout simplement à disparaître : en France, par exemple, le nouveau Président de la République a mis fin à une pratique qualifiée pourtant de « tradition de la République » et consistant à amnistier certaines infractions mineures au lendemain de chaque élection présidentielle.
L’abandon progressif de cette mesure ne s’explique pas seulement pas la stabilité de ces démocraties mais également par les développements les plus récents du droit international ayant abouti à l’érosion de la compétence exclusive de l’Etat en la matière. Ainsi, dans les années 1970 l’exigence de l’amnistie en faveur des prisonniers politiques était un thème mobilisateur pour les organisations de défense des droits de l’Homme et les oppositions démocratiques. La mesure était ainsi un symbole de liberté et ses défenseurs pouvaient même se réclamer d’une prestigieuse tradition initiée par un sénateur français dénommé…Victor Hugo se battant pour l’amnistie des condamnés de la Commune dans des discours passés à la postérité comme une belle œuvre littéraire où il exigeait « la solution vraie, l'amnistie totale, générale, sans réserve, sans condition, sans restriction, l'amnistie pleine et entière », et encourageait la Haute Assemblée à prononcer ce « mot profond qui constate à la fois la défaillance de tous et la magnanimité de tous ».
Dans les années 1980, avec la floraison des lois d’autoamnistie édictées par des dictateurs soucieux d’organiser leur propre impunité ou de préparer leur retraite, l’amnistie devient synonyme d’arbitraire. Elle occupera dans les années 1990 une part importante des débats suscités par les transitions démocratiques et les processus de retour à la paix pour chercher un équilibre entre la quête de l’impunité par l’ancien oppresseur et l’aspiration des victimes à la justice. Cette évolution a permis la cristallisation d’une règle selon laquelle si l’Etat est fondé à amnistier des infractions à son propre ordre public, il ne peut amnistier des infractions aux normes impératives de droit international qui ressortent de l’ordre public international et pour la sanction desquelles chaque Etat détient un titre de compétence et un intérêt pour agir. B- La loi de 1993 est contraire aux normes impératives de droit international La loi de 1993 n’est pas valable en ce qu’elle entend couvrir des infractions à des normes impératives de droit international (1).
La nullité de ce type d’amnistie est confirmée par un corpus juridique impressionnant, une pratique étatique généralisée et une jurisprudence internationale constante (2).
1- Les normes impératives de droit international La loi de 1993 entend couvrir des faits de torture, de disparitions forcées, et d’exécutions extrajudiciaires. Ces faits sont des infractions à des normes impératives de droit international. Une norme impérative de droit international est « une norme acceptée, et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise » comme la définit l’art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces normes, dites aussi Jus Cogens et souvent désignées comme des ‘’règles non dérogeables’’ ou ‘’intransgressibles’’, sont des règles coutumières jugées fondamentales par la communauté internationale qui leur accorde une suprématie absolue sur toutes les autres règles et dont chaque Etat est réputé avoir un intérêt à ce qu’elles soient respectées. L’interdiction de la torture, des exécutions extrajudiciaires ou des disparitions forcées –objet de la loi de 1993- sont les exemples typiques des normes impératives de droit international. Le contenu de cette interdiction ne se limite pas à une obligation de s’abstenir de commettre des tels actes, mais englobe, au-delà, l’obligation de les prévenir et, en cas de commission, d’enquêter, de poursuivre les auteurs, de les juger et de les punir.
Ces normes engagent l’Etat en tant que tel, et de ce fait, s’imposent à tous ses organes et démembrements. Aussi, un Etat ne peut se prévaloir de l’acte de l’un de ses organes internes pour se soustraire à ses obligations. Au regard du droit international, les actes des organes de l’Etat – une loi votée par son parlement par exemple, une décision de ses juridictions ou un acte de son administration- sont des faits de celui-ci. Si par leurs actes, ces organes dérogent à des normes impératives du droit international, c’est l’Etat qui viole ces normes. En laissant des agents de la force publique commettre des crimes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, l’Etat a violé la norme impérative mettant à sa charge le devoir de prévenir des tels crimes. En édictant une loi d’amnistie, il a, de nouveau, violé la même norme impérative qui lui impose, également, d’enquêter sur les faits, de poursuivre, de juger et de punir les auteurs.
2- Une obligation largement étayée D’abord, sur le plan normatif, les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme mettent à la charge de l’Etat le devoir de sanctionner les violations graves des droits de l’Homme et/ou prévoient leur imprescriptibilité : c’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de 1984 contre la torture, deux instruments ratifiés par notre pays même si l’adhésion du pays à l’instrument conventionnel importe peu s’agissant de normes impératives par définition coutumières et s’imposant à tous. La pratique de l’organisation mondiale, dans sa mise en œuvre du contenu de ces instruments, révèle le passage d’une conception selon laquelle les lois d’amnistie étaient garantes du retour à la paix à une conception selon laquelle ces mêmes lois constitueraient une menace à la paix. Cette attitude se reflète à travers la création des tribunaux pénaux internationaux, le nombre impressionnant des résolutions contre l’impunité adoptées aussi bien par l’Assemblée Générale que par le Conseil de Sécurité, et la position de l’organisation, désormais constante dans les accords de paix conclus sous ses auspices ou avec sa participation, selon laquelle aucune loi d’amnistie ne devrait être garantie aux auteurs des violations les plus graves des droits de l’homme.
Le comité des droits de l’Homme des Nations Unies –dont les décisions sont quasi-judiciaires- considère que « L'amnistie, (…) est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir ». Ensuite, il est remarquable dans la pratique des Etats que les pays qui avaient adopté des législations d’autoamnistie ont pris l’initiative d’abroger lesdites lois comme l’a fait l’Argentine en 2003, et comme est train de le faire le Chili actuellement. Egalement, la majorité des accords de paix conclus depuis 1990, ainsi que des législations d’amnistie adoptées, excluent l’impunité des crimes internationaux les plus graves : on peut se reporter aux accords de Dayton de 1996, à plusieurs accords de paix conclus en Amérique latine ou aux lois d’amnistie adoptées dans le cadre des transitions démocratiques des pays de l’Europe de l’Est mais, pour rester en Afrique, citons les accords de Lina Marcoussis du 24 janvier 2003 (chapitre VI de l’annexe, para 3.), l’accord de cessez-le-feu en RDC du 10 juillet 1999 (Annexe A chapitre 9, para 1-a), l’accord Sierra Léone-ONU créant le Tribunal Spécial pour Sierra Léone en 2002, et l’accord de paix du 9 novembre 2004 sur le Darfour (Préambule§ 7 et art. 2 (8)).
Le rejet de l’amnistie pour les infractions aux normes impératives repose, également, sur une vérification empirique de l’inefficacité de la transaction, rarement vérifiée en dehors du monde abstrait de la logique formelle, selon laquelle certains pays ont renoncé à la justice pour obtenir la paix. Là où des mesures d’amnistie ont été édictées pour favoriser la paix à la justice, il n’y a eu ni la paix, ni la justice : à deux reprises (1999, 2006), l’Algérie a offert l’amnistie aux terroristes islamistes, la violence y sévit toujours. En 2001, la Côté d’Ivoire a offert l’amnistie pour favoriser la paix, quelques mois plus tard la rébellion militaire éclata.
La République Centre Africaine édicta deux lois d’amnistie, au nom de la même équation, le 15 mars 2003, le général Boazizé prend le pouvoir réclamant ‘’justice pour le peuple’’ dit-il. Le gouvernement Sierra Léonais signa des accords de paix à Lomé avec le RUF, en 1999, leur garantissant une amnistie pleine et entière, quelques semaines plus tard, la guerre reprit de plus belle. L’Ouganda est désormais abonné aux mesures d’amnistie, la sixième amnistie est actuellement ‘’proposée’’ aux rebelles et rien ne dit qu’elle garantira le retour à la paix dans ce pays. En revanche, les poursuites lancées par la CPI contre le chef de l’Armée de Résistance du Seigneur, Joseph Kony, semble le rendre plus conciliant ! Enfin, une jurisprudence quasi-constante, aussi bien nationale, régionale qu’internationale, établit la nullité des lois amnistiant des crimes internationaux comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées et ce, en raison de leur contrariété aux normes impératives du droit international.
La Cour Interaméricaine des droits de l’Homme était la première à initier cette jurisprudence : d’abord, dans sa décision Velasquez Rodriguez de 1988 (contre le Honduras) la Cour a jugé que « L’Etat a l’obligation juridique de prévenir, (…) les violations des droits de l’Homme, d’enquêter sérieusement (…) sur les violations qui auraient été commises sous sa juridiction afin d’identifier les responsables, de leur imposer les sanctions adéquates et d’assurer aux victimes une réparation adaptée ». A cet effet, elle met en avant « l’obligation d’organiser l’appareil étatique de manière à ce que les droits reconnus (…) soient (effectivement) garantis » ce qui implique, notamment, l’obligation de la justice d’enquêter, de juger et de sanctionner et pour que cela soit possible, l’obligation du Parlement de ne pas l’en empêcher en édictant une loi d’amnistie par exemple.
Cette position de principe sera appliquée dans des affaires où les Etats arguaient de législations amnistiantes pour empêcher les victimes de faire valoir leurs droits devant la justice. Ainsi, dans le jugement Barrios Altos de 2001 (contre le Pérou), la Cour « considère que les dispositions d’amnistie, de prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des auteurs) sont inadmissibles car elles tendent à empêcher l’enquête sur les faits et la sanction des auteurs des violations graves des droits de l’homme comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, autant de crimes interdits car violant des droits non dérogeables reconnus par le droit international des droits de l’Homme », de ce fait, « lesdites lois n’ont pas d’effet juridique et ne peuvent continuer à faire obstacle à l’enquête sur les faits ni à l’identification et à la sanction des responsables ».
Cette jurisprudence sera réitérée dans l’affaire des sœurs Serrano contre El Salvador en 2005 où, bien que l’amnistie salvadorienne n’ait pas été invoquée par le juge interne, la Cour a tenu à rappeler que le pays « doit s’abstenir d’avoir recours à des mesures comme l’amnistie, la prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des auteurs) comme des mesures qui prétendent empêcher la répression pénale ou supprimer les effets des décisions condamnatoires ». Plus récemment encore, dans une affaire Almonacid contre le Chili (2006), la Cour a réaffirmé que « les Etats ne peuvent se soustraire à leur obligation d’enquêter, d’identifier et de sanctionner les auteurs des crimes de lèse-humanité en appliquant des lois d’amnistie ou d’autres mesures normatives internes, les crimes de lèse-Humanité sont des crimes non amnistiables ».
D’autres juridictions, aussi bien nationales qu’internationales ont mis en œuvre la notion des normes impératives de droit international pour écarter l’application des lois d’amnistie des violations les plus graves des droits de l’Homme. Deux exemples américains illustrent l’attitude du juge interne : au Chili, la doctrine dominante au sein de la Cour Suprême a fait obstacle à l’annulation de l’amnistie pour inconstitutionnalité. Toutefois, la même Cour a exclu son application, dans un premier temps, pour les crimes de disparitions forcées en raison de leur caractère continu, et dans un second temps, elle a écarté son application pour les crimes de torture et d’exécutions extrajudiciaires en se basant sur la notion des normes impératives de droit international. Aussi, le décret-loi d’amnistie n’a jamais été invoquée par les tribunaux nationaux depuis 1998 ce qui a permis la condamnation de plus de 300 auteurs d’infractions aux normes jus cogens et abouti à la levée de l’immunité du Général Pinochet lui-même le 3 octobre 2006.
Lors de l’affaire Almonacid, le gouvernement chilien a déclaré, que « les lois d’amnistie ou d’autoamnistie sont contraires aux normes internationales des droits de l’homme » et qu’il ne leur reconnaissait « aucune valeur, ni éthique, ni juridique ». Déterminé à abroger cette loi, le gouvernement chilien ne dispose pas, cependant, de la majorité politique nécessaire à cet effet au sein du Sénat. En attendant, il apporte son soutien à une proposition de loi actuellement en discussion tendant à abroger l’amnistie. Plus audacieux que le juge chilien, le juge argentin, lui, a annulé purement et simplement les lois dites du « point final » et du « devoir d’obéissance » promulguées respectivement en 1986 et en 1987 : bien que validée par la Cour Suprême en 1987, des juges fédéraux ont commencé, à partir de 2001, à remettre en cause cette validité pour contrariété aux normes impératives du droit international.
La Cour Suprême devait s’exprimer à nouveau sur le sujet dans une décision du 14 juin 2005 relative à des faits de torture, de détention arbitraire et de disparitions forcées. Face à l’argument de la défense invoquant les lois d’amnistie, la Cour a indiqué que « La sanction de ce genre de crimes provient directement (…) de l’ordre impératif international », et a déclaré « sans effet juridique aucun les lois (d’amnistie) ainsi que tout autre acte fondé sur elles et qui pourrait faire obstacle à la progression des procédures en cours ou au jugement et à l’éventuelle condamnation des responsables ». Dans le continent africain, la première occasion donnée à une Cour Constitutionnelle de s’exprimer sur des mesures amnistiant des violations graves des droits de l’Homme fut une occasion manquée pour le droit international.
En effet, saisie par l’Azanian People’s Organisation qui contestait la validité de la loi de la Promotion de l’Unité Nationale et de la Réconciliation créant la Commission Vérité et Réconciliation et l’autorisant à accorder des amnisties pour des violations graves des droits de l’Homme, la Cour a confirmé la constitutionnalité de ces amnisties en indiquant qu’elles étaient prévues par la Constitution intérimaire sans tirer aucune conclusion des précédents américains qu’elle a, pourtant, évoqués et sans examiner l’émergence d’une norme impérative internationale interdisant ce genre d’amnistie. Son argumentaire était plus politique que juridique en invoquant l’impossibilité de connaître la vérité si les auteurs couraient le risque de se voir condamner et en mettant en avant la nécessité de ménager les forces armées et de sécurité dont les membres pouvaient, s’ils étaient menacés, empêcher la transition vers une société démocratique.
Toutefois, et comme le rappelle la Cour dans sa décision, les amnisties accordées par la Commission Vérité et Réconciliation ne relèvent pas de l’amnistie classique : elles sont accordées selon une procédure quasi-judiciaire par une formation composée majoritairement de juges ; elles sont conditionnées par l’aveu complet et circonstancié des faits lors d’audiences publiques; les faits doivent être justifiés par un motif politique ; les victimes, en plus de la vérité, ont droit à des réparations ; des poursuites judiciaires demeurent possibles si la demande d’amnistie est rejetée par le Comité ou si l’auteur présumé ne se présente pas devant celui-ci ; et elles font partie d’un ensemble de mesures visant à construire l’unité nationale et prévenir la répétition de ces violations. En raison de l’ensemble de ces éléments, mais aussi de la particularité de la situation ayant prévalu dans ce pays, le cas sud-africain demeure un cas sui generis et ne saurait constituer un précédent juridique. C’est d’ailleurs ce que confirmeront les décisions ultérieures des juridictions internationales.
Ainsi, dans l’affaire Furundzjia, le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé, en 1998, qu’ « il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires ». Plus récemment, le Tribunal Spécial pour le Sierra Léone a refusé, en 2004, de donner effet à des lois d’amnistie en raison de leur contrariété aux normes impératives de droit international : les défendeurs, deux anciens du RUF, avaient argué du fait que l’article IX des accords de Lomé de 1999 prévoyait une amnistie pleine et entière pour les combattants. Le Tribunal refusa de donner effet à cette clause en arguant du fait que « la protection de la dignité humaine est une norme impérative et a acquis la qualité d’obligation valable à l’égard de tous » et que « l’octroi d’amnistie pour des tels crimes (…) est une violation de l’obligation de l’Etat à l’égard de l’ensemble de la communauté internationale ».
Il ressort, donc, des instruments conventionnels, de la pratique étatique et de la jurisprudence internationale, que les mesures d’amnistie pour des infractions aux normes impératives de droit international –comme la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées- n’ont aucune valeur juridique. La loi de 1993 qui se distingue de toutes les mesures amnistiantes contestées plus haut par son caractère inconditionnel et sa négation radicale des droits des victimes, est en violation flagrante des normes impératives du droit international et n’est donc pas valable. Concrètement, cela implique que tout juge mauritanien, saisi par les victimes ou leurs ayants droit et appliquant correctement les normes pertinentes, pourrait écarter cette loi, ouvrir une enquête, poursuivre et punir les auteurs. Il serait d’ailleurs intéressant que des victimes portent l’affaire, aujourd’hui, devant la justice nationale.
Cette invalidité implique également que, loin d’empêcher les juridictions étrangères agissant sur la base de leur compétence universelle de se saisir de l’affaire, cette loi constitue un indice significatif du manque de volonté persistant des autorités nationales de rendre justice aux victimes. En effet, bien que les juridictions étrangères n’aient pas à apprécier la validité de la loi mauritanienne, n’ayant à appliquer que leurs propres lois, elles peuvent, dans certaines circonstances, donner effet à une amnistie en s’abstenant de mettre en mouvement l’action publique en vertu de leur compétence d’apprécier l’opportunité des poursuites et l’intérêt de la justice. Il s’agit donc d’une loi sans effet juridique, nuisible pour l’image du pays, insultante pour le peuple mauritanien et pour la mémoire des victimes. Sa nullité inhérente interdit qu’elle puisse être validée ex post facto par des mesures de réparation quelconques. Aussi, doit-elle être abrogée sans autre forme de procès étant l’exemple même de la loi inutile.
L’auteur de ‘’De l’esprit des lois’’ l’avait indiqué depuis longtemps : « ne faites pas de lois inutiles, elles affaiblissent celles nécessaires ». Incidemment, et à propos de lois inutiles, il serait également absurde d’édicter une autre amnistie, aujourd’hui demandée par certains mauritaniens exilés, pour ‘’marquer’’ leur retour, sans qu’ils ne se soient rendu coupables de faits délictueux ! Les lois de la République ont un contenu normatif. Elles ne s’édictent pas pour satisfaire l’ego des individus. « Juger ou ne pas juger… » ? Au-delà de l’invalidité de l’amnistie de 1993, se pose une autre question, plus politique que juridique, sur l’opportunité et les chances réelles de pouvoir juger les auteurs de ces crimes. D’aucuns, penseraient qu’en jugeant les auteurs de tels crimes on s’attaquerait à l’institution militaire qu’il serait plus sage de ménager justement pour affermir et consolider la démocratie. Mais à cette ‘’prudence pour la démocratie’’ s’oppose deux objections : l’une de principe, l’autre factuelle.
D’abord en capitulant devant l’armée, on lui reconnaîtrait un droit de veto sur la vie politique et sur le fonctionnement de la justice et ce faisant on en renforcerait l’emprise sur la vie nationale. Ceci alors même que l’affirmation de la démocratie et de l’Etat de droit pourrait nécessiter une certaine rigueur face à l’impunité, justement, pour rendre le règne de la loi crédible : laisser impunies les violations les plus graves, reviendrait à les tolérer, voire à les endosser, situation qui ne favorise guère la ‘’consolidation de l’acquis démocratique’’ et dont l’autorité de la loi ne peut que pâtir. Ensuite, il reste à établir que ces faits ont été commis par l’institution militaire dans son ensemble. Si les militaires sud-africains pouvaient se réfugier derrière la politique officielle de l’Etat, si les militaires argentins pensaient mener une guerre contre le terrorisme, les actes commis en Mauritanie ne relevaient pas de la politique officielle de l’Etat ni ne correspondaient à la vocation de l’armée.
Ils sont le fait de quelques officiers zélés qui ont transformé leurs unités en milices politiques et en escadrons de la mort. Aussi doivent-ils en répondre individuellement. Les laisser se réfugier derrière l’institution militaire, c’est insulter les Forces Armées Nationales en leur faisant porter la responsabilité de fait dont elles étaient également victimes. Les militaires argentins qui avaient imposé les lois d’amnistie n’ont fait que reporter leur jugement tout comme leurs collègues chiliens. Les militaires mauritaniens responsables de ces faits ont l’occasion d’apurer à jamais ce dossier en assumant leurs responsabilités dans un climat de réconciliation qui ne peut que leur être favorable.
Une autre objection consisterait à soutenir qu’en mettant à la charge des Etats l’obligation ‘’impérative’’ de sanctionner ces violations, le droit international mettrait les jeunes démocraties, comme la nôtre, devant un choix cornélien entre leur propre survie et le respect de leurs principes fondateurs conduisant à l’autodestruction ou au suicide de la démocratie. En réalité, le droit international n’impose pas aux Etats l’obligation d’entreprendre des procès systématiques sans fin contre tous les auteurs de toutes les violations. Il s’agit plus simplement de poursuivre les auteurs principaux des violations les plus graves pour affirmer l’autorité de la loi et la fin de l’impunité. Par ailleurs, il reconnaît qu’en des situations particulières, un Etat peut apporter des restrictions limitées aux garanties des droits de l’Homme notamment en invoquant les doctrine de ‘’l’état de nécessité’’ ou de la ‘’force majeure’’. Toutefois, ces doctrines ne sont pas valables s’agissant des normes impératives.
L’émergence d’une doctrine de ‘’l’état de transition’’ autorisant, non pas des restrictions, mais des dérogations provisoires pour favoriser la mise en place progressive de l’Etat de droit n’en est qu’aux balbutiements. Mais rien n’interdit à la Mauritanie de faire preuve d’imagination et de créativité en élaborant une solution propre à répondre à ses besoins. Encore faut-il que cette solution favorise la fin de l’impunité et préserve les droits des victimes. On ne sait que peu de choses sur la formule qui sera adoptée par nos autorités pour gérer cette affaire, mais la déclaration selon laquelle elles ‘’négocieraient avec les victimes ou leurs ayants-droit afin de leurs offrir des compensations ‘’ s’apparente davantage à une tentative de subornation.
Le fait de payer des compensations aux victimes n’absout pas de l’obligation d’enquêter et de poursuivre. Et tout en acceptant les compensations financières, les victimes demeurent fondées à poursuivre leurs bourreaux devant la justice nationale ou les juridictions étrangères si l’occasion leur en est donnée : dans l’affaire Almonacid citée plus haut, la veuve de la victime ainsi que ses deux enfants bénéficiaient déjà d’une pension mensuelle, d’une sécurité sociale et de bourses d’études pour les enfants, cela n’a pas absout l’Etat de son obligation de juger et de punir. Il revient à la Mauritanie de trouver la meilleure voie d’accomplir ses obligations tout en maintenant la paix civile, les options peuvent aller de procédures pénales stricto sensu à la dérogation à la loi ordinaire par une loi hiérarchiquement supérieure consacrée à la justice et à la réconciliation nationale et prévoyant des sanctions civiles, administratives et disciplinaires pour les auteurs principaux du crime.
Pour les faits non constitutifs d’infractions aux normes impératives, la compétence de l’Etat pour amnistier ou gracier demeure intacte, encore faut-il que cela se passe via une procédure qui garantit le droit du peuple mauritanien à la vérité, qui permet d’empêcher la reproduction des faits dans l’avenir et qui préserve le droit des victimes à une juste réparation. C’est dans cette perspective que les formules dites ‘’vérité et réconciliation’’ prennent leur sens en complétant le travail judiciaire et non en s’y substituant.
Omar Ould Dedde Ould Hamady
source : cridem
Depuis lors, il est devenu d’usage de faire référence à cette loi pour en regretter l’intervention, expliquer l’impossibilité pour les victimes d’ester en justice ou protester du caractère monolithique du parlement qui l’avait votée, sans, jamais, essayer de la réfuter sur le plan juridique.
Une possibilité de remise en cause de cette loi a semblé se présenter avec la réforme constitutionnelle de 2006 : Une première version du nouvel article 102 supprimait, en effet, l’ancien article 104, mettait en place un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité et imposait l’interprétation des droits fondamentaux des citoyens conformément aux dispositions de la constitution.
Cette version aurait pu permettre aux victimes d’arguer, devant le juge ordinaire, de l’inconstitutionnalité de la loi d’amnistie en raison de sa contrariété manifeste avec les droits et libertés qui leurs sont garantis par la loi fondamentale. La même disposition aurait eu un effet comparable sur un autre dossier : l’affaire des Salafistes, alors pendante devant la justice et dont l’acte d’accusation reposait essentiellement sur une loi de 1963 qui ne pouvait être maintenu que par le truchement de l’article 104.
Il semblerait que c’est en raison de ces virtualités que cette version de l’article 102 a été abandonnée dans l’indifférence générale : l’article 104 fut réintroduit, l’exception de constitutionnalité abandonnée et l’obligation d’interprétation conforme supprimée!
Pourtant, et contrairement à une idée reçue, la loi d’amnistie de 1993 n’est pas valable et nul n’est besoin d’en contrôler la constitutionnalité à cet effet : elle repose sur une conception erronée de la notion même d’amnistie (A) et viole des normes impératives du droit international auxquelles il ne peut être dérogé (B). Elle ne peut, donc, faire obstacle à la recevabilité de plaintes, l’investigation des faits, la poursuite, l’arrestation et la punition des auteurs de ces violations.
A- La loi de 1993 est édictée en méconnaissance de la notion même d’amnistie L’amnistie est définie en doctrine comme étant « l’acte du pouvoir souverain immunisant des personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés » ou aussi « la mesure par laquelle le législateur décide de ne pas poursuivre les auteurs de certaines infractions et d’effacer certaines conséquences de celles-ci ».
Cet acte est édicté dans un souci d’apaisement social et de réconciliation et intervient généralement après une période de troubles. Il concerne le plus souvent des infractions dites politiques. Deux caractéristiques se dégagent de cette définition : l’amnistie concerne les crimes passés et non ceux en cours de réalisation (1). Elle doit remplir une fonction sociale en apaisant les esprits et en favorisant la réconciliation (2). Autant de critères qui n’étaient pas remplis par la loi de 1993.
1- Un crime passé, est un crime dont les actes et les effets ont été définitivement consommés. Cela peut, effectivement, s’appliquer aux faits de détentions arbitraires dont les victimes ont été libérées depuis. Toutefois, la majorité des faits visés par cette loi ne sont pas des crimes passés au sens juridique s’agissant de militaires arrêtés par la force publique et dont les familles sont sans nouvelles depuis.
Ces faits sont juridiquement constitutifs de disparitions forcées : une forme d’enlèvement et de séquestration aggravée par la responsabilité de la force publique qui en est l’auteur. Légalement, il s’agit d’un crime continu ou dont les effets se perpétuent dans le temps, jusqu'à ce que la victime soit retrouvée, morte ou vive. En attendant la réalisation de l’une de ces deux hypothèses, le délai de prescription cesse de courir et toute demande ou décision d'amnistie est considérée comme étant prématurée en raison de l’impossibilité d’établir juridiquement la date à laquelle le crime a été définitivement consommé. La disparition des militaires ayant largement outrepassé la période visée par la loi d’amnistie (avril 1992), il est impossible d'appliquer l'amnistie dans l'affaire en question, le crime étant continu.
2- Loin de remplir la fonction d’apaisement sociale assignée aux mesures amnistiantes, la loi de 1993 use de la notion d’amnistie comme d’une clause de style dans un stratagème destiné à soustraire à la justice les auteurs de certains crimes sans égard pour les droits des victimes. Ce faisant, et contrairement à une règle élémentaire selon laquelle une amnistie ne porte pas atteinte aux droits des tiers, cette loi viole les droits des victimes à l’égalité devant la loi, à l’accès à la justice, à un recours équitable et efficace et à une réparation juste. Son unique objectif est l’aménagement de l’impunité : n’oublions pas qu’elle a été édictée après l’échec des tentatives du régime de faire substituer des simples sanctions disciplinaires aux dispositions du Code pénal, tentatives étouffées dans l’œuf par un avis de la Cour Suprême rendu, sur demande du ministre de la défense, le 15 juillet 1991. Edictée par les auteurs même des crimes voulant s’autoamnistier, cette loi émane d’une autorité qui n’a aucune compétence pour ce faire en vertu d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut être juge de sa propre cause ». Il est constant dans la pratique étatique et la jurisprudence internationale –sur lesquelles nous reviendrons plus loin- que les lois d’autoamnistie n’ont aucune valeur juridique.
Par ailleurs, notre pays a eu l’occasion d’exprimer son acquiescement à cette règle en signant la Déclaration adoptée par la Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme de 1993 et qui dispose (§ 60) : « Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l’homme, telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, conférant ainsi à l’état de droit une base solide ». L’ironie du sort a voulu que le jour même de l’ouverture de cette conférence ait coïncidé avec la promulgation de la loi d’autoamnistie à Nouakchott…c’était le 14 juin 1993. La loi de 1993 use arbitrairement de la notion d’amnistie en en faisant une compétence absolue et sans limites ce qui revient à une conception absurde de la mesure : si l’Etat peut tout amnistier sans égard pour les droits des tiers, sans condition et sans limite, cela reviendrait à lui reconnaître une compétence absolue pour violer les droits de ses citoyens à charge pour lui de s’autoamnistier le lendemain de chaque massacre ! Ces objections faisant sortir la loi de 1993 de la catégorie des amnisties, il convient maintenant de revenir sur la notion même d’amnistie pour en préciser davantage les contours et établir certaines évolutions. Bien que la mesure soit souvent prévue par les Codes pénaux sinon les Constitutions de plusieurs pays, l’amnistie demeure une mesure suspecte qui ne devrait être utilisée –et n’est effectivement utilisée dans les Etats de droit- qu’en des circonstances exceptionnelles. Cette suspicion provient, d’abord, du déni de mémoire impliqué par cette mesure. Venant du grec mnestia qui veut dire souvenir, auquel est ajouté le a- privatif, l’amnistie veut dire, littéralement, interdiction de se souvenir ou obligation d’oublier.
L’article 2 de la loi de 1993 ne fait qu’expliciter cette acception en disposant : « toute plainte, tout procès-verbal ou tout document d’enquête relatifs à cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie, sera classé sans suite ». Historiquement, le caractère ‘’amnésique’’ de la mesure est au cœur même de sa définition. On en trouve une description assez évocatrice dans le traité d’Osnabrück dont l’article 2 dispose : « (…) que toutes les rigueurs, violences, hostilités et défenses qui ont été faites et causées de part et d’autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole ou par écrit, sans aucun égard aux personnes et aux choses soient entièrement abolies : si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prétendre de l’autre à ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli ». Pour être laconique sur ce point, l’édit de Nantes n’en est pas moins systématique quand il stipule que la mémoire des troubles liée aux guerres demeure « éteinte et assoupie comme chose non advenue » !
Le droit à la vérité et le devoir de mémoire s’accommodent mal de cette amnésie. La mesure est, ensuite, suspecte en ce qu’elle remet en cause des principes fondamentaux de l’Etat de droit comme l’égalité devant la loi, la nécessité des peines, la protection de l’ordre public et la séparation des pouvoirs : en édictant une loi d’amnistie, quand bien même cela serait parfaitement constitutionnel, le Parlement ne s’immisce-t-il pas dans le champs de compétence du pouvoir judiciaire en l’empêchant de juger certains faits délictueux ? La mesure est, enfin, suspecte en ce que, contrairement à toutes les autres mesures de clémence – comme la grâce ou la prescription pour ne pas parler des remises des peines et des libérations conditionnelles- l’amnistie, par son caractère anonyme, automatique, visant à la fois le crime et son auteur, ouvre la porte à une impunité qui ne devrait être accordée qu’avec une grande parcimonie. C’est ainsi que de nos jours, le recours à l’amnistie tend à être une spécialité des sociétés en transition ou post-conflictuelles.
Dans les démocraties dites stables ou apaisées, cette mesure est, soit inexistante, soit soumise à des conditions strictes et tend à disparaître dans la pratique : les droits norvégien et espagnol -dans une moindre mesure pour ce dernier- ne connaissent pas l’amnistie. Dans les autres démocraties européennes, bien que prévue par les textes, son usage est soumis à des conditions strictes dégagées par la jurisprudence constitutionnelle. Dans la pratique, après avoir quitté le champ du politique pour ne concerner que des amnisties dites fiscales, immobilière ou pour faire partie des instruments de gestion du surpeuplement carcéral ( !), elle tend tout simplement à disparaître : en France, par exemple, le nouveau Président de la République a mis fin à une pratique qualifiée pourtant de « tradition de la République » et consistant à amnistier certaines infractions mineures au lendemain de chaque élection présidentielle.
L’abandon progressif de cette mesure ne s’explique pas seulement pas la stabilité de ces démocraties mais également par les développements les plus récents du droit international ayant abouti à l’érosion de la compétence exclusive de l’Etat en la matière. Ainsi, dans les années 1970 l’exigence de l’amnistie en faveur des prisonniers politiques était un thème mobilisateur pour les organisations de défense des droits de l’Homme et les oppositions démocratiques. La mesure était ainsi un symbole de liberté et ses défenseurs pouvaient même se réclamer d’une prestigieuse tradition initiée par un sénateur français dénommé…Victor Hugo se battant pour l’amnistie des condamnés de la Commune dans des discours passés à la postérité comme une belle œuvre littéraire où il exigeait « la solution vraie, l'amnistie totale, générale, sans réserve, sans condition, sans restriction, l'amnistie pleine et entière », et encourageait la Haute Assemblée à prononcer ce « mot profond qui constate à la fois la défaillance de tous et la magnanimité de tous ».
Dans les années 1980, avec la floraison des lois d’autoamnistie édictées par des dictateurs soucieux d’organiser leur propre impunité ou de préparer leur retraite, l’amnistie devient synonyme d’arbitraire. Elle occupera dans les années 1990 une part importante des débats suscités par les transitions démocratiques et les processus de retour à la paix pour chercher un équilibre entre la quête de l’impunité par l’ancien oppresseur et l’aspiration des victimes à la justice. Cette évolution a permis la cristallisation d’une règle selon laquelle si l’Etat est fondé à amnistier des infractions à son propre ordre public, il ne peut amnistier des infractions aux normes impératives de droit international qui ressortent de l’ordre public international et pour la sanction desquelles chaque Etat détient un titre de compétence et un intérêt pour agir. B- La loi de 1993 est contraire aux normes impératives de droit international La loi de 1993 n’est pas valable en ce qu’elle entend couvrir des infractions à des normes impératives de droit international (1).
La nullité de ce type d’amnistie est confirmée par un corpus juridique impressionnant, une pratique étatique généralisée et une jurisprudence internationale constante (2).
1- Les normes impératives de droit international La loi de 1993 entend couvrir des faits de torture, de disparitions forcées, et d’exécutions extrajudiciaires. Ces faits sont des infractions à des normes impératives de droit international. Une norme impérative de droit international est « une norme acceptée, et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise » comme la définit l’art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces normes, dites aussi Jus Cogens et souvent désignées comme des ‘’règles non dérogeables’’ ou ‘’intransgressibles’’, sont des règles coutumières jugées fondamentales par la communauté internationale qui leur accorde une suprématie absolue sur toutes les autres règles et dont chaque Etat est réputé avoir un intérêt à ce qu’elles soient respectées. L’interdiction de la torture, des exécutions extrajudiciaires ou des disparitions forcées –objet de la loi de 1993- sont les exemples typiques des normes impératives de droit international. Le contenu de cette interdiction ne se limite pas à une obligation de s’abstenir de commettre des tels actes, mais englobe, au-delà, l’obligation de les prévenir et, en cas de commission, d’enquêter, de poursuivre les auteurs, de les juger et de les punir.
Ces normes engagent l’Etat en tant que tel, et de ce fait, s’imposent à tous ses organes et démembrements. Aussi, un Etat ne peut se prévaloir de l’acte de l’un de ses organes internes pour se soustraire à ses obligations. Au regard du droit international, les actes des organes de l’Etat – une loi votée par son parlement par exemple, une décision de ses juridictions ou un acte de son administration- sont des faits de celui-ci. Si par leurs actes, ces organes dérogent à des normes impératives du droit international, c’est l’Etat qui viole ces normes. En laissant des agents de la force publique commettre des crimes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, l’Etat a violé la norme impérative mettant à sa charge le devoir de prévenir des tels crimes. En édictant une loi d’amnistie, il a, de nouveau, violé la même norme impérative qui lui impose, également, d’enquêter sur les faits, de poursuivre, de juger et de punir les auteurs.
2- Une obligation largement étayée D’abord, sur le plan normatif, les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme mettent à la charge de l’Etat le devoir de sanctionner les violations graves des droits de l’Homme et/ou prévoient leur imprescriptibilité : c’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de 1984 contre la torture, deux instruments ratifiés par notre pays même si l’adhésion du pays à l’instrument conventionnel importe peu s’agissant de normes impératives par définition coutumières et s’imposant à tous. La pratique de l’organisation mondiale, dans sa mise en œuvre du contenu de ces instruments, révèle le passage d’une conception selon laquelle les lois d’amnistie étaient garantes du retour à la paix à une conception selon laquelle ces mêmes lois constitueraient une menace à la paix. Cette attitude se reflète à travers la création des tribunaux pénaux internationaux, le nombre impressionnant des résolutions contre l’impunité adoptées aussi bien par l’Assemblée Générale que par le Conseil de Sécurité, et la position de l’organisation, désormais constante dans les accords de paix conclus sous ses auspices ou avec sa participation, selon laquelle aucune loi d’amnistie ne devrait être garantie aux auteurs des violations les plus graves des droits de l’homme.
Le comité des droits de l’Homme des Nations Unies –dont les décisions sont quasi-judiciaires- considère que « L'amnistie, (…) est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir ». Ensuite, il est remarquable dans la pratique des Etats que les pays qui avaient adopté des législations d’autoamnistie ont pris l’initiative d’abroger lesdites lois comme l’a fait l’Argentine en 2003, et comme est train de le faire le Chili actuellement. Egalement, la majorité des accords de paix conclus depuis 1990, ainsi que des législations d’amnistie adoptées, excluent l’impunité des crimes internationaux les plus graves : on peut se reporter aux accords de Dayton de 1996, à plusieurs accords de paix conclus en Amérique latine ou aux lois d’amnistie adoptées dans le cadre des transitions démocratiques des pays de l’Europe de l’Est mais, pour rester en Afrique, citons les accords de Lina Marcoussis du 24 janvier 2003 (chapitre VI de l’annexe, para 3.), l’accord de cessez-le-feu en RDC du 10 juillet 1999 (Annexe A chapitre 9, para 1-a), l’accord Sierra Léone-ONU créant le Tribunal Spécial pour Sierra Léone en 2002, et l’accord de paix du 9 novembre 2004 sur le Darfour (Préambule§ 7 et art. 2 (8)).
Le rejet de l’amnistie pour les infractions aux normes impératives repose, également, sur une vérification empirique de l’inefficacité de la transaction, rarement vérifiée en dehors du monde abstrait de la logique formelle, selon laquelle certains pays ont renoncé à la justice pour obtenir la paix. Là où des mesures d’amnistie ont été édictées pour favoriser la paix à la justice, il n’y a eu ni la paix, ni la justice : à deux reprises (1999, 2006), l’Algérie a offert l’amnistie aux terroristes islamistes, la violence y sévit toujours. En 2001, la Côté d’Ivoire a offert l’amnistie pour favoriser la paix, quelques mois plus tard la rébellion militaire éclata.
La République Centre Africaine édicta deux lois d’amnistie, au nom de la même équation, le 15 mars 2003, le général Boazizé prend le pouvoir réclamant ‘’justice pour le peuple’’ dit-il. Le gouvernement Sierra Léonais signa des accords de paix à Lomé avec le RUF, en 1999, leur garantissant une amnistie pleine et entière, quelques semaines plus tard, la guerre reprit de plus belle. L’Ouganda est désormais abonné aux mesures d’amnistie, la sixième amnistie est actuellement ‘’proposée’’ aux rebelles et rien ne dit qu’elle garantira le retour à la paix dans ce pays. En revanche, les poursuites lancées par la CPI contre le chef de l’Armée de Résistance du Seigneur, Joseph Kony, semble le rendre plus conciliant ! Enfin, une jurisprudence quasi-constante, aussi bien nationale, régionale qu’internationale, établit la nullité des lois amnistiant des crimes internationaux comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées et ce, en raison de leur contrariété aux normes impératives du droit international.
La Cour Interaméricaine des droits de l’Homme était la première à initier cette jurisprudence : d’abord, dans sa décision Velasquez Rodriguez de 1988 (contre le Honduras) la Cour a jugé que « L’Etat a l’obligation juridique de prévenir, (…) les violations des droits de l’Homme, d’enquêter sérieusement (…) sur les violations qui auraient été commises sous sa juridiction afin d’identifier les responsables, de leur imposer les sanctions adéquates et d’assurer aux victimes une réparation adaptée ». A cet effet, elle met en avant « l’obligation d’organiser l’appareil étatique de manière à ce que les droits reconnus (…) soient (effectivement) garantis » ce qui implique, notamment, l’obligation de la justice d’enquêter, de juger et de sanctionner et pour que cela soit possible, l’obligation du Parlement de ne pas l’en empêcher en édictant une loi d’amnistie par exemple.
Cette position de principe sera appliquée dans des affaires où les Etats arguaient de législations amnistiantes pour empêcher les victimes de faire valoir leurs droits devant la justice. Ainsi, dans le jugement Barrios Altos de 2001 (contre le Pérou), la Cour « considère que les dispositions d’amnistie, de prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des auteurs) sont inadmissibles car elles tendent à empêcher l’enquête sur les faits et la sanction des auteurs des violations graves des droits de l’homme comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, autant de crimes interdits car violant des droits non dérogeables reconnus par le droit international des droits de l’Homme », de ce fait, « lesdites lois n’ont pas d’effet juridique et ne peuvent continuer à faire obstacle à l’enquête sur les faits ni à l’identification et à la sanction des responsables ».
Cette jurisprudence sera réitérée dans l’affaire des sœurs Serrano contre El Salvador en 2005 où, bien que l’amnistie salvadorienne n’ait pas été invoquée par le juge interne, la Cour a tenu à rappeler que le pays « doit s’abstenir d’avoir recours à des mesures comme l’amnistie, la prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des auteurs) comme des mesures qui prétendent empêcher la répression pénale ou supprimer les effets des décisions condamnatoires ». Plus récemment encore, dans une affaire Almonacid contre le Chili (2006), la Cour a réaffirmé que « les Etats ne peuvent se soustraire à leur obligation d’enquêter, d’identifier et de sanctionner les auteurs des crimes de lèse-humanité en appliquant des lois d’amnistie ou d’autres mesures normatives internes, les crimes de lèse-Humanité sont des crimes non amnistiables ».
D’autres juridictions, aussi bien nationales qu’internationales ont mis en œuvre la notion des normes impératives de droit international pour écarter l’application des lois d’amnistie des violations les plus graves des droits de l’Homme. Deux exemples américains illustrent l’attitude du juge interne : au Chili, la doctrine dominante au sein de la Cour Suprême a fait obstacle à l’annulation de l’amnistie pour inconstitutionnalité. Toutefois, la même Cour a exclu son application, dans un premier temps, pour les crimes de disparitions forcées en raison de leur caractère continu, et dans un second temps, elle a écarté son application pour les crimes de torture et d’exécutions extrajudiciaires en se basant sur la notion des normes impératives de droit international. Aussi, le décret-loi d’amnistie n’a jamais été invoquée par les tribunaux nationaux depuis 1998 ce qui a permis la condamnation de plus de 300 auteurs d’infractions aux normes jus cogens et abouti à la levée de l’immunité du Général Pinochet lui-même le 3 octobre 2006.
Lors de l’affaire Almonacid, le gouvernement chilien a déclaré, que « les lois d’amnistie ou d’autoamnistie sont contraires aux normes internationales des droits de l’homme » et qu’il ne leur reconnaissait « aucune valeur, ni éthique, ni juridique ». Déterminé à abroger cette loi, le gouvernement chilien ne dispose pas, cependant, de la majorité politique nécessaire à cet effet au sein du Sénat. En attendant, il apporte son soutien à une proposition de loi actuellement en discussion tendant à abroger l’amnistie. Plus audacieux que le juge chilien, le juge argentin, lui, a annulé purement et simplement les lois dites du « point final » et du « devoir d’obéissance » promulguées respectivement en 1986 et en 1987 : bien que validée par la Cour Suprême en 1987, des juges fédéraux ont commencé, à partir de 2001, à remettre en cause cette validité pour contrariété aux normes impératives du droit international.
La Cour Suprême devait s’exprimer à nouveau sur le sujet dans une décision du 14 juin 2005 relative à des faits de torture, de détention arbitraire et de disparitions forcées. Face à l’argument de la défense invoquant les lois d’amnistie, la Cour a indiqué que « La sanction de ce genre de crimes provient directement (…) de l’ordre impératif international », et a déclaré « sans effet juridique aucun les lois (d’amnistie) ainsi que tout autre acte fondé sur elles et qui pourrait faire obstacle à la progression des procédures en cours ou au jugement et à l’éventuelle condamnation des responsables ». Dans le continent africain, la première occasion donnée à une Cour Constitutionnelle de s’exprimer sur des mesures amnistiant des violations graves des droits de l’Homme fut une occasion manquée pour le droit international.
En effet, saisie par l’Azanian People’s Organisation qui contestait la validité de la loi de la Promotion de l’Unité Nationale et de la Réconciliation créant la Commission Vérité et Réconciliation et l’autorisant à accorder des amnisties pour des violations graves des droits de l’Homme, la Cour a confirmé la constitutionnalité de ces amnisties en indiquant qu’elles étaient prévues par la Constitution intérimaire sans tirer aucune conclusion des précédents américains qu’elle a, pourtant, évoqués et sans examiner l’émergence d’une norme impérative internationale interdisant ce genre d’amnistie. Son argumentaire était plus politique que juridique en invoquant l’impossibilité de connaître la vérité si les auteurs couraient le risque de se voir condamner et en mettant en avant la nécessité de ménager les forces armées et de sécurité dont les membres pouvaient, s’ils étaient menacés, empêcher la transition vers une société démocratique.
Toutefois, et comme le rappelle la Cour dans sa décision, les amnisties accordées par la Commission Vérité et Réconciliation ne relèvent pas de l’amnistie classique : elles sont accordées selon une procédure quasi-judiciaire par une formation composée majoritairement de juges ; elles sont conditionnées par l’aveu complet et circonstancié des faits lors d’audiences publiques; les faits doivent être justifiés par un motif politique ; les victimes, en plus de la vérité, ont droit à des réparations ; des poursuites judiciaires demeurent possibles si la demande d’amnistie est rejetée par le Comité ou si l’auteur présumé ne se présente pas devant celui-ci ; et elles font partie d’un ensemble de mesures visant à construire l’unité nationale et prévenir la répétition de ces violations. En raison de l’ensemble de ces éléments, mais aussi de la particularité de la situation ayant prévalu dans ce pays, le cas sud-africain demeure un cas sui generis et ne saurait constituer un précédent juridique. C’est d’ailleurs ce que confirmeront les décisions ultérieures des juridictions internationales.
Ainsi, dans l’affaire Furundzjia, le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé, en 1998, qu’ « il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires ». Plus récemment, le Tribunal Spécial pour le Sierra Léone a refusé, en 2004, de donner effet à des lois d’amnistie en raison de leur contrariété aux normes impératives de droit international : les défendeurs, deux anciens du RUF, avaient argué du fait que l’article IX des accords de Lomé de 1999 prévoyait une amnistie pleine et entière pour les combattants. Le Tribunal refusa de donner effet à cette clause en arguant du fait que « la protection de la dignité humaine est une norme impérative et a acquis la qualité d’obligation valable à l’égard de tous » et que « l’octroi d’amnistie pour des tels crimes (…) est une violation de l’obligation de l’Etat à l’égard de l’ensemble de la communauté internationale ».
Il ressort, donc, des instruments conventionnels, de la pratique étatique et de la jurisprudence internationale, que les mesures d’amnistie pour des infractions aux normes impératives de droit international –comme la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées- n’ont aucune valeur juridique. La loi de 1993 qui se distingue de toutes les mesures amnistiantes contestées plus haut par son caractère inconditionnel et sa négation radicale des droits des victimes, est en violation flagrante des normes impératives du droit international et n’est donc pas valable. Concrètement, cela implique que tout juge mauritanien, saisi par les victimes ou leurs ayants droit et appliquant correctement les normes pertinentes, pourrait écarter cette loi, ouvrir une enquête, poursuivre et punir les auteurs. Il serait d’ailleurs intéressant que des victimes portent l’affaire, aujourd’hui, devant la justice nationale.
Cette invalidité implique également que, loin d’empêcher les juridictions étrangères agissant sur la base de leur compétence universelle de se saisir de l’affaire, cette loi constitue un indice significatif du manque de volonté persistant des autorités nationales de rendre justice aux victimes. En effet, bien que les juridictions étrangères n’aient pas à apprécier la validité de la loi mauritanienne, n’ayant à appliquer que leurs propres lois, elles peuvent, dans certaines circonstances, donner effet à une amnistie en s’abstenant de mettre en mouvement l’action publique en vertu de leur compétence d’apprécier l’opportunité des poursuites et l’intérêt de la justice. Il s’agit donc d’une loi sans effet juridique, nuisible pour l’image du pays, insultante pour le peuple mauritanien et pour la mémoire des victimes. Sa nullité inhérente interdit qu’elle puisse être validée ex post facto par des mesures de réparation quelconques. Aussi, doit-elle être abrogée sans autre forme de procès étant l’exemple même de la loi inutile.
L’auteur de ‘’De l’esprit des lois’’ l’avait indiqué depuis longtemps : « ne faites pas de lois inutiles, elles affaiblissent celles nécessaires ». Incidemment, et à propos de lois inutiles, il serait également absurde d’édicter une autre amnistie, aujourd’hui demandée par certains mauritaniens exilés, pour ‘’marquer’’ leur retour, sans qu’ils ne se soient rendu coupables de faits délictueux ! Les lois de la République ont un contenu normatif. Elles ne s’édictent pas pour satisfaire l’ego des individus. « Juger ou ne pas juger… » ? Au-delà de l’invalidité de l’amnistie de 1993, se pose une autre question, plus politique que juridique, sur l’opportunité et les chances réelles de pouvoir juger les auteurs de ces crimes. D’aucuns, penseraient qu’en jugeant les auteurs de tels crimes on s’attaquerait à l’institution militaire qu’il serait plus sage de ménager justement pour affermir et consolider la démocratie. Mais à cette ‘’prudence pour la démocratie’’ s’oppose deux objections : l’une de principe, l’autre factuelle.
D’abord en capitulant devant l’armée, on lui reconnaîtrait un droit de veto sur la vie politique et sur le fonctionnement de la justice et ce faisant on en renforcerait l’emprise sur la vie nationale. Ceci alors même que l’affirmation de la démocratie et de l’Etat de droit pourrait nécessiter une certaine rigueur face à l’impunité, justement, pour rendre le règne de la loi crédible : laisser impunies les violations les plus graves, reviendrait à les tolérer, voire à les endosser, situation qui ne favorise guère la ‘’consolidation de l’acquis démocratique’’ et dont l’autorité de la loi ne peut que pâtir. Ensuite, il reste à établir que ces faits ont été commis par l’institution militaire dans son ensemble. Si les militaires sud-africains pouvaient se réfugier derrière la politique officielle de l’Etat, si les militaires argentins pensaient mener une guerre contre le terrorisme, les actes commis en Mauritanie ne relevaient pas de la politique officielle de l’Etat ni ne correspondaient à la vocation de l’armée.
Ils sont le fait de quelques officiers zélés qui ont transformé leurs unités en milices politiques et en escadrons de la mort. Aussi doivent-ils en répondre individuellement. Les laisser se réfugier derrière l’institution militaire, c’est insulter les Forces Armées Nationales en leur faisant porter la responsabilité de fait dont elles étaient également victimes. Les militaires argentins qui avaient imposé les lois d’amnistie n’ont fait que reporter leur jugement tout comme leurs collègues chiliens. Les militaires mauritaniens responsables de ces faits ont l’occasion d’apurer à jamais ce dossier en assumant leurs responsabilités dans un climat de réconciliation qui ne peut que leur être favorable.
Une autre objection consisterait à soutenir qu’en mettant à la charge des Etats l’obligation ‘’impérative’’ de sanctionner ces violations, le droit international mettrait les jeunes démocraties, comme la nôtre, devant un choix cornélien entre leur propre survie et le respect de leurs principes fondateurs conduisant à l’autodestruction ou au suicide de la démocratie. En réalité, le droit international n’impose pas aux Etats l’obligation d’entreprendre des procès systématiques sans fin contre tous les auteurs de toutes les violations. Il s’agit plus simplement de poursuivre les auteurs principaux des violations les plus graves pour affirmer l’autorité de la loi et la fin de l’impunité. Par ailleurs, il reconnaît qu’en des situations particulières, un Etat peut apporter des restrictions limitées aux garanties des droits de l’Homme notamment en invoquant les doctrine de ‘’l’état de nécessité’’ ou de la ‘’force majeure’’. Toutefois, ces doctrines ne sont pas valables s’agissant des normes impératives.
L’émergence d’une doctrine de ‘’l’état de transition’’ autorisant, non pas des restrictions, mais des dérogations provisoires pour favoriser la mise en place progressive de l’Etat de droit n’en est qu’aux balbutiements. Mais rien n’interdit à la Mauritanie de faire preuve d’imagination et de créativité en élaborant une solution propre à répondre à ses besoins. Encore faut-il que cette solution favorise la fin de l’impunité et préserve les droits des victimes. On ne sait que peu de choses sur la formule qui sera adoptée par nos autorités pour gérer cette affaire, mais la déclaration selon laquelle elles ‘’négocieraient avec les victimes ou leurs ayants-droit afin de leurs offrir des compensations ‘’ s’apparente davantage à une tentative de subornation.
Le fait de payer des compensations aux victimes n’absout pas de l’obligation d’enquêter et de poursuivre. Et tout en acceptant les compensations financières, les victimes demeurent fondées à poursuivre leurs bourreaux devant la justice nationale ou les juridictions étrangères si l’occasion leur en est donnée : dans l’affaire Almonacid citée plus haut, la veuve de la victime ainsi que ses deux enfants bénéficiaient déjà d’une pension mensuelle, d’une sécurité sociale et de bourses d’études pour les enfants, cela n’a pas absout l’Etat de son obligation de juger et de punir. Il revient à la Mauritanie de trouver la meilleure voie d’accomplir ses obligations tout en maintenant la paix civile, les options peuvent aller de procédures pénales stricto sensu à la dérogation à la loi ordinaire par une loi hiérarchiquement supérieure consacrée à la justice et à la réconciliation nationale et prévoyant des sanctions civiles, administratives et disciplinaires pour les auteurs principaux du crime.
Pour les faits non constitutifs d’infractions aux normes impératives, la compétence de l’Etat pour amnistier ou gracier demeure intacte, encore faut-il que cela se passe via une procédure qui garantit le droit du peuple mauritanien à la vérité, qui permet d’empêcher la reproduction des faits dans l’avenir et qui préserve le droit des victimes à une juste réparation. C’est dans cette perspective que les formules dites ‘’vérité et réconciliation’’ prennent leur sens en complétant le travail judiciaire et non en s’y substituant.
Omar Ould Dedde Ould Hamady
source : cridem
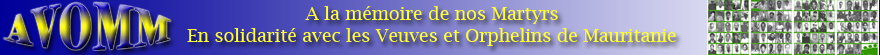
 Actualités
Actualités



















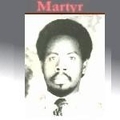
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)