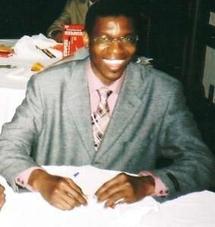
1. La faiblesse de l'opposition. Pas besoin de s'attarder sur ce point. C'est une opposition faible et en ordre dispersée qui est allée à cette échéance dont il est vrai que l'issue était connue d'avance. Pendant que l’opposition se battait pour des détails de forme, le Général poursuivait un travail de fonds visant à assurer sa victoire et à la faire accepter de la communauté internationale. Sa visite en France au lendemain de la suspension de la campagne pour l’élection du 6 juin et en pleine négociation n’avait d’autres objectifs que la recherche de garanties d’acceptation de sa victoire. En contre partie de quoi, il cèdera les porte feuilles clés (Intérieur, Défense, Finances) du gouvernement d’union nationale fantoche. Que peut faire un ministre de l’intérieur de deux semaines, sinon constater la défaite de son candidat et annoncer la victoire de son adversaire. L’exercice n’est pas difficile, mais ne doit pas être agréable. Point besoin d'être analyste pour comprendre que le général candidat gagnerait dès le premier : j'avais annoncé, plus d’une semaine avant le scrutin, le score du général au dixième près, à des faiseurs d'opinion qui planchaient sur d'hypothétiques combinaisons dans la perspective du second tour, qu’ils voyaient sans lui. N'est-ce pas un rêve.
2. L'altération du discours identitaire. Plusieurs facteurs concourent à le rendre totalement inopérant.
D'abord, un pan de notre peuple ne le porte pas. C'est douloureux, mais c'est la dure réalité. Telle que conduite, du moins sur le plan national, cette lutte apparaît, pour les soninké du Guidimakha, comme une lutte des peuls, qui ne les concerne que faiblement, voire pas du tout. Alors que pour la conquête du pouvoir au niveau local, la fibre identitaire est plus présente ici qu'ailleurs en Mauritanie. Dès lors, il n'est pas étonnant de constater leur émergence sur la scène politique nationale à mesure que s'affirme ou s'exacerbe cette lutte identitaire. D'ailleurs, ils se prêtent, consciemment certainement, à le faire échouer, s'attribuant une fonction peu gratifiante de faiseur de roi. Leur rôle, pas à eux seulement, dans le maintien et le renforcement du régime de Ould TAYA est à cet égard très édifiant. Plus récemment, à l'occasion de la présidentielle du 18 juin, j'étais stupéfait de constater à partir du bureau de vote où je me trouvais, de voir tel représentant de candidat revendiquer la voix de tel votant dès son identité -aux consonances guidimakhanké- déclinée. Le spectacle était pitoyable et renvoyait à une double réalité, toute triste : un simple rôle de faiseur de roi dévolu à l’immigré soninké, une place peu enviable pour les siens dans l'échiquier politique national, qu’il a largement contribué à forger et maintenir.
Ensuite, un second pan perçoit la réalité (les noirs sont marginalisés), mais en accepte moins la justification intellectuelle (mais ils ne sont pas pour des raisons purement politiques). Ce contingent peuple les partis dits traditionnellement attachés à l'unité nationale, MND hier, UFP aujourd'hui. Ils se révéleront être ses pires ennemis, notamment aux sombres moments de l'histoire récente de notre pays. S'y ajoutent ceux qui, au nom d'un progressisme nébuleux (MDI, Conscience et Résistance), s'emploient à dévoyer le sujet, préférant évoquer à chaque fois le déficit démocratique qui explique selon eux tous les maux de notre pays.
Puis un troisième ensemble préfère l'évacuer au profit d'une notion, celle de la citoyenneté, en apparence neutre, en réalité que les politiques successives dont ils sont largement comptables ont connotée, façonnée. Messaoud Ould Boulkheïr est de ceux là. Il a fait de la lutte contre l'esclavage, combat noble s'il en est, son cheval de bataille, depuis El Hor jusqu'à APP. Il n'a ménagé pour cela rien ni personne, s'attaquant vigoureusement aux grandes aristocraties noires du Sud, qui ont tendance il est vrai à l’esclavage, comme si celles-ci étaient responsables de son sort, non pas « d'esclave de la Nation » qu'il est devenu, mais « d'esclave de tente » qu'il fut. Pourtant, il demeure profondément attaché à son arabité, héritage indélébile de sa condition, et plus généralement à l’arabité de la Mauritanie. Si attaché, qu'il se dit, comme Ahmed Ould Daddah, pas favorable à la révision de la constitution qui consacre le caractère arabe de la Nation. Plus récemment encore, c'est-à-dire à l'occasion de la campagne, il s'engage à criminaliser (je me demande comment, surtout quant ils réussissent) les coups d'état, phénomènes conjoncturels, lourds de conséquence certes, mais tout de même imprévisibles. Alors qu'il ne dit mot du racisme qui gangrène notre société. Il peut bien faire valoir ses qualités de citoyen aux mépris de la couleur de sa peau, mais peut il pour cela et sans démagogie évacuer une question aussi essentielle.
Enfin, un dernier facteur et non des moindres, l’incapacité des tenants du discours identitaire, en particulier les FLAM et dans une certaine mesure AJD/MR, à le faire évoluer et l’adapter aux mutations, récentes mais notoires, de notre société. Les idéologies basées sur les courants du panarabisme Bassiste et Nassérien se sont essoufflées. En tout cas, elles inspirent peu la jeune classe des politiques arabes qui gravitent autour du pouvoir. Ceux-ci aspirent au pouvoir pour le pouvoir et évidement les avantages qu’ils pensent que celui-ci procure : richesse, prestige.
La persistance de ces facteurs et l'instrumentalisation concomitante ou non par les régimes font du combat identitaire un combat vain. Pour que les questions que cette lutte pose ne restent pas des propos incantatoires simples, il faut inventer une autre méthode, ouvrir une autre porte d’entrée, emprunter un autre langage soutenu par un ton plus audible. Il serait à rechercher du côté de la citoyenneté, de l’intégration, de la cohésion sociale
3. Un besoin impérieux de renouvellement de la classe politique. Depuis 1992 et la pseudo démocratisation, la classe politique mauritanienne est quasiment la même. L'opposition intérieure n'a jamais pu ou su réaliser l'alternance, faute de proposer un projet de société fiable lui permettant de constituer une alternative crédible aux régimes en place. Mieux, elle a plus brillé par des conflits d'intérêts en son sein, que par la définition et la mise en application d'une stratégie réelle de conquête de pouvoir. La première vraie tentative de ce genre remonte au scrutin présidentiel de mars 2007. Elle s'est terminée dans les conditions que chacun sait. En dépit de tous les engagements pris au sein de la CFCD, Messaoud Ould Boulkheïr a préféré aller à la soupe plutôt que de favoriser l'arrivée au pouvoir d'une opposition qui craignait l'installation d'un candidat des militaires. Alors quand je vois le débat qui a circulé à la veille et l'avant-veille dans un certain cercle sur la personnalité de cet homme, - passé au gré des jeux de mots de personnage légendaire (héros) au statut d'officier chargé de transmettre les messages de guerre (héraut), deux mots au sens littéralement opposé- je m'interroge s'il s'agit bien du même.
Au delà de ce fait presque anecdotique, se pose, de mon point de vue, l'absolue nécessité de renouvellement d'une classe politique marquée par des décennies d'affairisme, de corruption à grande échelle, de détournement de deniers publics, de combines, de mauvaise gestion et j'en passe. Tous ceux qui ont animé l'épisode TAYA ne doivent plus bénéficier de la confiance de notre peuple, tant ils se sont distingués par leur propension à se servir de l’Etat plutôt que le servir. Tout comme certains de ceux qui avaient constitué l 'opposition légale. Au premier chef desquels Ahmed Ould Daddah, épuisé et noyé par des ambitions personnelles démesurées, et qui ne tire aucune leçon du passé. Qui s’obstine, il y a peu encore, à l'occasion d'un meeting politique « à ne pas vouloir juger le passé », oubliant qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire court le risque de la voir se répéter. Les déportations ont eu lieu il y a vingt ans. Le retour des déportés se poursuit encore. Peut on faire comme si de rien n’était.
Il est donc venu le temps de laisser la place à une nouvelle race d'hommes et de femmes, intellectuellement mieux outillés et politiquement plus affûtés quoique plus jeunes, mais surtout propres comme Mohamed Jemil Mansour, comme KANE Hamidou Baba, comme certainement d’autres aussi, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Avec eux, une campagne électorale ne sera plus une question de tribu, de village ou d’ethnie, encore moins une simple affaire d’argent, acquis je ne sais comment, servant à acheter des voix de populations pauvres et ignorantes plus que des consciences, mais bien une confrontation d’idées et de programme mettant le développement de la Mauritanie au centre de leurs préoccupations.
Boubacar DIAGANA
Coordinateur du comité de soutien du candidat KHB
Source: hk
2. L'altération du discours identitaire. Plusieurs facteurs concourent à le rendre totalement inopérant.
D'abord, un pan de notre peuple ne le porte pas. C'est douloureux, mais c'est la dure réalité. Telle que conduite, du moins sur le plan national, cette lutte apparaît, pour les soninké du Guidimakha, comme une lutte des peuls, qui ne les concerne que faiblement, voire pas du tout. Alors que pour la conquête du pouvoir au niveau local, la fibre identitaire est plus présente ici qu'ailleurs en Mauritanie. Dès lors, il n'est pas étonnant de constater leur émergence sur la scène politique nationale à mesure que s'affirme ou s'exacerbe cette lutte identitaire. D'ailleurs, ils se prêtent, consciemment certainement, à le faire échouer, s'attribuant une fonction peu gratifiante de faiseur de roi. Leur rôle, pas à eux seulement, dans le maintien et le renforcement du régime de Ould TAYA est à cet égard très édifiant. Plus récemment, à l'occasion de la présidentielle du 18 juin, j'étais stupéfait de constater à partir du bureau de vote où je me trouvais, de voir tel représentant de candidat revendiquer la voix de tel votant dès son identité -aux consonances guidimakhanké- déclinée. Le spectacle était pitoyable et renvoyait à une double réalité, toute triste : un simple rôle de faiseur de roi dévolu à l’immigré soninké, une place peu enviable pour les siens dans l'échiquier politique national, qu’il a largement contribué à forger et maintenir.
Ensuite, un second pan perçoit la réalité (les noirs sont marginalisés), mais en accepte moins la justification intellectuelle (mais ils ne sont pas pour des raisons purement politiques). Ce contingent peuple les partis dits traditionnellement attachés à l'unité nationale, MND hier, UFP aujourd'hui. Ils se révéleront être ses pires ennemis, notamment aux sombres moments de l'histoire récente de notre pays. S'y ajoutent ceux qui, au nom d'un progressisme nébuleux (MDI, Conscience et Résistance), s'emploient à dévoyer le sujet, préférant évoquer à chaque fois le déficit démocratique qui explique selon eux tous les maux de notre pays.
Puis un troisième ensemble préfère l'évacuer au profit d'une notion, celle de la citoyenneté, en apparence neutre, en réalité que les politiques successives dont ils sont largement comptables ont connotée, façonnée. Messaoud Ould Boulkheïr est de ceux là. Il a fait de la lutte contre l'esclavage, combat noble s'il en est, son cheval de bataille, depuis El Hor jusqu'à APP. Il n'a ménagé pour cela rien ni personne, s'attaquant vigoureusement aux grandes aristocraties noires du Sud, qui ont tendance il est vrai à l’esclavage, comme si celles-ci étaient responsables de son sort, non pas « d'esclave de la Nation » qu'il est devenu, mais « d'esclave de tente » qu'il fut. Pourtant, il demeure profondément attaché à son arabité, héritage indélébile de sa condition, et plus généralement à l’arabité de la Mauritanie. Si attaché, qu'il se dit, comme Ahmed Ould Daddah, pas favorable à la révision de la constitution qui consacre le caractère arabe de la Nation. Plus récemment encore, c'est-à-dire à l'occasion de la campagne, il s'engage à criminaliser (je me demande comment, surtout quant ils réussissent) les coups d'état, phénomènes conjoncturels, lourds de conséquence certes, mais tout de même imprévisibles. Alors qu'il ne dit mot du racisme qui gangrène notre société. Il peut bien faire valoir ses qualités de citoyen aux mépris de la couleur de sa peau, mais peut il pour cela et sans démagogie évacuer une question aussi essentielle.
Enfin, un dernier facteur et non des moindres, l’incapacité des tenants du discours identitaire, en particulier les FLAM et dans une certaine mesure AJD/MR, à le faire évoluer et l’adapter aux mutations, récentes mais notoires, de notre société. Les idéologies basées sur les courants du panarabisme Bassiste et Nassérien se sont essoufflées. En tout cas, elles inspirent peu la jeune classe des politiques arabes qui gravitent autour du pouvoir. Ceux-ci aspirent au pouvoir pour le pouvoir et évidement les avantages qu’ils pensent que celui-ci procure : richesse, prestige.
La persistance de ces facteurs et l'instrumentalisation concomitante ou non par les régimes font du combat identitaire un combat vain. Pour que les questions que cette lutte pose ne restent pas des propos incantatoires simples, il faut inventer une autre méthode, ouvrir une autre porte d’entrée, emprunter un autre langage soutenu par un ton plus audible. Il serait à rechercher du côté de la citoyenneté, de l’intégration, de la cohésion sociale
3. Un besoin impérieux de renouvellement de la classe politique. Depuis 1992 et la pseudo démocratisation, la classe politique mauritanienne est quasiment la même. L'opposition intérieure n'a jamais pu ou su réaliser l'alternance, faute de proposer un projet de société fiable lui permettant de constituer une alternative crédible aux régimes en place. Mieux, elle a plus brillé par des conflits d'intérêts en son sein, que par la définition et la mise en application d'une stratégie réelle de conquête de pouvoir. La première vraie tentative de ce genre remonte au scrutin présidentiel de mars 2007. Elle s'est terminée dans les conditions que chacun sait. En dépit de tous les engagements pris au sein de la CFCD, Messaoud Ould Boulkheïr a préféré aller à la soupe plutôt que de favoriser l'arrivée au pouvoir d'une opposition qui craignait l'installation d'un candidat des militaires. Alors quand je vois le débat qui a circulé à la veille et l'avant-veille dans un certain cercle sur la personnalité de cet homme, - passé au gré des jeux de mots de personnage légendaire (héros) au statut d'officier chargé de transmettre les messages de guerre (héraut), deux mots au sens littéralement opposé- je m'interroge s'il s'agit bien du même.
Au delà de ce fait presque anecdotique, se pose, de mon point de vue, l'absolue nécessité de renouvellement d'une classe politique marquée par des décennies d'affairisme, de corruption à grande échelle, de détournement de deniers publics, de combines, de mauvaise gestion et j'en passe. Tous ceux qui ont animé l'épisode TAYA ne doivent plus bénéficier de la confiance de notre peuple, tant ils se sont distingués par leur propension à se servir de l’Etat plutôt que le servir. Tout comme certains de ceux qui avaient constitué l 'opposition légale. Au premier chef desquels Ahmed Ould Daddah, épuisé et noyé par des ambitions personnelles démesurées, et qui ne tire aucune leçon du passé. Qui s’obstine, il y a peu encore, à l'occasion d'un meeting politique « à ne pas vouloir juger le passé », oubliant qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire court le risque de la voir se répéter. Les déportations ont eu lieu il y a vingt ans. Le retour des déportés se poursuit encore. Peut on faire comme si de rien n’était.
Il est donc venu le temps de laisser la place à une nouvelle race d'hommes et de femmes, intellectuellement mieux outillés et politiquement plus affûtés quoique plus jeunes, mais surtout propres comme Mohamed Jemil Mansour, comme KANE Hamidou Baba, comme certainement d’autres aussi, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Avec eux, une campagne électorale ne sera plus une question de tribu, de village ou d’ethnie, encore moins une simple affaire d’argent, acquis je ne sais comment, servant à acheter des voix de populations pauvres et ignorantes plus que des consciences, mais bien une confrontation d’idées et de programme mettant le développement de la Mauritanie au centre de leurs préoccupations.
Boubacar DIAGANA
Coordinateur du comité de soutien du candidat KHB
Source: hk

 Actualités
Actualités




















![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



