Quand le pouvoir invite au dialogue… c est toujours pour mieux le neutraliser.
Un régime autoritaire ou semi-autoritaire peut très bien organiser un dialogue politique en apparence ouvert, tout en mettant en place des mécanismes subtils (ou grossiers) de contrôle. L’objectif n’est pas de trouver des solutions, mais de gagner du temps, légitimer le statu quo, diviser l’opposition ou soigner son image à l’international. Voici les principaux leviers de noyautage et quelques exemples africains édifiants.
1. Contrôle de la composition des commissions
Le pouvoir peut :
• Nommer des “experts” ou des personnalités proches du régime dans les commissions techniques (justice, langue, gouvernance, etc.).
• Exclure ou marginaliser les voix réellement dissidentes sous prétexte de “radicalité” ou de “manque de représentativité”.
• Faire entrer de faux opposants, créés ou financés par le régime, pour brouiller les débats.
Exemple :• En Guinée sous Alpha Condé, les “opposants” proches du régime étaient sur-représentés dans les dialogues politiques. Les vrais opposants étaient marginalisés ou boycottés.
2. Musellement de l’information et encadrement médiatique
Le pouvoir peut :
• Contrôler la couverture médiatique des débats : seules les prises de parole “constructives” (i.e. conformes à la ligne du régime) sont relayées.
• Empêcher la presse indépendante de couvrir les sessions sensibles.
• Cadrer la communication officielle, interdisant aux participants de diffuser librement leurs interventions.
Exemple :
• En Congo-Brazzaville, lors des dialogues nationaux, les médias d’État coupaient ou censuraient les discours critiques envers Denis Sassou Nguesso.
3. Agenda verrouillé et sujets sensibles évités
Le pouvoir fixe l’agenda du dialogue pour :
• Écarter les questions de fond (langues nationales, répartition des richesses, justice pour les victimes, etc.).
• Reléguer certaines thématiques à des “ateliers ultérieurs”, qui ne verront jamais le jour.
• Diluer les revendications dans un langage technocratique flou.
Exemple :
• Au Tchad, après la mort d’Idriss Déby, le dialogue national avait exclu de facto les discussions sur la succession dynastique, bien que ce soit la question centrale.
4. Division stratégique des forces critiques
Le pouvoir peut :
• Multiplier les invitations individuelles (plutôt que par blocs ou coalitions), pour créer de la dispersion.
• Offrir des avantages aux plus dociles : voyages, per diem, promesses de nominations, ce qui affaiblit la cohésion des forces critiques.
• Opposer les “radicaux” aux “modérés” pour mieux les décrédibiliser.
Exemple :
• Au Mali, sous IBK, des figures de la société civile critiques ont été “achetées” avec des postes au CESE ou dans les commissions.
5. Non-respect des conclusions ou dilution des recommandations
Même lorsque les participants parviennent à produire des recommandations sérieuses, le pouvoir peut :
• Ne pas les appliquer du tout.
• En appliquer quelques-unes symboliques et ignorer les plus importantes.
• Créer des “commissions de suivi” sans budget ni pouvoir exécutif.
Exemple :
• En Mauritanie, après les assises de 2011 (dialogue avec l’opposition modérée), rien de substantiel n’a été mis en œuvre en matière de justice transitionnelle, de langues nationales ou de réforme électorale.
le dialogue contrôlé, ou l’art du faux consensus
Un régime qui ne croit pas au pluralisme peut très bien orchestrer un dialogue pour la vitrine, tout en en maîtrisant toutes les variables : qui parle, de quoi on parle, ce qu’on en retient, et comment on le raconte au peuple.
Un vrai dialogue inclusif suppose :
• L’ouverture aux sujets sensibles,
• La reconnaissance de toutes les forces politiques,
• La liberté de la presse,
• Des garanties d’application des conclusions.
À défaut, on assiste à un rituel politique vide, destiné à apaiser l’extérieur, tromper l’intérieur et gagner du temps. En Mauritanie, comme ailleurs, le dialogue n’est pas en soi un progrès : c’est l’usage qui en est fait qui révèle la sincérité d’un régime.
Le dialogue inclusif de Ghazouani : théâtre contrôlé ou refondation nationale ?
Le régime du président Mohamed Ould Ghazouani a initié en 2025 un nouveau “dialogue national inclusif”, censé apaiser les tensions, écouter les revendications, et proposer une refondation politique. Mais à y regarder de plus près, ce dialogue ressemble moins à un processus démocratique qu’à un exercice parfaitement cadré par le pouvoir pour neutraliser les forces critiques et préserver un ordre inégal hérité du système Ould Daddah.
Voici les principaux leviers que le régime utilise pour noyer ce dialogue, étouffer les voix libres, et verrouiller les conclusions à venir.
1. Commissions noyautées, opposants filtrés
Le régime a soigneusement choisi qui participe et qui reste dehors. Pendant que les partis proches du pouvoir ou les “opposants domestiqués” sont mis en avant, les partis non reconnus comme le RAG sont ignorés, et leurs revendications vidées de leur substance. Pourtant, si le RAG représentait une menace pour la République, pourquoi inviter son leader à dialoguer ? Et s’il ne représente rien, pourquoi le convoquer en boucle dans les médias ?
En vérité, le pouvoir veut le symbole Biram, pas sa voix. Il veut l’image, pas l’impact.
2. Sujets sensibles neutralisés d’avance
Le dialogue esquive les questions explosives : esclavage d’État, injustice historique envers les Afro-Mauritaniens, arabisation hégémonique, réparations, reconnaissance des langues nationales… Le traitement de ces thèmes est :
• soit repoussé à plus tard (comme dans les commissions futures),
• soit relégué à des ateliers techniques sans poids politique,
• soit formulé dans un langage vague qui évite toute remise en cause du système.
Le discours du pouvoir est simple : parler sans toucher au fond, écouter sans entendre, inviter sans reconnaître.
3. Contrôle de la narration et des médias
Le récit officiel est verrouillé. Les débats sont présentés comme apaisés, consensuels, sans jamais refléter les tensions profondes. Les médias publics ne donnent la parole qu’aux représentants proches du régime, et la presse critique est discréditée ou ignorée.
Les rares voix discordantes sont accusées de radicalisme, de “perturbation du dialogue”, voire de “volonté de division”. On assiste à une confiscation de la parole publique, comme si critiquer l’ordre établi revenait à trahir la nation.
4. Division et achat des consciences
Certains acteurs de la société civile ou de l’opposition sont approchés, flattés, promus, ou même placés dans les commissions comme garants d’un “équilibre apparent”. Le régime manie l’achat symbolique, les décorations, les voyages à Nouakchott ou à l’étranger, les promesses d’inclusion future.
Cela divise les forces du changement, empêche les coalitions, et transforme les luttes historiques en opportunités personnelles.
5. Refus d’appliquer les engagements passés
Depuis 1978, les régimes successifs connaissent parfaitement les revendications des exclus :
• égalité des langues,
• réparations pour les victimes des déportations et des violences racistes,
• réforme de la gouvernance militaire,
• reconnaissance de la diversité identitaire…
Mais rien n’est jamais appliqué. On répète les dialogues comme on change les rideaux d’un théâtre sans toucher au décor de l’injustice.
Une comédie bien huilée ?
En vérité, le régime de Ghazouani ne cherche pas à transformer l’ordre social, mais à le consolider. L’“inclusivité” affichée sert à masquer une exclusion continue, et le “dialogue national” devient un outil de communication politique, non un instrument de refondation.
Comme dans d’autres régimes africains autoritaires, le dialogue est :
• une pause diplomatique,
• une machine à diluer la colère,
• un outil de légitimation du statu quo.
Et maintenant ? Résister à la confiscation
Face à cela, les forces démocratiques sincères doivent :
• Refuser de servir de décor à un scénario déjà écrit,
• Exiger la reconnaissance de tous les partis, y compris ceux qui dérangent,
• Publier leurs propositions de manière autonome, directement à la population,
• Construire des coalitions transversales et indépendantes du cadre officiel.
Car participer n’est pas trahir, mais se taire dans un faux dialogue, c’est consentir à l’injustice. Wetov.
Sy Mamadou
Source : Kassataya
Un régime autoritaire ou semi-autoritaire peut très bien organiser un dialogue politique en apparence ouvert, tout en mettant en place des mécanismes subtils (ou grossiers) de contrôle. L’objectif n’est pas de trouver des solutions, mais de gagner du temps, légitimer le statu quo, diviser l’opposition ou soigner son image à l’international. Voici les principaux leviers de noyautage et quelques exemples africains édifiants.
1. Contrôle de la composition des commissions
Le pouvoir peut :
• Nommer des “experts” ou des personnalités proches du régime dans les commissions techniques (justice, langue, gouvernance, etc.).
• Exclure ou marginaliser les voix réellement dissidentes sous prétexte de “radicalité” ou de “manque de représentativité”.
• Faire entrer de faux opposants, créés ou financés par le régime, pour brouiller les débats.
Exemple :• En Guinée sous Alpha Condé, les “opposants” proches du régime étaient sur-représentés dans les dialogues politiques. Les vrais opposants étaient marginalisés ou boycottés.
2. Musellement de l’information et encadrement médiatique
Le pouvoir peut :
• Contrôler la couverture médiatique des débats : seules les prises de parole “constructives” (i.e. conformes à la ligne du régime) sont relayées.
• Empêcher la presse indépendante de couvrir les sessions sensibles.
• Cadrer la communication officielle, interdisant aux participants de diffuser librement leurs interventions.
Exemple :
• En Congo-Brazzaville, lors des dialogues nationaux, les médias d’État coupaient ou censuraient les discours critiques envers Denis Sassou Nguesso.
3. Agenda verrouillé et sujets sensibles évités
Le pouvoir fixe l’agenda du dialogue pour :
• Écarter les questions de fond (langues nationales, répartition des richesses, justice pour les victimes, etc.).
• Reléguer certaines thématiques à des “ateliers ultérieurs”, qui ne verront jamais le jour.
• Diluer les revendications dans un langage technocratique flou.
Exemple :
• Au Tchad, après la mort d’Idriss Déby, le dialogue national avait exclu de facto les discussions sur la succession dynastique, bien que ce soit la question centrale.
4. Division stratégique des forces critiques
Le pouvoir peut :
• Multiplier les invitations individuelles (plutôt que par blocs ou coalitions), pour créer de la dispersion.
• Offrir des avantages aux plus dociles : voyages, per diem, promesses de nominations, ce qui affaiblit la cohésion des forces critiques.
• Opposer les “radicaux” aux “modérés” pour mieux les décrédibiliser.
Exemple :
• Au Mali, sous IBK, des figures de la société civile critiques ont été “achetées” avec des postes au CESE ou dans les commissions.
5. Non-respect des conclusions ou dilution des recommandations
Même lorsque les participants parviennent à produire des recommandations sérieuses, le pouvoir peut :
• Ne pas les appliquer du tout.
• En appliquer quelques-unes symboliques et ignorer les plus importantes.
• Créer des “commissions de suivi” sans budget ni pouvoir exécutif.
Exemple :
• En Mauritanie, après les assises de 2011 (dialogue avec l’opposition modérée), rien de substantiel n’a été mis en œuvre en matière de justice transitionnelle, de langues nationales ou de réforme électorale.
le dialogue contrôlé, ou l’art du faux consensus
Un régime qui ne croit pas au pluralisme peut très bien orchestrer un dialogue pour la vitrine, tout en en maîtrisant toutes les variables : qui parle, de quoi on parle, ce qu’on en retient, et comment on le raconte au peuple.
Un vrai dialogue inclusif suppose :
• L’ouverture aux sujets sensibles,
• La reconnaissance de toutes les forces politiques,
• La liberté de la presse,
• Des garanties d’application des conclusions.
À défaut, on assiste à un rituel politique vide, destiné à apaiser l’extérieur, tromper l’intérieur et gagner du temps. En Mauritanie, comme ailleurs, le dialogue n’est pas en soi un progrès : c’est l’usage qui en est fait qui révèle la sincérité d’un régime.
Le dialogue inclusif de Ghazouani : théâtre contrôlé ou refondation nationale ?
Le régime du président Mohamed Ould Ghazouani a initié en 2025 un nouveau “dialogue national inclusif”, censé apaiser les tensions, écouter les revendications, et proposer une refondation politique. Mais à y regarder de plus près, ce dialogue ressemble moins à un processus démocratique qu’à un exercice parfaitement cadré par le pouvoir pour neutraliser les forces critiques et préserver un ordre inégal hérité du système Ould Daddah.
Voici les principaux leviers que le régime utilise pour noyer ce dialogue, étouffer les voix libres, et verrouiller les conclusions à venir.
1. Commissions noyautées, opposants filtrés
Le régime a soigneusement choisi qui participe et qui reste dehors. Pendant que les partis proches du pouvoir ou les “opposants domestiqués” sont mis en avant, les partis non reconnus comme le RAG sont ignorés, et leurs revendications vidées de leur substance. Pourtant, si le RAG représentait une menace pour la République, pourquoi inviter son leader à dialoguer ? Et s’il ne représente rien, pourquoi le convoquer en boucle dans les médias ?
En vérité, le pouvoir veut le symbole Biram, pas sa voix. Il veut l’image, pas l’impact.
2. Sujets sensibles neutralisés d’avance
Le dialogue esquive les questions explosives : esclavage d’État, injustice historique envers les Afro-Mauritaniens, arabisation hégémonique, réparations, reconnaissance des langues nationales… Le traitement de ces thèmes est :
• soit repoussé à plus tard (comme dans les commissions futures),
• soit relégué à des ateliers techniques sans poids politique,
• soit formulé dans un langage vague qui évite toute remise en cause du système.
Le discours du pouvoir est simple : parler sans toucher au fond, écouter sans entendre, inviter sans reconnaître.
3. Contrôle de la narration et des médias
Le récit officiel est verrouillé. Les débats sont présentés comme apaisés, consensuels, sans jamais refléter les tensions profondes. Les médias publics ne donnent la parole qu’aux représentants proches du régime, et la presse critique est discréditée ou ignorée.
Les rares voix discordantes sont accusées de radicalisme, de “perturbation du dialogue”, voire de “volonté de division”. On assiste à une confiscation de la parole publique, comme si critiquer l’ordre établi revenait à trahir la nation.
4. Division et achat des consciences
Certains acteurs de la société civile ou de l’opposition sont approchés, flattés, promus, ou même placés dans les commissions comme garants d’un “équilibre apparent”. Le régime manie l’achat symbolique, les décorations, les voyages à Nouakchott ou à l’étranger, les promesses d’inclusion future.
Cela divise les forces du changement, empêche les coalitions, et transforme les luttes historiques en opportunités personnelles.
5. Refus d’appliquer les engagements passés
Depuis 1978, les régimes successifs connaissent parfaitement les revendications des exclus :
• égalité des langues,
• réparations pour les victimes des déportations et des violences racistes,
• réforme de la gouvernance militaire,
• reconnaissance de la diversité identitaire…
Mais rien n’est jamais appliqué. On répète les dialogues comme on change les rideaux d’un théâtre sans toucher au décor de l’injustice.
Une comédie bien huilée ?
En vérité, le régime de Ghazouani ne cherche pas à transformer l’ordre social, mais à le consolider. L’“inclusivité” affichée sert à masquer une exclusion continue, et le “dialogue national” devient un outil de communication politique, non un instrument de refondation.
Comme dans d’autres régimes africains autoritaires, le dialogue est :
• une pause diplomatique,
• une machine à diluer la colère,
• un outil de légitimation du statu quo.
Et maintenant ? Résister à la confiscation
Face à cela, les forces démocratiques sincères doivent :
• Refuser de servir de décor à un scénario déjà écrit,
• Exiger la reconnaissance de tous les partis, y compris ceux qui dérangent,
• Publier leurs propositions de manière autonome, directement à la population,
• Construire des coalitions transversales et indépendantes du cadre officiel.
Car participer n’est pas trahir, mais se taire dans un faux dialogue, c’est consentir à l’injustice. Wetov.
Sy Mamadou
Source : Kassataya

 Actualités
Actualités












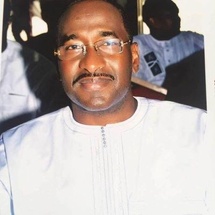









![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



