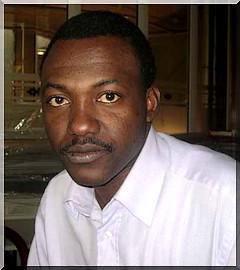
El Arby Ould Saleck
La génération des mauritaniens à laquelle nous appartenons a vécu et continue de vivre dans une époque qui n’est pas réjouissante. Le choix de certains a été dicté par leurs familles, leurs ethnies, leurs tribus, bref par leur trajectoire culturelle et sociale et dans une certaine mesure par leur naissance. Pour d’autre, celui-ci a été le fruit d’une Culture domestiquée au gré du parcours scolaire et universitaire faisant d’eux de véritables « Samba Diallo » dans une aventure qui n’est pas tant ambiguë !
J’appartiens à cette catégorie et je procède d’une école qui place l’intellectuel -du moins celui chez qui certaines caractéristiques peuvent désigner sous ce vocable-au service de son peuple. Mieux, mon école, notre école est marquée du sceau de l’Engagement inspiré des idéaux d’un certain Occident Politique quelques soient les situations et les circonstances et ce, avec une fidélité sans faille aux convictions. En cela, je continue à penser que la force du chercheur, à savoir, la Réflexion, les idées doivent être mises en évidence pour tenter de changer le cour des choses dans une société, une nation, bref un pays. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi le combat politique qui consiste à mettre la réflexion au service de la théorie pour être traduite en action si les conditions et les circonstances en adéquation avec mon idéal me le permettent…
La position d’un intellectuel sous le manteau du chercheur mettant en avant l’objectivité-scientifique-dont la neutralité serait la constance me paraît être une trahison du rôle…. Choisir son camp par la plume uniquement est un minima qui peut trahir la fébrilité et la fragilité de la réflexion si ce choix n’est pas consolidé par un positionnement clair et précis….
En effet, depuis quelques temps, il m’est donné à lire des réflexions et des contributions sur l’Identité des H’ratin en Mauritanie avec un filigrane des affirmations fondées sur une certaine Histoire qu’on veut bien relater et écrire.
A cet égard, il m’a été donné l’occasion d’écrire et de dire souvent que la question H’ratine est issue du désordre historique de notre pays et s’est inscrite à l’ordre du jour comme instrument politique sous la plume et dans le discours de certains ; et en cela, j’ai toujours acquis la conviction que l’énergie produite pour débattre de l’identité des H’ratin est une ruse de l’histoire qui avance par le mauvais bout pour reprendre une expression de Marx parlant du dysfonctionnement de l’Etat. En cela, je partage le constat d’un Ami d’une Mauritanie à l’épreuve du millénaire d’où nous apparaît sa foi de Citoyen : « Maures et négro-africains sont pris dans la tourmente de leur ancien jeu de ping-pong (…) Voilà le comble de l’instrumentalisation et la volonté d’être les éclaireurs de cette communauté… ». Tout est dit et ceux qui ne s’en inspirent pas ont pour objectif dans leur positionnement, que le meurtre devienne plus respectable…
Le ré enchantement du passé est un sentiment universel qui est bien domestiqué par nous les nègres descendants d’esclaves ou non ayant une sensibilité à fleur de peau. Je tenterai de ne pas y tomber même si je reconnais que cela m’est souvent difficile, la réalité ne coïncidant pas toujours avec l’aspiration au sacre du citoyen auquel les H’ratin dans leur majorité aspirent. Pour éviter aussi la narration et au risque de procéder par un raccourci, l’identité des H’ratin que la plume de nos chercheurs et intellectuels n’arrivent pas à conceptualiser est simple à appréhender : elle est la jonction d’une Histoire Nègre et d’une Culture Arabo-berbère qu’ils n’ont pas choisi s’agissant de la deuxième principalement. Nonobstant toute la production intellectuelle, l’identité, ce besoin d’appartenance culturelle même s’il demeure légitime dans le foisonnement et l’affirmation de l’Universel demeure à mon sens exécrable. Elle conduit à la peur de l’autre, voire sa négation. Nous ne devons pas avoir en Mauritanie la mémoire courte pour ne pas s’enrichir de notre histoire récente si nous maintenons comme discours politique une recherche de la performance de l’Identité d’une composante de la nation mauritanienne à construire.
Qu’à cela ne tienne, il serait intéressant d’aller à la rencontre de la part d’ombre du discours et du débat sur l’identité des H’ratin : que cache cette propension à vouloir coûte que coûte désigner cette communauté dans une définition identitaire ? Au fait, pourquoi les communautés Hal Pularen et Soninké par exemple n’éveillent elles pas la curiosité des chercheurs et intellectuels pour scruter leurs identités ? Pourtant, ces deux communautés offrent de multiples palettes socioculturelles susceptibles d’être un objet inépuisable pour la réflexion scientifique et dont les résultats garniront les rayons des sciences sociales dans nos bibliothèques. Elles ont été certes étudiées sous différents champs, mais ces études n’ont pas eu d’intérêt du point de vue du champ politique, car ne présentant pas la pertinence qui sied à une étude de l’identité H’ratin dans un environnement sociopolitique incertain.
Ceci étant, sous la plume des promoteurs de l’identité H’ratin, il ya une volonté pour mettre en avant un débat latent sur les conditions de l’avènement d’un système politique dont le fondement serait un Homme, une Voix. Selon l’inconscient collectif de certains intellectuels, ce fondement garantirait « une revanche politique » sur l’hégémonie politique des Maures en Mauritanie. Dans les règles d’une démocratie saine vidée de tous les relents exclusifs, ce scénario est possible même si en ce qui me concerne, je ne souhaite pas une articulation d’une démocratie sur un socle identitaire. Car, dans le secret de l’isoloir, la pertinence du projet politique et des solutions qu’il est censé être porteur me semble plus fortes que l’appel du sang et du lait… Les nations démocratiques ont toujours été multiculturelles en ce sens qu’elles sont constituées d’identités diverses par leurs pratiques religieuses et cultuelles.
Nous avons vécu en Mauritanie un climat émotionnel avec un moment culminant où l’environnement intellectuel a fait sienne l’identité comme socle de réponses politiques et argument de prise de position. Cela a été une réponse à un penchant négationniste mauritanien qui a fleuri sous la conduite de certains responsables politiques arabophones…Cependant, le débat qui vaille aujourd’hui à mon sens est la Construction du Citoyen Mauritanien -H’ratin, Soninké, Hal Pular, Arabo-berbère, Wolof et Bambara - dans la reconnaissance et le respect de sa diversité. En Mauritanie, les communautés en présence n’ont pas un problème d’identité a priori, par contre elles ont un problème d’Etat qui garantirait la place à chacune d’elles, et il importe à mon humble avis de réfléchir sur ses contours.
S’interroger aujourd’hui sur l’identité des H’ratin ne me semble pas opératoire sur un plan politique.
Pour consolider les thèses d’une littérature scientifique, cette interrogation peut avoir un intérêt et apparaît dès lors comme un raccourci, bref une manière de contourner l’obstacle politique que pose la question H’ratin au sein de la Mauritanie en tant qu’Etat pour les acteurs politiques. Aujourd’hui, il est urgent de poser le problème de nos différentes identités en termes de participation à l’édification d’un pays et d’une nation. Sur le plan politique même si je ne saurais sous-estimer la médiocrité de notre personnel politique qui, cinq décennies après l’indépendance n’est pas arrivé à proposer un Rêve -comme le suppose l’action de tout homme politique- à la place de notre scepticisme ; il me semble que notre rôle en tant qu’éclaireurs ou faiseurs d’opinions doit être celui de briller par des propositions concrètes au lieu de cibler nos différences identitaires façonnées par l’Histoire. Elles doivent être perçues comme un acquis, une force pour faire émerger le Citoyen de demain.
En effet, nous traversons un siècle où l’Humain doit être placé au-dessous de tout particularisme. Le combat contre l’obscurantisme dicte la nécessité de cultiver la tolérance comme creuset de notre discours et de notre réflexion intellectuelle et politique. L’Afrique et la Mauritanie en particulier se cherchent une conduite politique dont la légitimité est plus exogène paradoxalement, reléguant les citoyens au rang de sujets. Voilà le seul socle commun à nos différentes identités.
El Arby OULD SALECK
Nanterre, FRANCE
Source: Baba ould Jiddou et Biram ould Dah
J’appartiens à cette catégorie et je procède d’une école qui place l’intellectuel -du moins celui chez qui certaines caractéristiques peuvent désigner sous ce vocable-au service de son peuple. Mieux, mon école, notre école est marquée du sceau de l’Engagement inspiré des idéaux d’un certain Occident Politique quelques soient les situations et les circonstances et ce, avec une fidélité sans faille aux convictions. En cela, je continue à penser que la force du chercheur, à savoir, la Réflexion, les idées doivent être mises en évidence pour tenter de changer le cour des choses dans une société, une nation, bref un pays. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi le combat politique qui consiste à mettre la réflexion au service de la théorie pour être traduite en action si les conditions et les circonstances en adéquation avec mon idéal me le permettent…
La position d’un intellectuel sous le manteau du chercheur mettant en avant l’objectivité-scientifique-dont la neutralité serait la constance me paraît être une trahison du rôle…. Choisir son camp par la plume uniquement est un minima qui peut trahir la fébrilité et la fragilité de la réflexion si ce choix n’est pas consolidé par un positionnement clair et précis….
En effet, depuis quelques temps, il m’est donné à lire des réflexions et des contributions sur l’Identité des H’ratin en Mauritanie avec un filigrane des affirmations fondées sur une certaine Histoire qu’on veut bien relater et écrire.
A cet égard, il m’a été donné l’occasion d’écrire et de dire souvent que la question H’ratine est issue du désordre historique de notre pays et s’est inscrite à l’ordre du jour comme instrument politique sous la plume et dans le discours de certains ; et en cela, j’ai toujours acquis la conviction que l’énergie produite pour débattre de l’identité des H’ratin est une ruse de l’histoire qui avance par le mauvais bout pour reprendre une expression de Marx parlant du dysfonctionnement de l’Etat. En cela, je partage le constat d’un Ami d’une Mauritanie à l’épreuve du millénaire d’où nous apparaît sa foi de Citoyen : « Maures et négro-africains sont pris dans la tourmente de leur ancien jeu de ping-pong (…) Voilà le comble de l’instrumentalisation et la volonté d’être les éclaireurs de cette communauté… ». Tout est dit et ceux qui ne s’en inspirent pas ont pour objectif dans leur positionnement, que le meurtre devienne plus respectable…
Le ré enchantement du passé est un sentiment universel qui est bien domestiqué par nous les nègres descendants d’esclaves ou non ayant une sensibilité à fleur de peau. Je tenterai de ne pas y tomber même si je reconnais que cela m’est souvent difficile, la réalité ne coïncidant pas toujours avec l’aspiration au sacre du citoyen auquel les H’ratin dans leur majorité aspirent. Pour éviter aussi la narration et au risque de procéder par un raccourci, l’identité des H’ratin que la plume de nos chercheurs et intellectuels n’arrivent pas à conceptualiser est simple à appréhender : elle est la jonction d’une Histoire Nègre et d’une Culture Arabo-berbère qu’ils n’ont pas choisi s’agissant de la deuxième principalement. Nonobstant toute la production intellectuelle, l’identité, ce besoin d’appartenance culturelle même s’il demeure légitime dans le foisonnement et l’affirmation de l’Universel demeure à mon sens exécrable. Elle conduit à la peur de l’autre, voire sa négation. Nous ne devons pas avoir en Mauritanie la mémoire courte pour ne pas s’enrichir de notre histoire récente si nous maintenons comme discours politique une recherche de la performance de l’Identité d’une composante de la nation mauritanienne à construire.
Qu’à cela ne tienne, il serait intéressant d’aller à la rencontre de la part d’ombre du discours et du débat sur l’identité des H’ratin : que cache cette propension à vouloir coûte que coûte désigner cette communauté dans une définition identitaire ? Au fait, pourquoi les communautés Hal Pularen et Soninké par exemple n’éveillent elles pas la curiosité des chercheurs et intellectuels pour scruter leurs identités ? Pourtant, ces deux communautés offrent de multiples palettes socioculturelles susceptibles d’être un objet inépuisable pour la réflexion scientifique et dont les résultats garniront les rayons des sciences sociales dans nos bibliothèques. Elles ont été certes étudiées sous différents champs, mais ces études n’ont pas eu d’intérêt du point de vue du champ politique, car ne présentant pas la pertinence qui sied à une étude de l’identité H’ratin dans un environnement sociopolitique incertain.
Ceci étant, sous la plume des promoteurs de l’identité H’ratin, il ya une volonté pour mettre en avant un débat latent sur les conditions de l’avènement d’un système politique dont le fondement serait un Homme, une Voix. Selon l’inconscient collectif de certains intellectuels, ce fondement garantirait « une revanche politique » sur l’hégémonie politique des Maures en Mauritanie. Dans les règles d’une démocratie saine vidée de tous les relents exclusifs, ce scénario est possible même si en ce qui me concerne, je ne souhaite pas une articulation d’une démocratie sur un socle identitaire. Car, dans le secret de l’isoloir, la pertinence du projet politique et des solutions qu’il est censé être porteur me semble plus fortes que l’appel du sang et du lait… Les nations démocratiques ont toujours été multiculturelles en ce sens qu’elles sont constituées d’identités diverses par leurs pratiques religieuses et cultuelles.
Nous avons vécu en Mauritanie un climat émotionnel avec un moment culminant où l’environnement intellectuel a fait sienne l’identité comme socle de réponses politiques et argument de prise de position. Cela a été une réponse à un penchant négationniste mauritanien qui a fleuri sous la conduite de certains responsables politiques arabophones…Cependant, le débat qui vaille aujourd’hui à mon sens est la Construction du Citoyen Mauritanien -H’ratin, Soninké, Hal Pular, Arabo-berbère, Wolof et Bambara - dans la reconnaissance et le respect de sa diversité. En Mauritanie, les communautés en présence n’ont pas un problème d’identité a priori, par contre elles ont un problème d’Etat qui garantirait la place à chacune d’elles, et il importe à mon humble avis de réfléchir sur ses contours.
S’interroger aujourd’hui sur l’identité des H’ratin ne me semble pas opératoire sur un plan politique.
Pour consolider les thèses d’une littérature scientifique, cette interrogation peut avoir un intérêt et apparaît dès lors comme un raccourci, bref une manière de contourner l’obstacle politique que pose la question H’ratin au sein de la Mauritanie en tant qu’Etat pour les acteurs politiques. Aujourd’hui, il est urgent de poser le problème de nos différentes identités en termes de participation à l’édification d’un pays et d’une nation. Sur le plan politique même si je ne saurais sous-estimer la médiocrité de notre personnel politique qui, cinq décennies après l’indépendance n’est pas arrivé à proposer un Rêve -comme le suppose l’action de tout homme politique- à la place de notre scepticisme ; il me semble que notre rôle en tant qu’éclaireurs ou faiseurs d’opinions doit être celui de briller par des propositions concrètes au lieu de cibler nos différences identitaires façonnées par l’Histoire. Elles doivent être perçues comme un acquis, une force pour faire émerger le Citoyen de demain.
En effet, nous traversons un siècle où l’Humain doit être placé au-dessous de tout particularisme. Le combat contre l’obscurantisme dicte la nécessité de cultiver la tolérance comme creuset de notre discours et de notre réflexion intellectuelle et politique. L’Afrique et la Mauritanie en particulier se cherchent une conduite politique dont la légitimité est plus exogène paradoxalement, reléguant les citoyens au rang de sujets. Voilà le seul socle commun à nos différentes identités.
El Arby OULD SALECK
Nanterre, FRANCE
Source: Baba ould Jiddou et Biram ould Dah

 Actualités
Actualités




















![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



