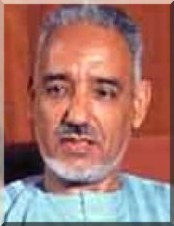
«Sans l’appui de la France et des Etats africains francophones, la Mauritanie n’aurait pu accéder à l’indépendance».
«L’entreprise Mauritanie est encore viable à la seule condition que les Mauritaniens y croient et y travaillent courageusement comme nous l’avons fait il y a quelques décennies».
Nous étions 1999. Le 39ème anniversaire. Nous avions décidé à La Tribune de solliciter la mémoire du Père de la Nation, Mokhtar Ould Daddah. Ce fut l’une de ses dernières interviews. Voilà ce que nous lui écrivions, quand nous sollicitions cette interview : «En cette fin de siècle incertain pour notre pays, le rétablissement de la vérité historique pourrait être salvateur.
Votre témoignage est d’autant plus important qu’il permet aux générations actuelles de découvrir des moments uniques et très certainement de vivre, par procuration, l’intensité de la ferveur qui a animé l’équipe des bâtisseurs que vous avez été.
Au moment où le désespoir nous gagne, le récit de l’aventure de l’indépendance est une source d’inspiration, une raison de se réconcilier avec soi…»
La Mauritanie d’aujourd’hui reconnait ce passé et est en passe de le réhabiliter. C’est pourquoi nous vous proposons cette interview du Président Mokhtar alors en exil en France.
La Tribune : Il y a 39 ans déjà, la Mauritanie accédait à l’indépendance. Comme acteur principal de cet acte, comment avez-vous vécu la dernière nuit de la colonisation ?
Moktar Ould Daddah (MOD) : La dernière nuit de la colonisation, celle du 27 au 28 novembre 1960 fut, je dois l’avouer, une nuit d’angoisse pour moi mais aussi pour tous ceux qui préparaient l’accession de notre pays à l’indépendance. La proclamation de l’indépendance avait été fixée le 28 novembre à minuit. Depuis un certain temps, le Royaume du Maroc qui, je le rappelle, revendiquait notre pays, nous menaçait sur ses ondes, de désordres et même d’attentats le jour venu.
Notre premier souci fut donc, et on le comprend, la sérénité. En effet, trente Etats étaient représentés à Nouakchott, soit par leur Chef d’Etat, soit par un responsable de haut rang. Tout incident aurait gâché ce qui devait tout de même être une fête.
Notre deuxième souci concernait l’intendance (hébergement, repas, transport de tous nos invités qui inaugurèrent les premiers immeubles de Nouakchott plantés sur la dune). Car Nouakchott n’était alors qu’un alignement de pancartes : «Ici seront implantés la Présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Palais de Justice…»
Au fond, et c’était cela notre angoisse fondamentale, nous accédions à l’indépendance sans moyens matériels et humains, entièrement dépendants de la France qui finança l’essentiel des manifestations. En outre, et parce que tout manquait, la majorité de nos compatriotes ne croyaient pas à cette indépendance. Ils y étaient même, la plupart d’entre eux, hostiles. Le vent de l’Histoire nous poussait, mais en même temps, nous étions conscients d’entrer dans l’inconnu.
La Tribune : Quel était le programme des festivités ?
MOD : A minuit, mauritaniens et délégations étrangères invitées étaient réunis dans le hangar construit à la hâte à côté de ce qui allait devenir la Présidence de la République. Le brouhaha ne cessa que lorsque, montant sur une estrade improvisée, je déclarais solennellement la Mauritanie indépendante. Indépendante, c’est-à-dire responsable d’elle-même et de son destin. Moment grave que je n’oublierai jamais.
Plus tard, dans la matinée du 28, ce fut le défilé offert à nos invités installés sur la tribune réalisée pour la circonstance sur l’avenue qui conduit à la Présidence. Il n’y avait pas grand monde à Nouakchott en ce temps là, et les travailleurs des premiers chantiers de notre capitale naissante formaient le gros de ceux qui défilaient. Il y avait aussi les méharistes dont les chameaux faisaient l’admiration des délégations présentes, et des groupes folkloriques de nos différentes régions.
Tout ce monde était joyeux et créait une véritable ambiance de fête que nos amis étrangers s’efforçaient de fixer sur la pellicule. Le déjeuner qui suivit fut l’occasion pour moi de recevoir les délégations étrangères et de m’entretenir avec elles. Des tentes furent dressées sur l’emplacement qui, plus tard, allait voir se construire l’école de la justice.
J’étais heureux de saluer les représentants des pays amis qui, par leur présence, venaient soutenir les premiers pas de notre jeune Nation. Mais la Tunisie dirigée par le Président Habib Bourguiba doit garder une place privilégiée dans le cœur des Mauritaniens.
Dérogeant en effet à la position de la Ligue Arabe favorable alors aux revendications du Maroc sur la Mauritanie, le Président Bourguiba envoya Mohamed Masmoudi, son ministre de l’information, pour représenter la Tunisie aux fêtes de l’indépendance mauritanienne.
Par ce geste amical, et alors qu’aucun pays arabe ne nous reconnaissait, le Président Bourguiba affirmait les liens historiques et la Mauritanie avec le Monde arabe. Il faudra néanmoins attendre 1969 et la reconnaissance de la Mauritanie comme pays souverain par le Maroc, pour que ces liens soient confirmés par l’entrée de la Mauritanie dans cette organisation. Cette journée mémorable s’est terminée autour d’un grand méchoui servi sous les tentes dressées là où plus tard seraient construits les bureaux de la Présidence de la République.
Elle doit rester, quoi qu’il advienne, la fierté de ceux qui l’ont vécue, et la référence pour les générations actuelles et futures.
La Tribune : Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l’organisation matérielle de la fête ?
MOD : Une commission d’organisation présidée par Jean Gondre qui était alors notre Consul à Paris, et composée de plusieurs ministres de mon gouvernement, de représentants de l’Union des travailleurs de Mauritanie, des partis politiques, travailla d’arrache-pied pour résoudre les multiples questions évoquées plus haut.
Les moyens financiers de notre budget étant largement insuffisants, ce fut la France qui finança l’essentiel des manifestations. Le service de restauration notamment fut organisé par des sociétés parisiennes qui fournirent également une partie du personnel.
La Tribune : Quand vous vous remémorez la semaine du 21 au 28 novembre 1960, quel est pour vous le moment le plus fort, le souvenir le plus vivant ?
MOD : Cette semaine là, bien sûr ; devait être décisive. Parmi les temps forts qui ont marqué cette semaine, il y a, je l’ai déjà évoqué, l’annonce par l’Ambassade de Tunisie à Paris à notre Consulat parisien de l’arrivée d’une délégation tunisienne. Ce fut un véritable événement et une joie partagée par tous nos compatriotes, joie mêlée d’un vif sentiment de reconnaissance.
Mais à côté de ce motif de grande satisfaction, le martèlement des menaces marocaines puis, au dernier moment la volte-face de l’URSS renonçant à envoyer une délégation pour nos fêtes du 28 novembre, furent sources de déception et d’inquiétude. Je précise que, comme l’URSS, le Malin la Guinée et le Ghana qui avaient donné leur accord, renoncèrent finalement à s’associer à notre joie.
La Tribune : Obtenir puis déclarer l’indépendance d’un pays comme la Mauritanie, n’est-ce pas difficile ?
MOD : Oui, assurément, cela a été très difficile et ce, pour plusieurs raisons. D’abord parce que l’ensemble des chefs traditionnels et des notables étaient hostiles à l’indépendance. Mieux valait, selon eux, que la Mauritanie restât une colonie française. «Nous ne sommes même pas à même de fabriquer un brin d’allumette ni une aiguille», disaient-ils. C’était vrai.
En outre nous étions dépourvus de cadres supérieurs (6 universitaires toutes ethnies confondues) et techniques. D’où l’importance, dans les premières années de la dépendance de l’assistance technique étrangère et surtout française tant dans l’administration que dans les services techniques. Ajoutons que le budget d’équipements était inexistant et que le budget de fonctionnement n’était alimenté que pour une faible part, par nos ressources propres.
Je ne reviens pas sur la menace que les revendications marocaines faisaient peser sur la Mauritanie. L’assassinat du député d’Atar Abdallahi Ould Oubeid en novembre 1960, ne fit que concrétiser ces menaces. Mais je tiens à préciser clairement que sans l’appui de la France et des Etats africains francophones, la Mauritanie n’aurait pu accéder à l’indépendance.
La Tribune : Devant le scepticisme de vos compatriotes qui ne croyaient pas à la viabilité de la Mauritanie, quelle était votre attitude ?
MOD : C’est vrai, à l’époque tout le monde disait : «accéder à l’indépendance ? mais nous n’avons aucun moyen !» A mes yeux, l’argument bien que vrai en partie, ne suffisait pas. L’indépendance, c’est d’abord la fin dans le monde de l’ère de la domination, et la pauvreté ne justifie pas la dépendance. Mais l’indépendance doit se gagner à force de travail et d’intégrité. Elle se construit par les efforts conjugués de tous. C’est le sens que nous avons donné à notre action : passer d’une indépendance formelle octroyée à une indépendance réelle et responsable.
La Tribune : 39 ans après, est-ce que vous croyez que «l’entreprise Mauritanie» est encore viable ?
MOD : Pour ma part j’ai cru en la Mauritanie et en son peuple bien avant le processus d’autonomie interne, vers les années 1950. En effet, le vent de liberté qui balaya les colonies de l’Indochine à Madagascar, le début de la révolution algérienne, tous ces événements m’amenèrent à penser que la Mauritanie devait se préparer à aborder une nouvelle étape de on Histoire.
Oui, l’entreprise Mauritanie est encore viable à la seule condition que les Mauritaniens y croient et y travaillent courageusement comme nous l’avons fait il y a quelques décennies. Bien sûr de lourds handicaps devront être surmontés : les tensions ethniques et tribales qui menacent gravement notre unité, la paupérisation de notre peuple face à un enrichissement sans cause des corrompus qui pillent le peu de richesses nationales qui existent, l’isolement diplomatique qui ramène à néant le rôle de la Mauritanie dans la sous-région, au sein du monde arabe et du continent africain.
Il faudra donc travailler dur pour vaincre ces obstacles. Mais attention ! nous ne sommes plus en 1960, ni en 1978. Le monde a changé depuis, les blocs ont disparu, les Etats se regroupent dans de grands ensembles, les puissantes multinationales font désormais la loi du marché, l’Etat perd peu à peu son omnipotence.
Oui l’entreprise Mauritanie est encore viable, mais il nous faut réfléchir dès à présent sur le rôle de notre pays face aux gigantesques mutations actuelles. D’abord l’unité de notre peuple avant tout. Ensuite la coopération régionale pour se présenter ensemble plus forts face aux grands ensembles existants et en développement tels que l’Union Européenne à la fois partenaire et concurrente de la plupart de nos pays.
La Tribune : «Par où commencer ?» Une question qui nous hante. Au moment de l’indépendance, vous vous êtes certainement posé cette question. Quels étaient à ce moment-là les urgences pour vous ?
MOD : Tout était urgent. Il fallait tout construire. La difficulté était de dégager des priorités. La première de ces priorités fut d’imposer l’existence même de la Mauritanie. A cet égard, victime des revendications marocaines, de l’existence des blocs et de leurs conflits, la Mauritanie ne fut pas admise en 1960 à l’Organisation des Nations Unies.
En effet, l’Union Soviétique utilisé son veto pour contraindre les Etats-Unis d’Amérique à lever le leur sur l’entrée de la Mongolie dans l’Organisation. Finalement, la Mauritanie fut admise en 1961.
La seconde priorité fut de poser les jalons de notre unité nationale. La réhabilitation de la langue arabe nous apparut comme une exigence fondamentale. Attendue par la communauté arabophone qui en était frustrée depuis le début de la période coloniale, elle fut mal comprise par la communauté noire de Mauritanie. Il fallut expliquer ce nécessaire équilibrage entre le français et l’arabe, ce ne fut pas toujours facile.
La troisième priorité concernait la lutte contre un sous-développement endémique : pays d’élevage et d’agriculture, la Mauritanie devait développer ses richesses naturelles. C’est ainsi que dès 1958 elle obtint avec l’aide de l’Etat français un prêt de 66 millions de dollars octroyés par la Banque Mondiale et destinés à l’exploitation des mines de fer de la Kédia d’Ijill.
La Tribune : Quels étaient vos rapports avec la puissance coloniale, vous qui semblez avoir été parachuté et imposé, pour certains ?
MOD : Depuis les années 1954-50, après la fin de la deuxième guerre mondiale, un vent de décolonisation commençait à souffler sur les colonies : en Indochine, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Les peuples colonisés prenaient peu à peu conscience de la nécessité de secouer le joug colonial et de retrouver leur liberté.
Dans certain cas, cette liberté s’obtint par la lutte armée. Dans d’autres, elle s’obtint par des voies plus pacifiques avec des hommes choisis par l’ancien colonisateur. Ce fut en effet mon cas. Fils de notable, ancien fonctionnaire de l’administration coloniale, je fus «parachuté» au poste de président du gouvernement de la loi-cadre, puis Premier ministre durant l’autonomie interne. Tout semblait donc en place pour que je sois «aux commandes».
La période 1960-1969 fut cruciale. Mes rapports avec De gaule furent difficiles. Ce dernier en effet, dans le cadre de la communauté franco-africaine qui venait d’être mise en place, ne tolérait guère la contradiction.
Malgré la nécessaire aide de la France, je n’hésitais pas à protester contre les essais nucléaires français au Sahara, je refusais notre adhésion à l’organisation commune des régions sahariennes (OCRS) destinée à arracher le Sahara de l’Algérie, je soutenais ouvertement la lutte du peuple algérien pour son indépendance… A ces positions le Général me répondait que la question algérienne était une affaire intérieure française qui devait être résolue par des moyens français.
La colonisation de la Mauritanie n’avait qu’un objectif stratégique : il s’agissait de relier les colonies d’Afrique du Nord à celle d’Afrique Noire (la route impériale n°1 Dakar-Casablanca via la Mauritanie illustre cet objectif). Sur le plan géopolitique, la Mauritanie représentait pour la France un territoire clef qui ne pouvait échapper à sa présence.
Le dilemme qui se présenta à moi était fort embarrassant surtout pendant les premières années de notre indépendance. La France était indispensable à la Mauritanie qui assurait sa défense, une partie de son budget, sa diplomatie, etc… Par ailleurs, je ne pouvais ni ne voulais être un «béni-oui-oui» qui n’aurait pris en considération que les seuls intérêts français ignorant ceux de la Mauritanie. Il a donc fallu «naviguer» durant vingt ans entre ces deux exigences d’où de nombreuses fluctuations dans nos relations.
Malgré tout ce qui a été dit plus haut, la détérioration actuelle des relations franco-mauritanienne me paraît une grave erreur stratégique du régime en place. En effet, les intérêts bien compris de notre pays commandent une bonne coopération avec la France avec laquelle nous sommes liés par un siècle d’histoire.
Demain cette coopération devra reprendre et se développer sur des bases nouvelles qui excluront les préjugés réciproques et encourageront un dialogue transparent et constructif dans lequel les intérêts des uns et des autres seront pris en considération.
La Tribune : Très vite vous vous éloignez du giron français. Comment cela a été perçu par l’ancienne métropole ?
MOD : C’est le lieu de donner des précisions relatives à trois choix qui ont été faits par mon gouvernement dans l’intérêt de la Mauritanie, mais sans aucune volonté de nuire à notre partenaire français ni à nos relations bilatérales.
1. La renonciation à la subvention d’équilibre de notre budget de fonctionnement en 1963, ne fut pas reçue comme elle aurait dû l’être par la France. En décidant de ne plus vivre au-dessus de nos moyens, nous apportions pour la première fois, la preuve de notre volonté de donner à l’indépendance un vrai sens. Par là même, nous allégions la charge du budget français.
2. La sortie de l’Organisation Commune des Etats Africains et de Madagascar (OCAM) fut commandée par le souci de ne pas court-circuiter la jeune organisation continentale qui venait de naitre à Adis Abeba en 1963 : l’OUA.
Nous étions certes attachés aux groupes régionaux mais nous pensions que l’OCAM était alors plus un facteur de division que d’unité des Africains. Là encore, notre but n’était pas de déplaire à la France, mais seulement de protéger notre conception de l’unité africaine.
3. La réhabilitation de la langue arabe et sa nouvelle place dans notre système d’enseignement à partir des années 1965-66 fut, je l’ai dit, mal comprise par nos compatriotes du sud, mais aussi par les Français. Ici il faut rappeler des faits qui éclairent mon propos. Durant toute la période coloniale, la Mauritanie était plutôt une nation administrative du Sénégal voisin, qui abritait l’ensemble de ses services administratifs à Saint-Louis.
En outre, à cause du caractère nomade d’une grande partie de nos populations, souvent attachées à des traditions anciennes, les jeunes hassanophones, n’accédant pas à l’école moderne mise en place par les français, ne purent fournir en nombre suffisant les fonctionnaires subalternes dont l’administration française avait besoin. De ce fait, l’administration était investie par nos compatriotes du sud qui ont pu bénéficier de l’école française.
Lors de notre accession à l’indépendance, ce déséquilibre culturel aux conséquences économiques évidentes, apparut insupportable aux arabophones qui bien sûr, exercèrent des pressions dans le sens d’une réhabilitation de la langue arabe. Pour ma part, je n’ai pas attendu l’accession à l’indépendance ni mon entrée en politique, pour penser que cette réhabilitation était inéluctable.
La Tribune : Février 66, premiers heurts interethniques suite à l’introduction de l’Arabe. Comment avez-vous vécu ce moment difficile ?
MOD : A la suite du décret rendant obligatoire l’apprentissage de l’Arabe dans nos écoles, décret qui allait être appliqué dès la rentrée 1966-67 un groupe d’intellectuels francisants du sud, dit «groupe des 19» a décidé de réagir contre cette décision. Ils incitèrent les élèves des lycées à faire grève. Des établissements scolaires, la contestation gagna la rue et on déplora plusieurs victimes de ces émeutes interraciales.
Devant une situation qui risquait de s’étendre à toute la Mauritanie, l’état d’urgence fut décrété et notre jeune armée, malgré ses faibles moyens, put éviter le pire. Ainsi, par nos propres moyens, l’ordre fut rétabli sans l’intervention des troupes françaises basées à Dakar, intervention proposée par l’Ambassade de France à Nouakchott.
Pour ma part, et malgré ma profonde conviction que la langue arabe devait reprendre sa place à côté du français, j’étais très inquiet pour l’avenir de notre pays dont la fragile unité risquait de s’effondrer laissant la place à l’éclatement et au chaos. Heureusement, grâce au sang froid de tous, ces malheurs ont été évités.
La Tribune : Quand vous soutenez, dès la guerre de 1967, les frères arabes qui ne vous reconnaissaient pas, était-ce par calcul ?
MOD : Ce n’était aucunement par calcul. En voici la preuve. J’ai considéré que le devoir de solidarité envers nos frères arabes et notamment palestiniens, devait l’emporter sur tout autre facteur. Ce n’est pas parce que, à ce moment, les Etats arabes nous ont abandonnés que nous devions renoncer à notre devoir sacré de solidarité envers un peuple chassé de ses terres, soumis à une occupation militaire insupportable, privé de son droit à la souveraineté interne et internationale.
Il fallait marquer cette solidarité, d’où la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis qui aidaient par ailleurs Israël à perpétuer son occupation par la force d’une partie de l’Egypte et de la Syrie.oir leurs relations avec l’Eta hébreu…
La Tribune : Vous avez été l’élément-clé de la diplomatie arabe en Afrique et vice-versa. Estimez-vous que l’établissement des relations avec Israël est une «revanche historique» de cet Etat qui pénètre la région à travers la Mauritanie qui l’en a chassé autrefois ?
MOD : Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, je n’ai manqué aucune occasion d’affirmer la solidarité militante de notre peuple avec les peuples arabes victimes de l’expansionnisme israélien. J’ai constamment dénoncé l’occupation des territoires arabes de Palestine, de Syrie, du Liban et d’Egypte. J’ai appuyé la lutte du peuple palestinien pour son existence en tant qu’Etat indépendant. J’ai dénoncé le silence complice des grandes puissances et de la communauté internationale devant les actes d’agression répétés de l’Etat hébreu.
Aujourd’hui un processus de paix s’amorce entre Israël et ses voisins arabes. Il faut l’encourager, le soutenir pour que ce conflit vieux de 50 ans prenne fin pour le bien de tous les peuples de la région. Mais aujourd’hui aussi, le Golan syrien et le Sud Liban sont toujours sous occupation militaire israélienne. En Palestine, aucun problème de fond n’est encore réglé, qu’il s’agisse du futur statut de Jérusalem, ou du démantèlement des colonies en Cisjordanie et à Gaza, sans compter d’autres questions importantes.
Dans un contexte aussi difficile, notre solidarité doit être plus forte que jamais avec nos frères arabes et notamment nos frères palestiniens. C’est en position de force qu’Israël réamorce ce processus de paix, alors que les Arabes demeurent divisés sur ses chances de succès.
Cette position, il est clair qu’Israël souhaite la renforcer en dehors même de la région du Moyen-Orient. La stratégie consiste donc à relancer les relations diplomatiques et économiques avec des régions comme l’Afrique noire ou le Maghreb arabe.
C’est dans ce contexte que la Mauritanie est apparue à Israël comme le tremplin idéal pour développer de nouvelles amitiés. Sans peser toutes les conséquences que peut avoir l’établissement de relations diplomatiques au rang d’ambassadeur, le régime en place est tombé dans le piège où la Mauritanie est utilisés sans rien gagner et en perdant sa dignité.
Demain, quand Israël aura évacué les territoire occupés, ce que nous espérons ardemment, les Mauritaniens seront certainement les premiers à soutenir une coopération régionale fructueuse entre l’Etat d’Israël et ses voisins arabes, chacun ayant à apporter une contribution au service du développement de la région. Mais n’anticipons pas. Le chemin à parcourir est encore semé d’embûches.
La Tribune : A la fin des années 60 et au début des années 70, votre pouvoir est confronté à une contestation des jeunes. Comment vous êtes-vous comporté vis-à-vis de cette contestation ?
MOD : Dès 1968 en effet, dans la mouvance des mouvements de protestation en France et ailleurs, une partie de notre jeunesse – les Kadihines- se mit elle aussi à contester le système en place. Pour ce, ces jeunes s’exprimèrent par des manifestations dans les établissements scolaires, des graffitis sur les murs, des tracts etc…
Bien qu’une certaine fermeté fut nécessaire pour éviter que ces manifestations ne prissent pas une tournure plus grave, nous avons choisi la voie du dialogue avec cette jeunesse qui pouvait apporter des idées nouvelles à notre parti, le Parti du Peuple Mauritanien, tout en apprenant à son tour certaines réalités de notre société.
C’est le lieu ici de rappeler que ce dialogue fut mené principalement par Mariem qui avait alors de hautes responsabilités à la Permanence du PPM. Son rôle fut déterminant. En effet, elle instaura de patients contacts avec les leaders de cette jeunesse dont certains vivaient en semi-clandestinité. Finalement, c’est en 1975 que la jeunesse rallia massivement le PPM.
Je me souviens encore avec émotion de cette fin d’après-midi où une délégation, à la tête d’une marche de plusieurs dizaines de milliers de jeunes, me remit une déclaration affirmant la foi dans notre projet de société. Ces jeunes avaient pris leurs responsabilités, le parti s’était enrichi, la Mauritanie y gagnait.
La Tribune : Nous arrivons à cette époque glorieuse où les réformes entreprises par vous avaient permis la nationalisation des richesses et plus d’indépendance. Certains pensent aujourd’hui qu’il s’agissait là de mauvais choix. Qu’en pensez-vous ?
MOD : Toutes les décisions qui ont été prises m’ont semblé les meilleures possibles à l’époque où elles ont été prises. J’ai toujours pris en considération à la fois le passé, le présent et l’avenir, et croyez moi ce ne fut jamais facile de faire certains choix. Cela dit, nul n’est infaillible. Au-delà des hommes, c’est l’Histoire qui, en fin de compte, jugera ce que j’ai fait.
Le choix de la réhabilitation de la langue arabe, c’est le choix de la protection de notre identité, ce qui n’exclut aucunement les autres langues nationales. Le choix d’une monnaie nationale, l’Ouguiya, c’est le choix d’un outil destiné à accélérer le développement économique.
Le choix de la révision des accords avec la France, c’est l’expression de la volonté d’adapter nos rapports avec l’ancien colonisateur et de les mettre en adéquation avec notre niveau de développement culturel, économique et politique, les premiers accords de 1960 étant léonins et n’ayant pas fait l’objet de discussions réelles. Le choix d’un dialogue avec les jeunes, c’est notre volonté d’assurer l’avenir et d’adapter notre projet de société au temps présent, etc.
La Tribune : Avec vous, comment se déroulait le processus de décision ?
MOD : Depuis notre accession à l’indépendance formelle, je n’ai eu de cesse de vouloir substituer à cette indépendance octroyée, une véritable indépendance qui exige des efforts et même des sacrifices de la part de tous. La tension était constante, tant j’étais conscient du travail à accomplir et du manque cruel de moyens.
Bien des mesures nécessitèrent des explications, des débats parfois des discussions. Mais finalement nos compatriotes se laissaient convaincre, épousant pleinement avec leurs dirigeants les orientations arrêtées. Rien n’aurait été possible s’il n’y avait pas eu ce consensus permanent entre les gouvernants et la majorité des Mauritaniens.
Je voudrais dire ici quelques mots sur la méthode mise au point, durant des années, outre les congrès et conseils nationaux qui étaient loin d’être de simples formalités et où les joutes oratoires allaient bon train, il y a les tournées et les séminaires régionaux. Ceux-ci étaient l’occasion choisis pour tous, d’un fructueux dialogue entre la base et le sommet, un dialogue où les rôles étaient inversés pour le bien de notre vie politique.
C’était les dirigeants qui étaient jugés par les militants, parfois sévèrement et même injustement. Mais ce débat était salutaire. Nulle question n’était taboue et la courtoisie des propos était de mise. Souvent les critiques disaient : «nous t’avons élu toi, Moktar, me disait-on, pas les collaborateurs que tu as été seul à choisir !»
A l’issue des séminaires, inventaire était tenu des critiques, questions et souhaits. Tout cela remontait au Bureau Politique qui tenait le plus grand compte de ces opinions venues des diverses couches de notre population.
On voit clairement que les élections – à condition qu’elles soient transparentes – ne peuvent que finaliser un processus démocratique fondé sur le dialogue et la tolérance à tous les niveaux. Elles ne peuvent en aucun cas servir à instaurer un système démocratique. Dans ce cas, elles ne sont qu’un leurre, ce que d’ailleurs notre peuple n’accepte plus.
La Tribune : Parce qu’on a parlé de «revanche historique», estimez-vous aujourd’hui que la Mauritanie est la négation de ce que vous aviez entrepris ?
MOD : Est-ce que la Mauritanie d’aujourd’hui est la négation de celle d’hier ? Cette question m’a donné l’idée d’un tableau révélateur mais seulement indicatif.
Unité et Démocratie jusqu’en 1978 Unité et Démocratie depuis 1978
-Lutte contre le tribalisme et le régionalisme
- Retour en force du tribalisme et du régionalisme
-Lutte contre toute forme de népotisme et de clientélisme, et contre la corruption - Népotisme et clientélisme sont les bases du pouvoir actuel. La corruption..
La Tribune(Mauritanie)
via CRIDEM.ORG

 Actualités
Actualités




















![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



