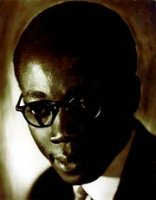
Sortie de la plume incendiaire d’Aimé Césaire, le poète insulaire, la négritude désigne ce mouvement culturel et littéraire qui vit le jour dans les années 30 en France, pour répondre selon Mohamadou Kane à ’l’insolence de l’Europe qui prétendait avoir colonisé l’Afrique, terre de barbarie, et devoir combler un vide culturel par sa civilisation, sa foi et ses idéaux démocratiques et humanitaires’ (1). Dans une perspective militante, il s’agissait de défendre et d’illustrer les valeurs de civilisation nègre et de permettre aux Africains de retrouver leur dignité et leur fierté piétinées et bafouées par un Occident imbu de lui-même et de sa culture, pour jeter ainsi les bases d’une prise en charge possible des africains de leur propre destin.
C’est pourquoi en choisissant d’illustrer ce combat à la fois culturel et politique en nous appuyant sur Senghor, Césaire et Cheikh Anta Diop, nous nous sommes fixés pour objet d’interconnecter la pensée des trois auteurs pour mettre en évidence les coutures et les coupures qui les séparent en certains points et les réunissent en d’autres, dans la spécification d’une culture africaine intrinsèquement authentique, comme moyen de libération du génie noir et d’insertion de l’Afrique dans le concert des nations. Au détour de cette observation liminaire, et eu égard à ce qui précède, il conviendra d’articuler la réflexion autour de trois axes : la dimension collective et affirmative du mouvement, avec son corollaire, la dimension personnelle et libératrice, lesquelles sont en interaction dynamique et circulaire, qui secrète le ferment à partir duquel ces auteurs estiment que l’avenir du continent devrait être construit.
Dans sa démarche discursive, Senghor part d’une évidence : ‘N’est-il pas normal, je ne dis pas en logique mais en dialectique que chaque groupe humain élabore ses moyens d’adaptation à la nature et d’adaptation de la nature à lui.’ (2). Car l’homme est partout confronté à des besoins physiques et psychologiques, matériels, intellectuels et spirituels. Dès lors, la civilisation est selon cet auteur, ce qui résulte de la domestication de la nature par l’homme, pour assouvir ses besoins. D’où chaque peuple dans une situation donnée, compte tenu de multiples facteurs, entre autres historiques et géographiques, produit une culture, qui, lors même que certaines des qualités qui la caractériseraient se retrouveraient chez d’autres peuples, n’en présenterait-elle pas moins, quelque spécificité foncièrement originale. La négritude devient alors ‘l’ensemble des valeurs de civilisation du monde noir telles qu’elles s’expriment dans la vie et les œuvres des noirs’ (3). Ce qui permet à Senghor de mettre en relief quelques traits saillants de la culture africaine : la capacité d’émotion, l’esprit de participation, la communion avec la nature, la solidarité clanique, l’organisation démocratique de la société, la palabre, la philosophie de la force vitale, le prestige du verbe…
Mais si Léopold Sédar Senghor a pu développer une telle conception, cela est lié au fait qu’il fut baigné dans ces réalités depuis son jeune âge, et devenu poète, il s’inspire de cet Eden perdu dont il est nostalgique. Cependant, pour Césaire dont l’africanité a été dissoute à travers les vicissitudes de l’histoire, la négritude prend la forme d’une révolte contre les valeurs et la raison de l’Occident ; il nourrit un anticolonialisme viscéral et radical, qui le plonge dans les sources africaines par l’imaginaire et l’imagination poétiques, au double plan stylistique et sémantique. Dans cet élan, Césaire dont le radicalisme a amené ses détracteurs à voir en lui ’un ennemi de l’Europe et un prophète du retour au passé anté-européen’, revendique de manière apologétique la non-technicité : ’Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre (…).’ (4).
Pour l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal, la colonisation est une ‘chosification’, un système d’exploitation et d’oppression qui a bouleversé l’harmonie et l’équilibre des sociétés africaines, et est d’autant plus inacceptable que le contact aurait pu se faire dans le respect des différences. A l’opposé, Senghor considère la colonisation comme un mal nécessaire d’une nécessité historique d’où doit sortir le bien, car au-delà des ruines, des morts et des destructions, les conquérants sèment aussi ’des idées et des techniques qui germent et s’épanouissent en moissons nouvelles’ (5). S’il reconnaît l’antériorité préhistorique et protohistorique des ‘Négroïdes’, Senghor soutient que la civilisation égyptienne, dans la période de l’histoire à proprement parler, s’est constituée autour de la Méditerranée, et est le fruit d’un métissage biologique et culture(6).
Cheikh Anta Diop semble s’inscrire en marge de ces conceptions. Car si pour Césaire le brio de la civilisation africaine culmine avec les grands Empires soudanais, qui ont existé entre les 12e et 16e siècles : Ghana, Mali, Sonrhaï (7), l’historien sénégalais la fait remonter au foyer antique de l’Egypte pharaonique : de l’Egypte nègre qui a civilisé le monde, et dont la matérialité de l’existence est indubitable, comme en attestent les pyramides, les momies, les stèles, les colonnes et les colosses, les sculptures… De ce fait, les valeurs et les connaissances techniques et scientifiques ne seraient pas un produit de l’Europe diffusé par la colonisation, puisque celles-ci ont existé bien avant, en Egypte, berceau de la civilisation, où les savants grecs Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Archimède de Sicile, Platon, Sabon… allaient chercher le savoir auprès des prêtres égyptiens(8).
Pour étayer sa thèse de l’Egypte nègre, Cheikh Anta Diop dégage des similitudes saisissantes, d’ordre linguistique et culturel, révélées dans la comparaison de l’Egypte avec les sociétés africaines : totémisme, circoncision, conception vitaliste de la Royauté, parenté de l’égyptien avec les langues africaines au niveau lexical et grammatical, etc. (9). Aussi se fonde-t-il sur le témoignage unanime des anciens : Hérodote, Diodore, Strabon, Pline, Tacite, lesquels nous enseignent que les Egyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus (10). Pourtant, Champollion de-Figeac a estimé que ces traits ne suffisaient pas à caractériser un noir. Mais alors aurait-on déjà vu des hommes à la peau noire et aux cheveux crépus, qui ne soient pas des nègres ? En réalité, pour Cheikh Anta Diop, l’impérialisme a été l’infrastructure explicative de cette superstructure idéologique de falsification historique, à des fins de légitimation hégémonique, produite par des ’savants’ à l’honnêteté intellectuelle douteuse (11).
Dès lors, la libération de l’Africain passe pour l’égyptologue sénégalais, par un travail de réécriture objective de l’histoire, car ‘le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l’humanité dans la voie de la civilisation ; que ce sont eux qui ont crée les arts, la religion (en particulier le monothéisme), la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l’écriture, les sciences exactes (physique, mathématique, mécanique, astronomie, calendrier…), la médecine, l’architecture, l’agriculture, etc., à une époque où le reste de la terre (Asie, Europe : Grèce et Rome…) était plongé dans la barbarie’ (12). L’inculcation de cette vérité historique devrait mettre fin au ‘flottement de la personnalité de l’africain’ (13), pour lui permettre ‘de retrouver la continuité de son histoire et la consistance de sa culture, en même temps que les moyens d’adapter celle-ci aux exigences modernes’ ( 14) ; pour retrouver la confiance et la plénitude intérieures - différentes de la suffisance -, et sans lesquels tout effort humain est hypothéqué (15).
Dans la vision messianique et prophétique de la négritude chez Césaire qui s’élève comme le héros et le héraut des peuples noirs : ’Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir’ (16), il s’agit de ’cadavériser la vieille négritude’ (17) faite de larbinisme et de complexe d’infériorité, dans un vécu de cul-de-basse fosse de soi-même, pour s’engager résolument dans la conquête du monde, où il est place pour tous, car ’aucune race ne possède le monopole de la beauté de l’intelligence, de la force’ (18). La seule arme qui vaille alors est la volonté ferme et inébranlable puisée dans le fonds intarissable d’un moi retrouvé et réconcilié avec lui-même. Ce faisant, l’Afrique et les Africains devraient être les plus rigoureux et les plus exigeants envers eux-mêmes, du fait du retard objectif et actuel qu’ils accusent, et du fait qu’ils aient enduré au cours de l’histoire des souffrances indicibles.
Dans le même ordre d’idées, Senghor estime que la négritude, au-delà des écarts passionnels qui l’ont marquée, surtout à ses débuts, n’est rien autre qu’’une volonté d’être soi-même pour s’épanouir’. Il propose l’enracinement dans les valeurs et les réalités négro-africaines et l’ouverture au monde. La négritude cesse alors d’être une ‘négritude-ghetto’, ‘un racisme anti-raciste’ selon l’expression de Jean-Paul Sartre, pour devenir un humanisme authentiquement et totalement humain.
On peut remarquer de même que dans sa fougue érudite, le poète martiniquais se garde de toute haine, dans la prière qu’il formule pour obtenir les ressources intérieures dont il a besoin, pour jouer pleinement son rôle de démiurge : Mais les faisant mon cœur préservez-moi de toute haine ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n’ai que haine (…) vous savez que ce n’est point par haine des autres races que je m’exige bêcheur de cette unique race que ce que je veux c’est pour la faim universelle c’est pour la soif universelle’ (19). Cet impératif de mesure et de tolérance est partagé par l’auteur de Nations nègres et culture qui estime qu’en dépit des années difficiles (1948-1953) au cours desquelles l’ouvrage a été écrit, quand se jouaient des enjeux décisifs pour les pays africains, dix ans après, dans la préface de l’édition de 1964, on constate selon Cheikh Anta Diop, ‘l’absence de traces de haine et de racisme à rebours’. Mais si Senghor prône l’édification d’une ‘Civilisation de l’Universel’ constituée des différences nécessaires et complémentaires de tous les peuples de la terre, sans exclure explicitement une ouverture généralisée, Cheikh Anta Diop accorde la priorité à l’indépendance nationale et au panafricanisme. Pour lui, il s’agit de bâtir un Etat fédéral d’Afrique noire sur la base de fondements économiques et culturels, en s’inspirant notamment du foyer originel de l’Egypte nègre, d’où proviennent les populations d’Afrique.
Cernant le panafricanisme, Senghor a une vision plus réaliste, car il ne s’agit pas pour lui de procéder à une intégration immédiate et décisive, en raison de nombreux facteurs de division : la diversité et l’hétérogénéité ethniques, la contradiction des intérêts, les querelles de puissance et de leadership, la ‘realpolitik’ sur le plan international, le système des blocs : anglophone, lusophone, francophone ; Afrique du nord, Afrique subsaharienne etc. Il s’agit alors, pour lui, de construire une intégration progressive et médiate par ‘cercles concentriques’ à travers des compromis dynamiques. C’est ce à quoi nous assistons aujourd’hui, avec la constitution et la construction des ensembles sous-régionaux : Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ; Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ; Union douanière des Etats d’Afrique Centrale (Udeac) ; South African Development Community (Sadec), etc.
En définitiv,e la lecture combinée des conceptions de la négritude chez Senghor, Césaire et Cheikh Anta Diop révèle, au-delà des nuances, des différences et des divergences, une même trame de fond qui consiste en la défense et en l’illustration de l’identité culturelle africaine, lequel combat replacé dans son contexte, en même temps qu’il déconstruisait l’idéologie coloniale, permettait aux africains de se réfléchir comme étant tout à fait capables de s’assumer et d’assumer les responsabilités qui devaient s’attacher à l’indépendance nationale, et à la création de nouveaux Etats. Cependant, plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la négritude, notamment celle de Wolé Shoyinka, qui pragmatique comme les anglo-saxons savent souvent l’être, estimait qu’’un tigre ne crie pas sa tigritude, il tue sa proie’, oubliant peut-être, par là, que l’action humaine pour être efficace a toujours besoin d’être orientée, pensée et planifiée, même si le penseur doit se garder de n’être qu’un penseur. Car, comme le disait Karl Marx, ‘les philosophes n’ont fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différentes manières, il s’agit maintenant de le transformer’.
Au demeurant, une théorie quelles que soient sa cohérence interne et son intelligibilité harmonieuse et agréable à l’esprit, ne vaut que par rapport à ce que les hommes en font, compte tenu de leurs intérêts, de leurs qualités et de leurs défauts, de leurs limites et de leurs mérites, des ressources dont ils disposent, et des contraintes auxquelles ils sont confrontées. Dans tous les cas, au regard du désenchantement multiforme qui a suivi cette période d’euphorie et de narcissisme africanisant exacerbé, l’Afrique, plusieurs décennies après, bat encore de bien tristes records. Au-delà de la victimisation dépendantiste fondée sur l’iniquité des rapports économiques internationaux, quelles sont les responsabilités de l’Afrique et des africains eux-mêmes dans cette faillite multiforme ? Comment galvaniser les élites et les peuples africains pour une insertion stratégique du continent dans la mondialisation ?
Maurice Soudieck DIONE Maîtrise en droit public Doctorant en Science politique Centre d’Etude d’Afrique Noire Iep Bordeaux. momzolito@yahoo.fr
1 - Mohamadou KANE, ‘Négritude et littérature’, in Colloque sur la Négritude, Dakar, 12-18 avril 1972, p. 62.
2- Léopold Sédar SENGHOR, Négritude, Arabisme et Francité, Beyrouth, 1967, p. 3.
3- Idem p. 4.
4- Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1956, p. 70.
5 - Léopold Sédar SENGHOR, Nation et voie africaine du socialisme, in Liberté II, Paris, Seuil, 1971, p. 296.
6 - Léopold Sédar SENGHOR, La poésie de l’action, Paris, Stock, 1980, p.p. 182-183.
7 - Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Op. Cit., p. 61. 8 - Cheikh Anta DIOP, L’unité culturelle de l’Afrique noire, Présence Africaine, 1959, p. 198.
9 - Cheikh Anta DIOP, Nations nègres et culture, TOME 1, Présence Africaine, 1979, p. 204-287.
10 - Idem p.31.
11 - Idem p. 28.
12 - Cheikh Anta DIOP, Alerte sous les tropiques, Articles 1946-1960, Culture et développement en Afrique noire, Présence Africaine, 1990, p. 48.
13 - Idem p. 47.
14 - Idem p. 48.
15 - Idem p. 48.
16 - Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Op. Cit., p. 41.
17 - Idem p. 85.
18 - Idem p. 83.
19- Lire Aimé CESAIRE, La tragédie du Roi Christophe, Paris, Présence Africaine, 1963.
soure ; walfadjiri
C’est pourquoi en choisissant d’illustrer ce combat à la fois culturel et politique en nous appuyant sur Senghor, Césaire et Cheikh Anta Diop, nous nous sommes fixés pour objet d’interconnecter la pensée des trois auteurs pour mettre en évidence les coutures et les coupures qui les séparent en certains points et les réunissent en d’autres, dans la spécification d’une culture africaine intrinsèquement authentique, comme moyen de libération du génie noir et d’insertion de l’Afrique dans le concert des nations. Au détour de cette observation liminaire, et eu égard à ce qui précède, il conviendra d’articuler la réflexion autour de trois axes : la dimension collective et affirmative du mouvement, avec son corollaire, la dimension personnelle et libératrice, lesquelles sont en interaction dynamique et circulaire, qui secrète le ferment à partir duquel ces auteurs estiment que l’avenir du continent devrait être construit.
Dans sa démarche discursive, Senghor part d’une évidence : ‘N’est-il pas normal, je ne dis pas en logique mais en dialectique que chaque groupe humain élabore ses moyens d’adaptation à la nature et d’adaptation de la nature à lui.’ (2). Car l’homme est partout confronté à des besoins physiques et psychologiques, matériels, intellectuels et spirituels. Dès lors, la civilisation est selon cet auteur, ce qui résulte de la domestication de la nature par l’homme, pour assouvir ses besoins. D’où chaque peuple dans une situation donnée, compte tenu de multiples facteurs, entre autres historiques et géographiques, produit une culture, qui, lors même que certaines des qualités qui la caractériseraient se retrouveraient chez d’autres peuples, n’en présenterait-elle pas moins, quelque spécificité foncièrement originale. La négritude devient alors ‘l’ensemble des valeurs de civilisation du monde noir telles qu’elles s’expriment dans la vie et les œuvres des noirs’ (3). Ce qui permet à Senghor de mettre en relief quelques traits saillants de la culture africaine : la capacité d’émotion, l’esprit de participation, la communion avec la nature, la solidarité clanique, l’organisation démocratique de la société, la palabre, la philosophie de la force vitale, le prestige du verbe…
Mais si Léopold Sédar Senghor a pu développer une telle conception, cela est lié au fait qu’il fut baigné dans ces réalités depuis son jeune âge, et devenu poète, il s’inspire de cet Eden perdu dont il est nostalgique. Cependant, pour Césaire dont l’africanité a été dissoute à travers les vicissitudes de l’histoire, la négritude prend la forme d’une révolte contre les valeurs et la raison de l’Occident ; il nourrit un anticolonialisme viscéral et radical, qui le plonge dans les sources africaines par l’imaginaire et l’imagination poétiques, au double plan stylistique et sémantique. Dans cet élan, Césaire dont le radicalisme a amené ses détracteurs à voir en lui ’un ennemi de l’Europe et un prophète du retour au passé anté-européen’, revendique de manière apologétique la non-technicité : ’Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre (…).’ (4).
Pour l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal, la colonisation est une ‘chosification’, un système d’exploitation et d’oppression qui a bouleversé l’harmonie et l’équilibre des sociétés africaines, et est d’autant plus inacceptable que le contact aurait pu se faire dans le respect des différences. A l’opposé, Senghor considère la colonisation comme un mal nécessaire d’une nécessité historique d’où doit sortir le bien, car au-delà des ruines, des morts et des destructions, les conquérants sèment aussi ’des idées et des techniques qui germent et s’épanouissent en moissons nouvelles’ (5). S’il reconnaît l’antériorité préhistorique et protohistorique des ‘Négroïdes’, Senghor soutient que la civilisation égyptienne, dans la période de l’histoire à proprement parler, s’est constituée autour de la Méditerranée, et est le fruit d’un métissage biologique et culture(6).
Cheikh Anta Diop semble s’inscrire en marge de ces conceptions. Car si pour Césaire le brio de la civilisation africaine culmine avec les grands Empires soudanais, qui ont existé entre les 12e et 16e siècles : Ghana, Mali, Sonrhaï (7), l’historien sénégalais la fait remonter au foyer antique de l’Egypte pharaonique : de l’Egypte nègre qui a civilisé le monde, et dont la matérialité de l’existence est indubitable, comme en attestent les pyramides, les momies, les stèles, les colonnes et les colosses, les sculptures… De ce fait, les valeurs et les connaissances techniques et scientifiques ne seraient pas un produit de l’Europe diffusé par la colonisation, puisque celles-ci ont existé bien avant, en Egypte, berceau de la civilisation, où les savants grecs Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Archimède de Sicile, Platon, Sabon… allaient chercher le savoir auprès des prêtres égyptiens(8).
Pour étayer sa thèse de l’Egypte nègre, Cheikh Anta Diop dégage des similitudes saisissantes, d’ordre linguistique et culturel, révélées dans la comparaison de l’Egypte avec les sociétés africaines : totémisme, circoncision, conception vitaliste de la Royauté, parenté de l’égyptien avec les langues africaines au niveau lexical et grammatical, etc. (9). Aussi se fonde-t-il sur le témoignage unanime des anciens : Hérodote, Diodore, Strabon, Pline, Tacite, lesquels nous enseignent que les Egyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus (10). Pourtant, Champollion de-Figeac a estimé que ces traits ne suffisaient pas à caractériser un noir. Mais alors aurait-on déjà vu des hommes à la peau noire et aux cheveux crépus, qui ne soient pas des nègres ? En réalité, pour Cheikh Anta Diop, l’impérialisme a été l’infrastructure explicative de cette superstructure idéologique de falsification historique, à des fins de légitimation hégémonique, produite par des ’savants’ à l’honnêteté intellectuelle douteuse (11).
Dès lors, la libération de l’Africain passe pour l’égyptologue sénégalais, par un travail de réécriture objective de l’histoire, car ‘le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l’humanité dans la voie de la civilisation ; que ce sont eux qui ont crée les arts, la religion (en particulier le monothéisme), la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l’écriture, les sciences exactes (physique, mathématique, mécanique, astronomie, calendrier…), la médecine, l’architecture, l’agriculture, etc., à une époque où le reste de la terre (Asie, Europe : Grèce et Rome…) était plongé dans la barbarie’ (12). L’inculcation de cette vérité historique devrait mettre fin au ‘flottement de la personnalité de l’africain’ (13), pour lui permettre ‘de retrouver la continuité de son histoire et la consistance de sa culture, en même temps que les moyens d’adapter celle-ci aux exigences modernes’ ( 14) ; pour retrouver la confiance et la plénitude intérieures - différentes de la suffisance -, et sans lesquels tout effort humain est hypothéqué (15).
Dans la vision messianique et prophétique de la négritude chez Césaire qui s’élève comme le héros et le héraut des peuples noirs : ’Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir’ (16), il s’agit de ’cadavériser la vieille négritude’ (17) faite de larbinisme et de complexe d’infériorité, dans un vécu de cul-de-basse fosse de soi-même, pour s’engager résolument dans la conquête du monde, où il est place pour tous, car ’aucune race ne possède le monopole de la beauté de l’intelligence, de la force’ (18). La seule arme qui vaille alors est la volonté ferme et inébranlable puisée dans le fonds intarissable d’un moi retrouvé et réconcilié avec lui-même. Ce faisant, l’Afrique et les Africains devraient être les plus rigoureux et les plus exigeants envers eux-mêmes, du fait du retard objectif et actuel qu’ils accusent, et du fait qu’ils aient enduré au cours de l’histoire des souffrances indicibles.
Dans le même ordre d’idées, Senghor estime que la négritude, au-delà des écarts passionnels qui l’ont marquée, surtout à ses débuts, n’est rien autre qu’’une volonté d’être soi-même pour s’épanouir’. Il propose l’enracinement dans les valeurs et les réalités négro-africaines et l’ouverture au monde. La négritude cesse alors d’être une ‘négritude-ghetto’, ‘un racisme anti-raciste’ selon l’expression de Jean-Paul Sartre, pour devenir un humanisme authentiquement et totalement humain.
On peut remarquer de même que dans sa fougue érudite, le poète martiniquais se garde de toute haine, dans la prière qu’il formule pour obtenir les ressources intérieures dont il a besoin, pour jouer pleinement son rôle de démiurge : Mais les faisant mon cœur préservez-moi de toute haine ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n’ai que haine (…) vous savez que ce n’est point par haine des autres races que je m’exige bêcheur de cette unique race que ce que je veux c’est pour la faim universelle c’est pour la soif universelle’ (19). Cet impératif de mesure et de tolérance est partagé par l’auteur de Nations nègres et culture qui estime qu’en dépit des années difficiles (1948-1953) au cours desquelles l’ouvrage a été écrit, quand se jouaient des enjeux décisifs pour les pays africains, dix ans après, dans la préface de l’édition de 1964, on constate selon Cheikh Anta Diop, ‘l’absence de traces de haine et de racisme à rebours’. Mais si Senghor prône l’édification d’une ‘Civilisation de l’Universel’ constituée des différences nécessaires et complémentaires de tous les peuples de la terre, sans exclure explicitement une ouverture généralisée, Cheikh Anta Diop accorde la priorité à l’indépendance nationale et au panafricanisme. Pour lui, il s’agit de bâtir un Etat fédéral d’Afrique noire sur la base de fondements économiques et culturels, en s’inspirant notamment du foyer originel de l’Egypte nègre, d’où proviennent les populations d’Afrique.
Cernant le panafricanisme, Senghor a une vision plus réaliste, car il ne s’agit pas pour lui de procéder à une intégration immédiate et décisive, en raison de nombreux facteurs de division : la diversité et l’hétérogénéité ethniques, la contradiction des intérêts, les querelles de puissance et de leadership, la ‘realpolitik’ sur le plan international, le système des blocs : anglophone, lusophone, francophone ; Afrique du nord, Afrique subsaharienne etc. Il s’agit alors, pour lui, de construire une intégration progressive et médiate par ‘cercles concentriques’ à travers des compromis dynamiques. C’est ce à quoi nous assistons aujourd’hui, avec la constitution et la construction des ensembles sous-régionaux : Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ; Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ; Union douanière des Etats d’Afrique Centrale (Udeac) ; South African Development Community (Sadec), etc.
En définitiv,e la lecture combinée des conceptions de la négritude chez Senghor, Césaire et Cheikh Anta Diop révèle, au-delà des nuances, des différences et des divergences, une même trame de fond qui consiste en la défense et en l’illustration de l’identité culturelle africaine, lequel combat replacé dans son contexte, en même temps qu’il déconstruisait l’idéologie coloniale, permettait aux africains de se réfléchir comme étant tout à fait capables de s’assumer et d’assumer les responsabilités qui devaient s’attacher à l’indépendance nationale, et à la création de nouveaux Etats. Cependant, plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la négritude, notamment celle de Wolé Shoyinka, qui pragmatique comme les anglo-saxons savent souvent l’être, estimait qu’’un tigre ne crie pas sa tigritude, il tue sa proie’, oubliant peut-être, par là, que l’action humaine pour être efficace a toujours besoin d’être orientée, pensée et planifiée, même si le penseur doit se garder de n’être qu’un penseur. Car, comme le disait Karl Marx, ‘les philosophes n’ont fait jusqu’ici qu’interpréter le monde de différentes manières, il s’agit maintenant de le transformer’.
Au demeurant, une théorie quelles que soient sa cohérence interne et son intelligibilité harmonieuse et agréable à l’esprit, ne vaut que par rapport à ce que les hommes en font, compte tenu de leurs intérêts, de leurs qualités et de leurs défauts, de leurs limites et de leurs mérites, des ressources dont ils disposent, et des contraintes auxquelles ils sont confrontées. Dans tous les cas, au regard du désenchantement multiforme qui a suivi cette période d’euphorie et de narcissisme africanisant exacerbé, l’Afrique, plusieurs décennies après, bat encore de bien tristes records. Au-delà de la victimisation dépendantiste fondée sur l’iniquité des rapports économiques internationaux, quelles sont les responsabilités de l’Afrique et des africains eux-mêmes dans cette faillite multiforme ? Comment galvaniser les élites et les peuples africains pour une insertion stratégique du continent dans la mondialisation ?
Maurice Soudieck DIONE Maîtrise en droit public Doctorant en Science politique Centre d’Etude d’Afrique Noire Iep Bordeaux. momzolito@yahoo.fr
1 - Mohamadou KANE, ‘Négritude et littérature’, in Colloque sur la Négritude, Dakar, 12-18 avril 1972, p. 62.
2- Léopold Sédar SENGHOR, Négritude, Arabisme et Francité, Beyrouth, 1967, p. 3.
3- Idem p. 4.
4- Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1956, p. 70.
5 - Léopold Sédar SENGHOR, Nation et voie africaine du socialisme, in Liberté II, Paris, Seuil, 1971, p. 296.
6 - Léopold Sédar SENGHOR, La poésie de l’action, Paris, Stock, 1980, p.p. 182-183.
7 - Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Op. Cit., p. 61. 8 - Cheikh Anta DIOP, L’unité culturelle de l’Afrique noire, Présence Africaine, 1959, p. 198.
9 - Cheikh Anta DIOP, Nations nègres et culture, TOME 1, Présence Africaine, 1979, p. 204-287.
10 - Idem p.31.
11 - Idem p. 28.
12 - Cheikh Anta DIOP, Alerte sous les tropiques, Articles 1946-1960, Culture et développement en Afrique noire, Présence Africaine, 1990, p. 48.
13 - Idem p. 47.
14 - Idem p. 48.
15 - Idem p. 48.
16 - Aimé CESAIRE, Cahier d’un retour au pays natal, Op. Cit., p. 41.
17 - Idem p. 85.
18 - Idem p. 83.
19- Lire Aimé CESAIRE, La tragédie du Roi Christophe, Paris, Présence Africaine, 1963.
soure ; walfadjiri

 Actualités
Actualités




















![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



