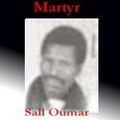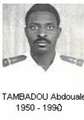2. Réflexion sur L’âge d’homme de Michel LEIRIS: sujet proposé à des agrégatifs, à Paris, en 2004. Dissertation rédigée en décembre 2004.
*** *** ***
PREMIER RECIT DE VIE :
Auteur : Baylaa KULIBALI
Titre : Nguurndam Tumaranke (= La vie de l'émigré)
Editions Binndi e jannde, 1991 (1983 : 1ère édition).
Préface de MurtuDo.
NB : Je cite abondamment le récit de vie de M KOULIBALY ; mais ceux qui ne lisent pas le pulaar peuvent bien se passer des citations, qui ont une fonction purement illustrative.
*** *** ***
Nguurndam Tumaranke est le récit de vie de Bayla Koulibaly , natif d’Horkadiéré , village du Fouta sénégalais qui partage le sort des autres villages de la vallée du Fleuve Sénégal, qui est de subir durement le contrecoup de la sécheresse et ses corollaires : famine, exode rural, émigration. Depuis que la pluie, offrande du ciel naguère généreusement offerte aux habitants du Fouta, se fait rare, le sauve-qui-peut semble gagner la région, dont la quasi-totalité des jeunes sont désormais condamnés à l’errance de par le monde, à la recherche de leur subsistance. Dans cette contrée où l’émigration est devenue, depuis belle lurette, une institution, à défaut de « téter le sein de la mère patrie », les jeunes le quittent pour un ailleurs lointain : la Côte-d’Ivoire, le Congo, le Gabon, l’ex-Zaïre ; mais aussi l’Occident, en particulier la France, où certains foyers d’immigrés recréent les villages du Fouta.
Aussi, Bayla Koulibaly, fils de paysan vivant dans le paysage asséché et désolé du Fouta, finit-il, à l’instar des autres jeunes déterminés à émigrer, par ne plus prendre son mal en patience et par s’en ouvrir à ses parents -comme il est d’usage en cette circonstance- pour avoir leur assentiment et recueillir leurs prières, viatique incomparable pour accomplir son « aventure » sous de bons auspices:
« Nyande aljuma, noddumi neene am e baaba am, mbiimi : « Nyande aset, hoore biir, miDa yiDi Dannaade, sabu giYam’en fof Danniima. Miine ne, miDa Yeewoya arsugu am. » Baaba am yunnginii haa juuti, wii : « Yoo Alla wad jaaYnde… ». Neene am, gite mum mberlii gonDi ».
Bayla Koulibaly campe d’abord son récit par l’évocation d’Horkadiéré, où son enfance romantique, au milieu des activités saisonnières qui déterminent la vie de son village, est partagée par des activités sportives (lutte traditionnelle) et ludiques, joutes verbales que se lancent jeunes filles et garçons pour exalter, sur un mode courtois, l’amour du bien aimé ou de la bien aimée :
« So min njima yelloo, min mbi’a :
Eey yelloo yelloo
Sinno yelloo ko jaNde
Tawannoo mi dursii
Aan hey kaari
MiijoDaa Kaari, giDel maa
Tinno diw diwngo lella
Haa mbaDtaa yahdu doonyoo. »
Cette description édénique de son « royaume d’enfance », trop brève pour que le lecteur puisse la savourer à satiété, s’arrête promptement pour céder la place au récit de voyage infernal.
Bayla Koulibaly raconte, de manière pathétique, comment, un beau jour, au milieu des pleurs de sa famille, il a quitté Horkadiéré, où, entre une terre aride délaissée par la pluie et le métier à tisser (activité économique subsidiaire, aussi stérile que la sécheresse) l’adolescent qu’il était devenu se sentait de plus en plus à l’étroit. Parti de bonheur de Horkadiéré , Bayla Koulibaly n’a de répit qu’à la tombée de la nuit, dans un village soninké où il interrompt enfin son épuisante marche et demande à une famille un gîte pour dormir. L’hospitalité refusée à Bayla, prié d’aller passer la nuit à la mosquée, est son premier baptême de feu d’exilé :
« Nyallumi yahde haa hiiri. Ngarmi e galle, mbiimi : « KoDo Alla ina ndaara to waali haa janngo. » Be mbii kam e sooninkoore : « Ndaga misiida ! » Nyande mum nganndumi mi wonii tumaranke. »
Le lendemain, dès le lever du jour, cap sur Bakel ; le voici enfin à Kidira, à la frontière sénégalo-malienne, où il prend un train pour fouler le sol ivoirien.
En Côte d’Ivoire, Bayla Koulibaly, qui vit dans un grand dénuement, pense à ses parents qui meurent de faim au Fouta et rumine quotidiennement son chagrin d’indigent émigré. Un évènement douloureux va le résoudre à quitter le pays d’Houphouët Boigny, très peu hospitalier à son égard. Un jour, pendant qu’il vend des lunettes sous un manguier, une branche de l’arbre tombe malencontreusement sur son petit commerce de quarante lunettes et en casse onze. Contrarié par ce malheureux incident qui fait voler en éclat son rêve de rembourser une somme qu’on lui a prêtée, Bayla Koulibaly jette la branche sur la voie publique. Cette infraction lui vaut d’être emprisonné avec des bandits de grands chemins dans une cellule où les détenus pataugent dans une mare d’urine et où ils font également leurs besoins. Les visites des policiers pour se relayer donnent systématiquement lieu à une séance de « correction », avec une violence, pour le moins, étrange : de quoi déstabiliser Bayla Koulibaly, profondément choqué par ce traitement, aussi indigne que disproportionné.
Libéré des serres de la police, les habits couverts d’excréments, une grande délégation de mouches, toute heureuse de découvrir l’homme qui au centimètre carré est le plus entartré de selles, ne se fait pas prier pour l’escorter jusqu’à chez lui. A son arrivée, tous ses proches sont en émoi et partagent son deuil. Venues le consoler, les femmes éclatent en sanglot ; les hommes, tout aussi remués, peinent à contenir leurs larmes:
« Coofe Dee keBa min e kolBuli. WoDBe kuwa e tuubaaji mum’en (…) KamBe reenooBe galle polis oo, jontaaDo fof so arii, YeBtan karawaas, naata nder kasoo hee, fiya min haa tampa, yalta (…) Nde njaltumi ndee, tuuba am baa, e sabandoor am oo, e hoore ndee fof, ina luuBa dus kuudi, ina sorba coofe. Buubi ndewi e am ina cawla. Nde njettiimi galle am, rewBe piyi daaDe, ngoni e woyde ; worBe, moni fof gite mum mberlii gonDi. RewBe caggini barmeeji ndiyam, Be nawi mi taarodde. Tuuba am baa, e sabandoor am oo, e paDe am Dee, Be mberlii e nder suturo. » pp 23-24.
Désormais, une décision est prise : il ira sous des cieux plus cléments. Ce sera coûte que coûte la France, où il pourrait, de surcroît, rejoindre les ressortissants de son village. Bayla Koulibaly saisit la première occasion pour quitter la Côte-d’Ivoire. Après un court séjour sans accroc au Niger, le voilà en Algérie, en terre inconnue : chaque jour, il fait la manche à la mosquée et, la nuit tombée, il déniche un abri de fortune en se faufilant dans des cartons ou dans quelque barrique providentielle pour avoir un semblant de sommeil réparateur. Dès qu’il entend la voix du muezzin appeler à la prière de l’aube, il se rend instantanément à la mosquée pour mendier :
« mi yeloo, mi wi’a : « Lillaahi warasuulihii ! » Bee mbirtoo mi Biinya ; Beya cakkoo mi ; Be mbi’a mi : « Inta muslim ? » Mi wi’a : ‘Wallaahi ! » Be mbi’a : « Qul hamdu lillaah. » Mi jannga Faatiya. Be mbi’a : « Haaja muslim. » Bee cakkoo mi mbuuDu ; Beya cakkoo mi buuDi DiDi walla tati. (…) So min njuulii geeYe, deenoowo jamaa oo arii uddude, mi yalta, mi naata e nder kartoNaaji, walla nder barille julDe ha mi nana daande salaatu, mi doga faade jamaa »
Entre les sarcasmes des uns et les quolibets des autres, notre héros picaresque pour qui le mot honneur n’a plus aucun sens, a désormais acquis de ses aventures une expérience pour apprendre à vivre dans des milieux hostiles. C’est à un Algérien, qui le présente à son père comme un pauvre musulman sénégalais que la misère a réduit à la mendicité, qu’il doit la résolution ponctuelle de ses problèmes, non sans un test préalable de récitation coranique pour authentifier qu’il est réellement musulman: la « Fatiha » (« Le Prologue »:1) et la sourate « al-massad (« Les Fibres » : 111) », que Bayla appelle « Tabbati yadaa », du nom du premier verset de ladite sourate. Engagé comme planton dans le commerce du père de l’Algérien, il économise pauvrement jusqu’au petit sou qu’il gagne pour réaliser son objectif d’arriver en France.
Arrivé à Marseille au bord d’un bateau, Bayla Koulibaly, qui se fait refouler sans autre forme de procès en Algérie, voit son mirage hexagonal fondre comme neige au soleil. Les autorités consulaires du Sénégal n’ayant pas régularisé son séjour en Algérie, une notification de quitter le territoire algérien dans le plus bref délai lui est signifiée.
Bayla s’infiltre clandestinement en Tunisie, où il vit des aventures pour le moins loufoques .Tenaillé par la faim qui dure depuis quelques jours, Bayla , tenté un moment par le vol, prend le risque de commander un mets dans un restaurant, quoique sans le moindre sou. Pris à partie par une dizaine de policiers résolus à le redresser -« droit comme une règle »-, Bayla doit sa délivrance à un commissaire qui, à l’écoute de son touchant récit, tempère la furie de ses « enragés » agents. Par mansuétude, autant que par solidarité islamique, celui-ci s’acquitte en personne de la note pour qu’il soit quitte envers le restaurateur, lui donne de l’argent et le conduit auprès de l’ambassadeur de son pays pour qu’il puisse regagner le Sénégal sans encombre. L’ambassadeur le réprimande vertement, mais lui donne, tout de même, de l’argent pour parer au plus urgent. Bayla s’éclipse, sans quitter toutefois le sol tunisien, et s’installe dans un modeste hôtel. Au bout de quelques jours, il n’a plus aucun « rond » et est chassé de l’auberge.
Bayla est, à nouveau, réduit à la mendicité pour subsister, en un vrai personnage picaresque évoluant sur les strates inférieures de la société, obsédé constamment par sa survie, que ses mésaventures compromettent souvent. Totalement désespéré, Bayla pense, plus d’une fois, à se donner la mort. Ne voyant pas d’issue de secours pour sortir de son cercle infernal, il écrit même au Sénégal pour informer les parents de sa fiancée qu’il s’estime incapable d’honorer ses engagements de mariage avec leur fille.
Sans travail et le ventre creux, c’est devant l’auberge où il a été chassé qu’il choisit de quémander l’aumône aux clients qui le fréquentent et de porter leurs bagages pour avoir une pièce salutaire qui soulage sa faim. A la longue, l’inoffensif « miskiin » (« pauvre »), « muslim » (« musulman »), gagne la confiance du propriétaire de l’auberge, qui l’emploie comme veilleur de nuit. Cette opportunité inattendue est une planche de salut pour Bayla, qui n’a pas attendu d’avoir plus que le montant de son billet pour tenter, une nouvelle fois, de pénétrer en France. Après avoir été enfermé pendant une semaine, le voici, à nouveau, refoulé ! C’est le retour à la case départ ! Bayla retrouve ses fidèles compagnons : la faim, la soif, la misère.
La troisième tentative d’entrer en France se fera via l’Italie. Avec sa mine de déterré qui sent la vermine, les contrôleurs préfèrent commencer leur contrôle par les autres passagers, qui n’ont pas cette halène repoussante à couper le souffle. Lorsqu’il montre son passeport sans visa, le train en partance à Paris est sur le point de démarrer : le contrôleur lui remet ses papiers irréguliers en connaissance de cause, pressé, sans doute, de se détourner de ce « galérien » qui ne sent pas le parfum. Arrivé à la station parisienne « Gare de Lyon », les couches de saleté superposées sur sa peau crasseuse et sa faim de loup qui lui donne l’air hagard des fous font fuir tous les passagers à qui il veut demander des renseignements. Seul un enfant, vierge de tout préjugé, consent à l’aider à retrouver l’adresse qu’il lui a montrée : Foyer de Sedaine, dans le onzième arrondissement, où habitent les ressortissants de son village. Quoique heureux que la modique somme qu’ils lui ont envoyée ait réussi à le faire venir, ceux-ci découvrent un jeune homme qui porte des stigmates d’un long séjour en enfer. Totalement recouvert de dartres, tout « coup » de savon sous la douche lui détache de « lanières » entières de « peau morte » ! Cette mue dure une semaine entière !
« Naatmi e duusu, miDa lootoo. So mi yiggii jampe e Bandu am, huftoo lare : nguru maayngu nguu ina nyoomtoo. Haa tampumi faftude nguru, ngartumi. Be mbii : « Hii ! ko Dee daare-daare ngoni ? » Mbiimi : « ko nguru maayngu nguu faftotoo. » Yonntere haa dawdi e naange, mi yaltaani. Nyande fof mi lootoo, haa nguru maayngu nguu gasi… »
La dernière partie (les deux derniers chapitres) de Nguurndam Tumaranke raconte les problèmes d’intégration de Bayla en France, qui ne parle pas un traître mot français et vit dans la promiscuité des foyers d’immigrés, à la périphérie de la société française. Handicapé par l’ignorance de la langue et des codes culturels français, Bayla raconte ses vains efforts pour séduire les Françaises et, sans pudibonderie aucune, toutes ses désobéissances aux usages de la communauté immigrée pulaar, notamment la consommation de l’alcool dans des boîtes de nuit et la fréquentation des « femmes payantes » pour adoucir sa libido d’immigré en mal de femme :
« so mi haaBii, mi yaha to rewBe yoBeteebe too. So mi yoBii debbo, o wi’a o lelotaako e dow ndaDDudi, ma o Beydanee kaalis. O jooDotoo ko e soBBundu ndaDDudi, miin mi daroo e leydi. So miDa wonda e makko, mi wona e taataade. Hono hojom, taw o fawii juuDe makko e Becce am, o yerYa mi. Mi yalta, Bernde am ina harYita. Mi heBaani debbo, kaalis am bonii… »
Ce dernier point, qui banalise la fréquentation de celles qui, il est vrai, pratiquent « le plus vieux métier de monde », est, sans aucun doute, le sujet le plus sensible de toute la confession, lorsque l’on mesure la mise à mort sociale qu’elle induit: se dévoiler, dans toute sa nudité, sous le regard indiscret et inquisiteur de la communauté, encline à percevoir tout acte individuel « déviant » (à fortiori s’il est brandi et proclamé) comme une « atteinte à son homogénéité ». Dans le contexte culturel qui est celui de Bayla Koulibaly où « le moi est haïssable » (cf. PASCAL), l’on ne peut comprendre cet étalage (qui, en outre, ne montre que la face « honteuse » et « méprisable » de l’auteur sur le plan social), que si l’on met le doigt sur l’aspect fondamental de Nguurndam Tumaranke, celui d’être une catharsis, laquelle s’accommode très peu de circonlocutions oratoires et autres euphémismes dissimulateurs. A ce titre, la confession de Bayla Koulibaly a d’abord et avant tout une valeur thérapeutique et s’inscrit dans l’urgence, celle d’un homme que la vie n’a pas beaucoup ménagé et qui, de ce fait, avait un impérieux besoin de confier à la page blanche la petite misère que fut sa vie d’immigré pour guérir d’une souffrance longtemps intériorisée :
« GeDe keewDe goodDe e neDDo, De keewaani haaleede e hunuko, kono ko De tiiDDe neDDo. So wonki wuuraani, Bernde nyawan, hakkille layataa, miijo raBBiDan, ngaandi nyolan. »
Cette confession sous la forme d’un livre n’eût guère été possible si Bayla Koulibaly, analphabète jusqu’à l’âge adulte (et n’ayant jusque-là comme tout bagage culturel que quelques sourates du coran retenues à l’aveuglette), n’avait requis l’aide de l’association « JaNde e Pinal Pulaar » pour être scolarisé en pulaar. Partagé entre le travail exténuant, qui est le lot des immigrés, et les nombreuses sollicitations de sa communauté villageoise établie en France, Bayla Koulibaly n’en a pas mois poursuivi opiniâtrement son objectif de posséder l’écriture jusqu’à devenir enseignant de pulaar et écrivain : beau triomphe d’une praxis scripturaire, dont une scolarisation très tardive semblait radicalement s’opposer à la parturition ! Belle victoire sur le sort que cette détermination à aller toujours jusqu’aux limites de ses forces, devant des obstacles qui peuvent faire abdiquer plus d’un homme déterminé !
Plus que les aventures de Bayla Koulibaly, ce qui importe davantage dans Nguurdam Tumaranke, c’est donc et avant tout « l’aventure d’une écriture » (cf. Jean RICARDOU) qui a réussi à polir une statue de bronze à un homme obscur et déshérité que la vie avait tout fait payer au centuple .
Notes de lecture de Mohamadou Saidou TOURE (Thierno)
Paris, 11 mai 2005
*** *** ***
SECOND RECIT DE VIE :
NB : à propos de la problématique de l’écriture comme un « anti-destin » (André Malraux), je me permets de compléter mon compte rendu du livre de Bayla Koulibaly par une réflexion sur un autre récit de vie, L’âge d’homme de Michel Leiris, que je projetais d’étudier en classe.
Il s’agit d’une dissertation qui porte sur l’œuvre précitée, qui a été donnée en devoir, en décembre 2004, à des candidats à l’agrégation de Lettres modernes, à Paris. Traiter la dissertation exigeait de moi une lecture plus attentive de l’œuvre, étant donné mon projet pédagogique d’exploiter le roman de Michel LEIRIS en classe. Ayant sacrifié aux exigences académiques de l’exercice, je demande des excuses à mes honorables lecteurs si le style de ma dissertation s’en est trouvé « précieux ».
Sujet donné en devoir à des agrégatifs, à Paris, en 2004:
« L’âge d’homme est un regard lucide par lequel le JE, pénétrant son « obscurité intérieure », découvre que ce qui en lui regarde, ce n’est plus le JE, « structure du monde », mais déjà la statue monumentale, sans regard, sans figure et sans nom : le IL de la Mort souveraine. »
Maurice BLANCHOT.
I). INTRODUCTION :
L’entreprise autobiographique, qui fait coïncider dans une commune identité le sujet et l’objet de l’écriture, est placée sous le signe de la réflexivité. Pourtant, selon Blanchot, l’introspection, exposant le « je » de L’âge d’homme aux rets de son image spectrale et brouillée, lui signifie la vanité de l’entreprise autobiographique. Incapable d’accéder à la vérité de son moi profond, le « je », « structure du monde » submergée par la complexité torrentielle et contingente de l’existence, fait l’expérience tragique de l’aphasie.
Sans doute observe-t-on dans L’âge d’homme les balbutiements du « je » à se dire ; mais, il n’en explore pas mois d’autres stratégies, transcendantes et salutaires.
Comment L’âge d’homme, échappant à l’impasse tragique de se dire, conjure-t-il la contingence et la finitude du « je » assumant l’énonciation autobiographique ?
II). DEVELOPPEMENT :
A). 1ère.partie :
D’entrée de jeu, « l’ être-au-monde » (cf.HEIDEGGER) du « je » paraît placé sous le signe du danger, le cadre spatio-temporel dans lequel il se meut annihilant, dans un mouvement violent d’assimilation, toute velléité d’expression individuelle et personnelle de soi. Contenu dans un monde immense et infini qui le broie, le « je » apparaît comme un tentacule arrimé au TEMPS, qui l’entraîne inexorablement dans sa marche : « je demeure encastré dans ces Ages de la Vie et j’ai de moins en moins l’espoir d’échapper à leur cadre (au moins de par ma volonté), enchâssé que je suis dans leur boiserie rectangulaire, telle une mauvaise daguerréotypie couverte ça et là de taches de moisissure irisées sur les bords et pareilles aux teintes d’arc-en-ciel que la décomposition peint aux visages des noyés. » (page33)
« Noyé [e] et « encastré » [e] dans le Temps, l’individualité du « je » se dilue dans cet organisme macroscopique, dont les rouages essentiels lui échappent. Surgit, dès lors, immanquablement un écueil : comment le « je » peut-il dire son moi si celui-ci est englué fatalement dans une existence trouble, « sans figure », « sans nom » ?
L’aliénation du « je » au Temps est d’autant plus douloureuse, qu’elle se double d’une inféodation à l’ESPACE, cadre résolu également à ne le réduire qu’à un tentacule synecdochique insignifiant et sans autonomie : « sans être capable de trouver le mot de l’énigme, je notai du moins une coïncidence, impliquant un parallélisme entre deux séries de faits : ce qui se passait dans mon corps et les évènements extérieurs. » (page 38)
Par un effet de vases communicants, la tragédie inscrite au cœur de l’existence fait irruption, de manière transitive, dans l’intériorité du « je », qui se voit déboulonner et suppléer par « la statue monumentale » et « souveraine » de l’expérience tragique : « Ainsi va la vie : un jour ma femme à moi me regardera de ses yeux consternés ; je souffrirai d’un cancer ou bien je serai estropié. Rien à faire ! (…) car le sort n’est qu’un usurier ! » (page112)
Cette recatégorisation du sujet en objet, jouet de l’Histoire (qui lui dicte ses lois) est un coup dur asséné à l’autobiographe, qui se retrouve ainsi déboussolé face à son « obscurité intérieure » : « Me voici loin de ce que je proposais de raconter (…) A mesure que j’écris, le plan que je m’étais tracé m’échappe et l’on dirait que plus je regarde en moi-même, plus tout ce que je vois devient confus. » (page:127)
L’âge d’homme, « regard lucide » sur la tragédie de l’existence, signe donc, à certains égards, la défaite du SUJET.
Phrase de transition pour passer à l’antithèse:
En réalité, cette incapacité du « je » à saisir les « linéaments [de son être] qui s’avèrent permanents » (page 27) n’est pas rédhibitoire : il s’évertue à transformer le lien synecdochique qui le liait à l’expérience tragique du monde (dont il a conscience de n’être qu’une excroissance parasitaire) en une relation métonymique, qui est plus distanciée.
B). 2ème.partie :
Pour se ménager un espace de liberté, l’autobiographe tente, sinon de s’extraire, du moins de se défaire de l’emprise du « hic » (le « ici ») et du « nunc » (le « maintenant »), régis par Thanatos, « le il de la Mort souveraine ». Aussi, pour exorciser ses pulsions de mort, jette-t-il son dévolu sur le détour ou l’ailleurs : scénique, onirique, mythique etc.
Monde autonome, apte, par le procédé de mise en abyme, à représenter la tragédie de l’existence, le théâtre présente le double avantage de permettre à l’autobiographe, d’une part, de s’extirper souverainement de la gangue du tragique, réduit, en l’occurrence, à une matière scénique ; de lui permettre, d’autre part, d’apprivoiser ce tragique, grâce notamment à « l’illusion référentielle » (cf. Michael RIFFATERRE), qui suscite chez lui un pathos, qui est une expérience, plus ou moins directe, d’une mort vécue et, partant, démystifiée ; d’où la valeur conjuratoire et la portée transcendante du théâtre : « j’avais encore une notion si l’on veut magique du théâtre (…) noble entre tous, à cause du caractère de gravité tragique de ce qu’on y représentait. »
(p 45)
Pour polir sa statue et la protéger contre l’effritement de l’existence, l’autobiographe recourt aussi au rêve, lequel, contigu au monde sans être contenu dans son univers clos, débouche sur une combinatoire de tous les possibles, où l’énonciateur de l’autobiographie retrouve l’initiative, perdue, de la création.
Le rêve, vision ésotérique propre à susciter une religiosité épurée, telle une ascension dans « le monde intelligible » (PLATON), permet à l’autobiographe d’accéder à la quintessence des choses, loin de toute flétrissure de la contingence : « Derrière cette chaîne de montagnes, il y encore un désert, limité lui-même par une chaîne de montagnes masquant un troisième désert, et ainsi de suite. C’est l’ensemble de ces déserts limités qui constitue le vrai désert, le DESERT en soi. » (page135, extrait d’un récit de rêve)
C’est tout de même la démarche mythographique qui, dans la mise à distance comme dans la maîtrise des pulsions de mort, se taille la part de lion pour redorer le blason du « je », victime de son éviction de la sphère de la parole et qui ploie sous le faix de la contingence. Que ce soit sur le mode de l’assassinat (Judith) ou du suicide (Lucrèce) ou de la combinaison des deux (Cléopâtre), les personnages antiques cités incarnent des pulsions mortifères, dont la convocation sous la forme d’une réalité quintessenciée, le mythe, permet de palper métonymiquement la mort et de l’exorciser.
Récapitulatif de la thèse et de l’antithèse pour que le lecteur puisse se repérer
Si la mort, telle une « métaphore obsédante » (cf. Charles MAURON), innerve tout le texte leirisien et semble inhiber jusque l’énonciation autobiographique, en revanche, le « je », découronné de sa subjectivité par la « statue monumentale » de Thanatos, n’en explore pas moins une issue prométhéenne de secours, laquelle, le dotant d’une « volonté de puissance » (cf. NIETZSCHE), lui permet de s’évader dans l’ailleurs : le théâtre, le rêve et le mythe, procédés métonymiques de distanciation pour préserver l’intégrité individuelle du « je » et éclairer son miroir de soi .
Phrase de transition pour passer à la troisième partie:
Or, l’ailleurs et le détours, vains palliatifs, confrontent brutalement l’autobiographe à l’irréductibilité de la contingence, qu’il croyait pouvoir esquiver : « En tous points, je suis semblable au petit-bourgeois qui se donne l’illusion d’être Sardanapale en allant au bordel (…) Comment oserais-je me regarder si je ne portais pas, soit un masque, soit des lunettes déformantes? » (page153) ; d’où l’urgence de sortir des ces apories.
C). 3ème. Partie : Déduction et dépassement de la thèse et de l’antithèse
Il faudrait donc distinguer deux niveaux de référence : celui, incontournable et irréductible du monde (duquel LEIRIS, sujet mortel, ne peut échapper) et celui du livre, réceptacle de mots sublimes, où le « je » écrivant tisse et recompose un monde infini et atemporel.
Le détours et l’ailleurs, s’ils sont donc proscrits dans le monde réel (informé et ordonnancé par l’irréversibilité du tragique), ont, en revanche, toute leur place dans l’architecture interne du livre, taraudé par un souffle esthétique qui sillonne, spatialise et sculpte à sa guise L’âge d’homme, les divagations thématiques étant un alibi scripturaire où le « je » retrouve la plénitude de son moi par l’acte personnel de création littéraire : « les thèmes que j’avais cru primitivement distinguer se révèlent inconsistants et arbitraires, comme si ce classement n’était qu’une sorte de guide-âme abstrait, voire un simple procédé de composition esthétique. » (page127)
De cette fonction démiurgique du langage littéraire résulte une foi totale à la vérité du signe linguistique, antidote contre la dégénérescence du dire ; d’où le cratylisme, simulacre sémiologique dans le monde réel, mais lexicographie légitime dans la géographie du livre, qui est un espace de création : « Il s’enfonçait dans la poitrine un long kriss à lame (…)le mot « suicide » lui-même, dont j’associais la sonorité avec l’idée de l’incendie et la forme serpentine du kriss (…) Il y’a l’S dont la forme autant que le sifflement me rappelle, non seulement la torsion du corps près de tomber, mais la sinusoïdalité de la lame ; UI, qui vibre curieusement et s’insinue, si l’on peut dire, comme le fusement du feu (…) cide, qui intervient enfin pour tout conclure, avec son goût acide impliquant quelque chose d’incisif et d’aiguisé. » (page29).
Dans l’espace pérenne qu’est le livre, le cratylisme, loin d’être une opacification du langage, relève plutôt de l’ « imaginaire » le plus profond de l’autobiographe, de son idiolecte le plus intime, par lequel il « crée le monde à son image » (cf. La Bible, Genèse : I, 23), dans une épiphanie poétique où la confession assure sa propre pérennité : « la poésie avait remplacé pour moi le mysticisme (…) je pensais que par l’usage lyrique des mots, l’homme a le pouvoir de tout transmuer. J’accordais une importance prépondérante à l’imaginaire, substitut du réel et du monde qu’il nous est loisible de créer (…) Je croyais qu’au moyen des mots il est possible de détecter les idées et que l’on peut ainsi, de choc verbal inattendu en choc verbal inattendu, cerner l’absolu de proche en proche et finalement, à force de déclencher dans tous les sens des idées neuves, le posséder. » (pages181-182)
III). Conclusion :
Lié au monde par une relation synecdochique, le « je » subit transitivement la contingence et la fragilité qui y sont à l’œuvre. Affecté d’aphonie par son éviction de la sphère du dire, où il est anéanti par la « statue monumentale » de Thanatos, le « je » n’en conjure pas moins sa hantise de la mort par l’évasion à travers un ailleurs scénique, onirique et mythique.
Prenant conscience de l’inanité du subterfuge de l’ailleurs, l’énonciateur de l’autobiographie, mû par un élan prométhéen de dompter et de maîtriser la fragilité du monde, affronte frontalement le « ici » et le « maintenant » dans l’espace fortifié et pérenne du chef-d’œuvre littéraire où le verbe, incantatoire, atteint à l’Absolu et sa voix intime à une confession universelle.
La hantise de la mort qui inhibe le « je » n’est donc, dans L’âge d’homme, que le « moment faible d’une progression dialectique » dont l’étape ultime élève l’autobiographie à un « anti-destin » (Malraux).
Mohamadou Saidou TOURE (Thierno)
Paris, dissertation rédigée en décembre 2004.
*** *** ***
PREMIER RECIT DE VIE :
Auteur : Baylaa KULIBALI
Titre : Nguurndam Tumaranke (= La vie de l'émigré)
Editions Binndi e jannde, 1991 (1983 : 1ère édition).
Préface de MurtuDo.
NB : Je cite abondamment le récit de vie de M KOULIBALY ; mais ceux qui ne lisent pas le pulaar peuvent bien se passer des citations, qui ont une fonction purement illustrative.
*** *** ***
Nguurndam Tumaranke est le récit de vie de Bayla Koulibaly , natif d’Horkadiéré , village du Fouta sénégalais qui partage le sort des autres villages de la vallée du Fleuve Sénégal, qui est de subir durement le contrecoup de la sécheresse et ses corollaires : famine, exode rural, émigration. Depuis que la pluie, offrande du ciel naguère généreusement offerte aux habitants du Fouta, se fait rare, le sauve-qui-peut semble gagner la région, dont la quasi-totalité des jeunes sont désormais condamnés à l’errance de par le monde, à la recherche de leur subsistance. Dans cette contrée où l’émigration est devenue, depuis belle lurette, une institution, à défaut de « téter le sein de la mère patrie », les jeunes le quittent pour un ailleurs lointain : la Côte-d’Ivoire, le Congo, le Gabon, l’ex-Zaïre ; mais aussi l’Occident, en particulier la France, où certains foyers d’immigrés recréent les villages du Fouta.
Aussi, Bayla Koulibaly, fils de paysan vivant dans le paysage asséché et désolé du Fouta, finit-il, à l’instar des autres jeunes déterminés à émigrer, par ne plus prendre son mal en patience et par s’en ouvrir à ses parents -comme il est d’usage en cette circonstance- pour avoir leur assentiment et recueillir leurs prières, viatique incomparable pour accomplir son « aventure » sous de bons auspices:
« Nyande aljuma, noddumi neene am e baaba am, mbiimi : « Nyande aset, hoore biir, miDa yiDi Dannaade, sabu giYam’en fof Danniima. Miine ne, miDa Yeewoya arsugu am. » Baaba am yunnginii haa juuti, wii : « Yoo Alla wad jaaYnde… ». Neene am, gite mum mberlii gonDi ».
Bayla Koulibaly campe d’abord son récit par l’évocation d’Horkadiéré, où son enfance romantique, au milieu des activités saisonnières qui déterminent la vie de son village, est partagée par des activités sportives (lutte traditionnelle) et ludiques, joutes verbales que se lancent jeunes filles et garçons pour exalter, sur un mode courtois, l’amour du bien aimé ou de la bien aimée :
« So min njima yelloo, min mbi’a :
Eey yelloo yelloo
Sinno yelloo ko jaNde
Tawannoo mi dursii
Aan hey kaari
MiijoDaa Kaari, giDel maa
Tinno diw diwngo lella
Haa mbaDtaa yahdu doonyoo. »
Cette description édénique de son « royaume d’enfance », trop brève pour que le lecteur puisse la savourer à satiété, s’arrête promptement pour céder la place au récit de voyage infernal.
Bayla Koulibaly raconte, de manière pathétique, comment, un beau jour, au milieu des pleurs de sa famille, il a quitté Horkadiéré, où, entre une terre aride délaissée par la pluie et le métier à tisser (activité économique subsidiaire, aussi stérile que la sécheresse) l’adolescent qu’il était devenu se sentait de plus en plus à l’étroit. Parti de bonheur de Horkadiéré , Bayla Koulibaly n’a de répit qu’à la tombée de la nuit, dans un village soninké où il interrompt enfin son épuisante marche et demande à une famille un gîte pour dormir. L’hospitalité refusée à Bayla, prié d’aller passer la nuit à la mosquée, est son premier baptême de feu d’exilé :
« Nyallumi yahde haa hiiri. Ngarmi e galle, mbiimi : « KoDo Alla ina ndaara to waali haa janngo. » Be mbii kam e sooninkoore : « Ndaga misiida ! » Nyande mum nganndumi mi wonii tumaranke. »
Le lendemain, dès le lever du jour, cap sur Bakel ; le voici enfin à Kidira, à la frontière sénégalo-malienne, où il prend un train pour fouler le sol ivoirien.
En Côte d’Ivoire, Bayla Koulibaly, qui vit dans un grand dénuement, pense à ses parents qui meurent de faim au Fouta et rumine quotidiennement son chagrin d’indigent émigré. Un évènement douloureux va le résoudre à quitter le pays d’Houphouët Boigny, très peu hospitalier à son égard. Un jour, pendant qu’il vend des lunettes sous un manguier, une branche de l’arbre tombe malencontreusement sur son petit commerce de quarante lunettes et en casse onze. Contrarié par ce malheureux incident qui fait voler en éclat son rêve de rembourser une somme qu’on lui a prêtée, Bayla Koulibaly jette la branche sur la voie publique. Cette infraction lui vaut d’être emprisonné avec des bandits de grands chemins dans une cellule où les détenus pataugent dans une mare d’urine et où ils font également leurs besoins. Les visites des policiers pour se relayer donnent systématiquement lieu à une séance de « correction », avec une violence, pour le moins, étrange : de quoi déstabiliser Bayla Koulibaly, profondément choqué par ce traitement, aussi indigne que disproportionné.
Libéré des serres de la police, les habits couverts d’excréments, une grande délégation de mouches, toute heureuse de découvrir l’homme qui au centimètre carré est le plus entartré de selles, ne se fait pas prier pour l’escorter jusqu’à chez lui. A son arrivée, tous ses proches sont en émoi et partagent son deuil. Venues le consoler, les femmes éclatent en sanglot ; les hommes, tout aussi remués, peinent à contenir leurs larmes:
« Coofe Dee keBa min e kolBuli. WoDBe kuwa e tuubaaji mum’en (…) KamBe reenooBe galle polis oo, jontaaDo fof so arii, YeBtan karawaas, naata nder kasoo hee, fiya min haa tampa, yalta (…) Nde njaltumi ndee, tuuba am baa, e sabandoor am oo, e hoore ndee fof, ina luuBa dus kuudi, ina sorba coofe. Buubi ndewi e am ina cawla. Nde njettiimi galle am, rewBe piyi daaDe, ngoni e woyde ; worBe, moni fof gite mum mberlii gonDi. RewBe caggini barmeeji ndiyam, Be nawi mi taarodde. Tuuba am baa, e sabandoor am oo, e paDe am Dee, Be mberlii e nder suturo. » pp 23-24.
Désormais, une décision est prise : il ira sous des cieux plus cléments. Ce sera coûte que coûte la France, où il pourrait, de surcroît, rejoindre les ressortissants de son village. Bayla Koulibaly saisit la première occasion pour quitter la Côte-d’Ivoire. Après un court séjour sans accroc au Niger, le voilà en Algérie, en terre inconnue : chaque jour, il fait la manche à la mosquée et, la nuit tombée, il déniche un abri de fortune en se faufilant dans des cartons ou dans quelque barrique providentielle pour avoir un semblant de sommeil réparateur. Dès qu’il entend la voix du muezzin appeler à la prière de l’aube, il se rend instantanément à la mosquée pour mendier :
« mi yeloo, mi wi’a : « Lillaahi warasuulihii ! » Bee mbirtoo mi Biinya ; Beya cakkoo mi ; Be mbi’a mi : « Inta muslim ? » Mi wi’a : ‘Wallaahi ! » Be mbi’a : « Qul hamdu lillaah. » Mi jannga Faatiya. Be mbi’a : « Haaja muslim. » Bee cakkoo mi mbuuDu ; Beya cakkoo mi buuDi DiDi walla tati. (…) So min njuulii geeYe, deenoowo jamaa oo arii uddude, mi yalta, mi naata e nder kartoNaaji, walla nder barille julDe ha mi nana daande salaatu, mi doga faade jamaa »
Entre les sarcasmes des uns et les quolibets des autres, notre héros picaresque pour qui le mot honneur n’a plus aucun sens, a désormais acquis de ses aventures une expérience pour apprendre à vivre dans des milieux hostiles. C’est à un Algérien, qui le présente à son père comme un pauvre musulman sénégalais que la misère a réduit à la mendicité, qu’il doit la résolution ponctuelle de ses problèmes, non sans un test préalable de récitation coranique pour authentifier qu’il est réellement musulman: la « Fatiha » (« Le Prologue »:1) et la sourate « al-massad (« Les Fibres » : 111) », que Bayla appelle « Tabbati yadaa », du nom du premier verset de ladite sourate. Engagé comme planton dans le commerce du père de l’Algérien, il économise pauvrement jusqu’au petit sou qu’il gagne pour réaliser son objectif d’arriver en France.
Arrivé à Marseille au bord d’un bateau, Bayla Koulibaly, qui se fait refouler sans autre forme de procès en Algérie, voit son mirage hexagonal fondre comme neige au soleil. Les autorités consulaires du Sénégal n’ayant pas régularisé son séjour en Algérie, une notification de quitter le territoire algérien dans le plus bref délai lui est signifiée.
Bayla s’infiltre clandestinement en Tunisie, où il vit des aventures pour le moins loufoques .Tenaillé par la faim qui dure depuis quelques jours, Bayla , tenté un moment par le vol, prend le risque de commander un mets dans un restaurant, quoique sans le moindre sou. Pris à partie par une dizaine de policiers résolus à le redresser -« droit comme une règle »-, Bayla doit sa délivrance à un commissaire qui, à l’écoute de son touchant récit, tempère la furie de ses « enragés » agents. Par mansuétude, autant que par solidarité islamique, celui-ci s’acquitte en personne de la note pour qu’il soit quitte envers le restaurateur, lui donne de l’argent et le conduit auprès de l’ambassadeur de son pays pour qu’il puisse regagner le Sénégal sans encombre. L’ambassadeur le réprimande vertement, mais lui donne, tout de même, de l’argent pour parer au plus urgent. Bayla s’éclipse, sans quitter toutefois le sol tunisien, et s’installe dans un modeste hôtel. Au bout de quelques jours, il n’a plus aucun « rond » et est chassé de l’auberge.
Bayla est, à nouveau, réduit à la mendicité pour subsister, en un vrai personnage picaresque évoluant sur les strates inférieures de la société, obsédé constamment par sa survie, que ses mésaventures compromettent souvent. Totalement désespéré, Bayla pense, plus d’une fois, à se donner la mort. Ne voyant pas d’issue de secours pour sortir de son cercle infernal, il écrit même au Sénégal pour informer les parents de sa fiancée qu’il s’estime incapable d’honorer ses engagements de mariage avec leur fille.
Sans travail et le ventre creux, c’est devant l’auberge où il a été chassé qu’il choisit de quémander l’aumône aux clients qui le fréquentent et de porter leurs bagages pour avoir une pièce salutaire qui soulage sa faim. A la longue, l’inoffensif « miskiin » (« pauvre »), « muslim » (« musulman »), gagne la confiance du propriétaire de l’auberge, qui l’emploie comme veilleur de nuit. Cette opportunité inattendue est une planche de salut pour Bayla, qui n’a pas attendu d’avoir plus que le montant de son billet pour tenter, une nouvelle fois, de pénétrer en France. Après avoir été enfermé pendant une semaine, le voici, à nouveau, refoulé ! C’est le retour à la case départ ! Bayla retrouve ses fidèles compagnons : la faim, la soif, la misère.
La troisième tentative d’entrer en France se fera via l’Italie. Avec sa mine de déterré qui sent la vermine, les contrôleurs préfèrent commencer leur contrôle par les autres passagers, qui n’ont pas cette halène repoussante à couper le souffle. Lorsqu’il montre son passeport sans visa, le train en partance à Paris est sur le point de démarrer : le contrôleur lui remet ses papiers irréguliers en connaissance de cause, pressé, sans doute, de se détourner de ce « galérien » qui ne sent pas le parfum. Arrivé à la station parisienne « Gare de Lyon », les couches de saleté superposées sur sa peau crasseuse et sa faim de loup qui lui donne l’air hagard des fous font fuir tous les passagers à qui il veut demander des renseignements. Seul un enfant, vierge de tout préjugé, consent à l’aider à retrouver l’adresse qu’il lui a montrée : Foyer de Sedaine, dans le onzième arrondissement, où habitent les ressortissants de son village. Quoique heureux que la modique somme qu’ils lui ont envoyée ait réussi à le faire venir, ceux-ci découvrent un jeune homme qui porte des stigmates d’un long séjour en enfer. Totalement recouvert de dartres, tout « coup » de savon sous la douche lui détache de « lanières » entières de « peau morte » ! Cette mue dure une semaine entière !
« Naatmi e duusu, miDa lootoo. So mi yiggii jampe e Bandu am, huftoo lare : nguru maayngu nguu ina nyoomtoo. Haa tampumi faftude nguru, ngartumi. Be mbii : « Hii ! ko Dee daare-daare ngoni ? » Mbiimi : « ko nguru maayngu nguu faftotoo. » Yonntere haa dawdi e naange, mi yaltaani. Nyande fof mi lootoo, haa nguru maayngu nguu gasi… »
La dernière partie (les deux derniers chapitres) de Nguurndam Tumaranke raconte les problèmes d’intégration de Bayla en France, qui ne parle pas un traître mot français et vit dans la promiscuité des foyers d’immigrés, à la périphérie de la société française. Handicapé par l’ignorance de la langue et des codes culturels français, Bayla raconte ses vains efforts pour séduire les Françaises et, sans pudibonderie aucune, toutes ses désobéissances aux usages de la communauté immigrée pulaar, notamment la consommation de l’alcool dans des boîtes de nuit et la fréquentation des « femmes payantes » pour adoucir sa libido d’immigré en mal de femme :
« so mi haaBii, mi yaha to rewBe yoBeteebe too. So mi yoBii debbo, o wi’a o lelotaako e dow ndaDDudi, ma o Beydanee kaalis. O jooDotoo ko e soBBundu ndaDDudi, miin mi daroo e leydi. So miDa wonda e makko, mi wona e taataade. Hono hojom, taw o fawii juuDe makko e Becce am, o yerYa mi. Mi yalta, Bernde am ina harYita. Mi heBaani debbo, kaalis am bonii… »
Ce dernier point, qui banalise la fréquentation de celles qui, il est vrai, pratiquent « le plus vieux métier de monde », est, sans aucun doute, le sujet le plus sensible de toute la confession, lorsque l’on mesure la mise à mort sociale qu’elle induit: se dévoiler, dans toute sa nudité, sous le regard indiscret et inquisiteur de la communauté, encline à percevoir tout acte individuel « déviant » (à fortiori s’il est brandi et proclamé) comme une « atteinte à son homogénéité ». Dans le contexte culturel qui est celui de Bayla Koulibaly où « le moi est haïssable » (cf. PASCAL), l’on ne peut comprendre cet étalage (qui, en outre, ne montre que la face « honteuse » et « méprisable » de l’auteur sur le plan social), que si l’on met le doigt sur l’aspect fondamental de Nguurndam Tumaranke, celui d’être une catharsis, laquelle s’accommode très peu de circonlocutions oratoires et autres euphémismes dissimulateurs. A ce titre, la confession de Bayla Koulibaly a d’abord et avant tout une valeur thérapeutique et s’inscrit dans l’urgence, celle d’un homme que la vie n’a pas beaucoup ménagé et qui, de ce fait, avait un impérieux besoin de confier à la page blanche la petite misère que fut sa vie d’immigré pour guérir d’une souffrance longtemps intériorisée :
« GeDe keewDe goodDe e neDDo, De keewaani haaleede e hunuko, kono ko De tiiDDe neDDo. So wonki wuuraani, Bernde nyawan, hakkille layataa, miijo raBBiDan, ngaandi nyolan. »
Cette confession sous la forme d’un livre n’eût guère été possible si Bayla Koulibaly, analphabète jusqu’à l’âge adulte (et n’ayant jusque-là comme tout bagage culturel que quelques sourates du coran retenues à l’aveuglette), n’avait requis l’aide de l’association « JaNde e Pinal Pulaar » pour être scolarisé en pulaar. Partagé entre le travail exténuant, qui est le lot des immigrés, et les nombreuses sollicitations de sa communauté villageoise établie en France, Bayla Koulibaly n’en a pas mois poursuivi opiniâtrement son objectif de posséder l’écriture jusqu’à devenir enseignant de pulaar et écrivain : beau triomphe d’une praxis scripturaire, dont une scolarisation très tardive semblait radicalement s’opposer à la parturition ! Belle victoire sur le sort que cette détermination à aller toujours jusqu’aux limites de ses forces, devant des obstacles qui peuvent faire abdiquer plus d’un homme déterminé !
Plus que les aventures de Bayla Koulibaly, ce qui importe davantage dans Nguurdam Tumaranke, c’est donc et avant tout « l’aventure d’une écriture » (cf. Jean RICARDOU) qui a réussi à polir une statue de bronze à un homme obscur et déshérité que la vie avait tout fait payer au centuple .
Notes de lecture de Mohamadou Saidou TOURE (Thierno)
Paris, 11 mai 2005
*** *** ***
SECOND RECIT DE VIE :
NB : à propos de la problématique de l’écriture comme un « anti-destin » (André Malraux), je me permets de compléter mon compte rendu du livre de Bayla Koulibaly par une réflexion sur un autre récit de vie, L’âge d’homme de Michel Leiris, que je projetais d’étudier en classe.
Il s’agit d’une dissertation qui porte sur l’œuvre précitée, qui a été donnée en devoir, en décembre 2004, à des candidats à l’agrégation de Lettres modernes, à Paris. Traiter la dissertation exigeait de moi une lecture plus attentive de l’œuvre, étant donné mon projet pédagogique d’exploiter le roman de Michel LEIRIS en classe. Ayant sacrifié aux exigences académiques de l’exercice, je demande des excuses à mes honorables lecteurs si le style de ma dissertation s’en est trouvé « précieux ».
Sujet donné en devoir à des agrégatifs, à Paris, en 2004:
« L’âge d’homme est un regard lucide par lequel le JE, pénétrant son « obscurité intérieure », découvre que ce qui en lui regarde, ce n’est plus le JE, « structure du monde », mais déjà la statue monumentale, sans regard, sans figure et sans nom : le IL de la Mort souveraine. »
Maurice BLANCHOT.
I). INTRODUCTION :
L’entreprise autobiographique, qui fait coïncider dans une commune identité le sujet et l’objet de l’écriture, est placée sous le signe de la réflexivité. Pourtant, selon Blanchot, l’introspection, exposant le « je » de L’âge d’homme aux rets de son image spectrale et brouillée, lui signifie la vanité de l’entreprise autobiographique. Incapable d’accéder à la vérité de son moi profond, le « je », « structure du monde » submergée par la complexité torrentielle et contingente de l’existence, fait l’expérience tragique de l’aphasie.
Sans doute observe-t-on dans L’âge d’homme les balbutiements du « je » à se dire ; mais, il n’en explore pas mois d’autres stratégies, transcendantes et salutaires.
Comment L’âge d’homme, échappant à l’impasse tragique de se dire, conjure-t-il la contingence et la finitude du « je » assumant l’énonciation autobiographique ?
II). DEVELOPPEMENT :
A). 1ère.partie :
D’entrée de jeu, « l’ être-au-monde » (cf.HEIDEGGER) du « je » paraît placé sous le signe du danger, le cadre spatio-temporel dans lequel il se meut annihilant, dans un mouvement violent d’assimilation, toute velléité d’expression individuelle et personnelle de soi. Contenu dans un monde immense et infini qui le broie, le « je » apparaît comme un tentacule arrimé au TEMPS, qui l’entraîne inexorablement dans sa marche : « je demeure encastré dans ces Ages de la Vie et j’ai de moins en moins l’espoir d’échapper à leur cadre (au moins de par ma volonté), enchâssé que je suis dans leur boiserie rectangulaire, telle une mauvaise daguerréotypie couverte ça et là de taches de moisissure irisées sur les bords et pareilles aux teintes d’arc-en-ciel que la décomposition peint aux visages des noyés. » (page33)
« Noyé [e] et « encastré » [e] dans le Temps, l’individualité du « je » se dilue dans cet organisme macroscopique, dont les rouages essentiels lui échappent. Surgit, dès lors, immanquablement un écueil : comment le « je » peut-il dire son moi si celui-ci est englué fatalement dans une existence trouble, « sans figure », « sans nom » ?
L’aliénation du « je » au Temps est d’autant plus douloureuse, qu’elle se double d’une inféodation à l’ESPACE, cadre résolu également à ne le réduire qu’à un tentacule synecdochique insignifiant et sans autonomie : « sans être capable de trouver le mot de l’énigme, je notai du moins une coïncidence, impliquant un parallélisme entre deux séries de faits : ce qui se passait dans mon corps et les évènements extérieurs. » (page 38)
Par un effet de vases communicants, la tragédie inscrite au cœur de l’existence fait irruption, de manière transitive, dans l’intériorité du « je », qui se voit déboulonner et suppléer par « la statue monumentale » et « souveraine » de l’expérience tragique : « Ainsi va la vie : un jour ma femme à moi me regardera de ses yeux consternés ; je souffrirai d’un cancer ou bien je serai estropié. Rien à faire ! (…) car le sort n’est qu’un usurier ! » (page112)
Cette recatégorisation du sujet en objet, jouet de l’Histoire (qui lui dicte ses lois) est un coup dur asséné à l’autobiographe, qui se retrouve ainsi déboussolé face à son « obscurité intérieure » : « Me voici loin de ce que je proposais de raconter (…) A mesure que j’écris, le plan que je m’étais tracé m’échappe et l’on dirait que plus je regarde en moi-même, plus tout ce que je vois devient confus. » (page:127)
L’âge d’homme, « regard lucide » sur la tragédie de l’existence, signe donc, à certains égards, la défaite du SUJET.
Phrase de transition pour passer à l’antithèse:
En réalité, cette incapacité du « je » à saisir les « linéaments [de son être] qui s’avèrent permanents » (page 27) n’est pas rédhibitoire : il s’évertue à transformer le lien synecdochique qui le liait à l’expérience tragique du monde (dont il a conscience de n’être qu’une excroissance parasitaire) en une relation métonymique, qui est plus distanciée.
B). 2ème.partie :
Pour se ménager un espace de liberté, l’autobiographe tente, sinon de s’extraire, du moins de se défaire de l’emprise du « hic » (le « ici ») et du « nunc » (le « maintenant »), régis par Thanatos, « le il de la Mort souveraine ». Aussi, pour exorciser ses pulsions de mort, jette-t-il son dévolu sur le détour ou l’ailleurs : scénique, onirique, mythique etc.
Monde autonome, apte, par le procédé de mise en abyme, à représenter la tragédie de l’existence, le théâtre présente le double avantage de permettre à l’autobiographe, d’une part, de s’extirper souverainement de la gangue du tragique, réduit, en l’occurrence, à une matière scénique ; de lui permettre, d’autre part, d’apprivoiser ce tragique, grâce notamment à « l’illusion référentielle » (cf. Michael RIFFATERRE), qui suscite chez lui un pathos, qui est une expérience, plus ou moins directe, d’une mort vécue et, partant, démystifiée ; d’où la valeur conjuratoire et la portée transcendante du théâtre : « j’avais encore une notion si l’on veut magique du théâtre (…) noble entre tous, à cause du caractère de gravité tragique de ce qu’on y représentait. »
(p 45)
Pour polir sa statue et la protéger contre l’effritement de l’existence, l’autobiographe recourt aussi au rêve, lequel, contigu au monde sans être contenu dans son univers clos, débouche sur une combinatoire de tous les possibles, où l’énonciateur de l’autobiographie retrouve l’initiative, perdue, de la création.
Le rêve, vision ésotérique propre à susciter une religiosité épurée, telle une ascension dans « le monde intelligible » (PLATON), permet à l’autobiographe d’accéder à la quintessence des choses, loin de toute flétrissure de la contingence : « Derrière cette chaîne de montagnes, il y encore un désert, limité lui-même par une chaîne de montagnes masquant un troisième désert, et ainsi de suite. C’est l’ensemble de ces déserts limités qui constitue le vrai désert, le DESERT en soi. » (page135, extrait d’un récit de rêve)
C’est tout de même la démarche mythographique qui, dans la mise à distance comme dans la maîtrise des pulsions de mort, se taille la part de lion pour redorer le blason du « je », victime de son éviction de la sphère de la parole et qui ploie sous le faix de la contingence. Que ce soit sur le mode de l’assassinat (Judith) ou du suicide (Lucrèce) ou de la combinaison des deux (Cléopâtre), les personnages antiques cités incarnent des pulsions mortifères, dont la convocation sous la forme d’une réalité quintessenciée, le mythe, permet de palper métonymiquement la mort et de l’exorciser.
Récapitulatif de la thèse et de l’antithèse pour que le lecteur puisse se repérer
Si la mort, telle une « métaphore obsédante » (cf. Charles MAURON), innerve tout le texte leirisien et semble inhiber jusque l’énonciation autobiographique, en revanche, le « je », découronné de sa subjectivité par la « statue monumentale » de Thanatos, n’en explore pas moins une issue prométhéenne de secours, laquelle, le dotant d’une « volonté de puissance » (cf. NIETZSCHE), lui permet de s’évader dans l’ailleurs : le théâtre, le rêve et le mythe, procédés métonymiques de distanciation pour préserver l’intégrité individuelle du « je » et éclairer son miroir de soi .
Phrase de transition pour passer à la troisième partie:
Or, l’ailleurs et le détours, vains palliatifs, confrontent brutalement l’autobiographe à l’irréductibilité de la contingence, qu’il croyait pouvoir esquiver : « En tous points, je suis semblable au petit-bourgeois qui se donne l’illusion d’être Sardanapale en allant au bordel (…) Comment oserais-je me regarder si je ne portais pas, soit un masque, soit des lunettes déformantes? » (page153) ; d’où l’urgence de sortir des ces apories.
C). 3ème. Partie : Déduction et dépassement de la thèse et de l’antithèse
Il faudrait donc distinguer deux niveaux de référence : celui, incontournable et irréductible du monde (duquel LEIRIS, sujet mortel, ne peut échapper) et celui du livre, réceptacle de mots sublimes, où le « je » écrivant tisse et recompose un monde infini et atemporel.
Le détours et l’ailleurs, s’ils sont donc proscrits dans le monde réel (informé et ordonnancé par l’irréversibilité du tragique), ont, en revanche, toute leur place dans l’architecture interne du livre, taraudé par un souffle esthétique qui sillonne, spatialise et sculpte à sa guise L’âge d’homme, les divagations thématiques étant un alibi scripturaire où le « je » retrouve la plénitude de son moi par l’acte personnel de création littéraire : « les thèmes que j’avais cru primitivement distinguer se révèlent inconsistants et arbitraires, comme si ce classement n’était qu’une sorte de guide-âme abstrait, voire un simple procédé de composition esthétique. » (page127)
De cette fonction démiurgique du langage littéraire résulte une foi totale à la vérité du signe linguistique, antidote contre la dégénérescence du dire ; d’où le cratylisme, simulacre sémiologique dans le monde réel, mais lexicographie légitime dans la géographie du livre, qui est un espace de création : « Il s’enfonçait dans la poitrine un long kriss à lame (…)le mot « suicide » lui-même, dont j’associais la sonorité avec l’idée de l’incendie et la forme serpentine du kriss (…) Il y’a l’S dont la forme autant que le sifflement me rappelle, non seulement la torsion du corps près de tomber, mais la sinusoïdalité de la lame ; UI, qui vibre curieusement et s’insinue, si l’on peut dire, comme le fusement du feu (…) cide, qui intervient enfin pour tout conclure, avec son goût acide impliquant quelque chose d’incisif et d’aiguisé. » (page29).
Dans l’espace pérenne qu’est le livre, le cratylisme, loin d’être une opacification du langage, relève plutôt de l’ « imaginaire » le plus profond de l’autobiographe, de son idiolecte le plus intime, par lequel il « crée le monde à son image » (cf. La Bible, Genèse : I, 23), dans une épiphanie poétique où la confession assure sa propre pérennité : « la poésie avait remplacé pour moi le mysticisme (…) je pensais que par l’usage lyrique des mots, l’homme a le pouvoir de tout transmuer. J’accordais une importance prépondérante à l’imaginaire, substitut du réel et du monde qu’il nous est loisible de créer (…) Je croyais qu’au moyen des mots il est possible de détecter les idées et que l’on peut ainsi, de choc verbal inattendu en choc verbal inattendu, cerner l’absolu de proche en proche et finalement, à force de déclencher dans tous les sens des idées neuves, le posséder. » (pages181-182)
III). Conclusion :
Lié au monde par une relation synecdochique, le « je » subit transitivement la contingence et la fragilité qui y sont à l’œuvre. Affecté d’aphonie par son éviction de la sphère du dire, où il est anéanti par la « statue monumentale » de Thanatos, le « je » n’en conjure pas moins sa hantise de la mort par l’évasion à travers un ailleurs scénique, onirique et mythique.
Prenant conscience de l’inanité du subterfuge de l’ailleurs, l’énonciateur de l’autobiographie, mû par un élan prométhéen de dompter et de maîtriser la fragilité du monde, affronte frontalement le « ici » et le « maintenant » dans l’espace fortifié et pérenne du chef-d’œuvre littéraire où le verbe, incantatoire, atteint à l’Absolu et sa voix intime à une confession universelle.
La hantise de la mort qui inhibe le « je » n’est donc, dans L’âge d’homme, que le « moment faible d’une progression dialectique » dont l’étape ultime élève l’autobiographie à un « anti-destin » (Malraux).
Mohamadou Saidou TOURE (Thierno)
Paris, dissertation rédigée en décembre 2004.
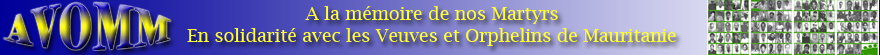
 Actualités
Actualités



















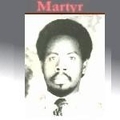
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)