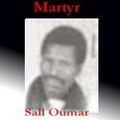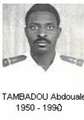photo cridem
Le 6 août 2008, le président Sidi ould Cheikh Abdallahi, qui avait été élu en mars 2007 lors d’un scrutin libre, a été déposé par les militaires. Médiateur au plus fort de la crise d’août 2008 entre le général Abdul Aziz et le président Abdallahi, Messaoud ould Boulkheir décrypte, dans une interview accordée à MFI, les vraies raisons de la suspension du processus démocratique par les militaires.
MFI : Comment s’est nouée la crise parlementaire qui a conduit à la situation actuelle ?
Messaoud ould Boulkheir : Ce n’est pas au niveau du Parlement que s’est nouée la situation. Certains parlementaires, de connivence avec le général Abdul Aziz, ont accepté de servir de faire-valoir à un coup d’Etat militaire, mais la situation qui prévalait juste avant n’était pas conflictuelle au point d’aboutir nécessairement au départ du Président. Il n’a jamais été question, même au plus fort de la crise autour de la motion de censure, de remettre en cause l’autorité du président Sidi ould Cheikh Abdallahi. Tout au plus ces parlementaires mettaient-ils en avant qu’il avait fait appel à des ministres de l’ancien régime qu’ils considéraient souillés par les pratiques anciennes et qu’ils contestaient. Mais ils n’ont jamais contesté la légitimité du président.
MFI : De quoi s’agissait-il alors ?
M. o. B. : La vérité, c’est que le général a des ambitions. Il avait déjà des ambitions au moment du coup d’Etat du 3 août 2005. Il n’est pas allé – il a hésité ou il n’a pas pu aller – jusqu’au bout de sa logique. A l’époque, il avait fait appel à un officier plus gradé que lui, et plus au fait des affaires de l’Etat vu le temps passé aux côtés du président déchu Maaouiya ould Sid’Ahmed Taya. Depuis lors, son ambition n’a cessé de grandir, et il a dû forcer le président de la junte, Ely ould Mohamed Vall, à appliquer ce sur quoi ils s’étaient entendus, à savoir partir au bout des dix-huit mois.
MFI : C’était tout à son honneur…
M. o. B. : Il l’a fait simplement parce qu’il ne voulait pas de concurrent. Et surtout, parce qu’il ne voulait pas avoir à renverser un militaire qu’il avait lui-même placé là ! Dès l’instant où le président civil a été élu, il n’a eu de cesse de le déstabiliser. Par le biais, pensait-il, des parlementaires. Mais puisqu’il n’existait aucune disposition constitutionnelle ou légale permettant au Parlement – nous sommes sous régime présidentiel – d’aboutir au départ d’un président élu au suffrage universel pour cinq ans, ce qu’il voulait organiser en définitive, et cela de l’aveu même de certains putschistes ou de parlementaires, c’était une émeute. Une soi-disant prise de force du Palais présidentiel au cours de laquelle la Garde présidentielle, composée d’éléments que commande le général, allait lui donner l’occasion d’intervenir pour dire : « La situation devient intenable, le président n’est plus ceci ou cela... » C’est ce qu’il préparait. Et quand le président en a eu la certitude, il l’a limogé ainsi que ses compagnons.
MFI : N’était-ce pas une erreur ?
M. o. B. : Non, c’est ce qui l’a sauvé. De toute façon, on préparait un autre scénario où on allait dire que la vie du président était en danger ou que la population le rejetait, donnant ainsi un fond de légitimité populaire à son départ. Quand le président a senti cela, il a procédé au limogeage. Et puisque le général voulait le pouvoir à tout prix, lui et ses amis l’ont renversé.
MFI : La crise ne s’est donc pas jouée sur un débat ou un autre au sein de l’Assemblée ?
M. o. B. : Pas du tout. Le conflit, je vous l’ai dit, résidait dans le fait qu’on voulait faire signer une motion de censure pour récuser un gouvernement nouvellement désigné, au prétexte que certains de ses membres avaient servi avec ould Taya. Personnellement, j’ai fait le facilitateur entre le général et le président parce qu’il n’était un secret pour personne que certains députés étaient manipulés par le général. C’est lui qui les poussait à déposer la motion de censure. Lors de nos discussions pendant le conflit, il a mis en avant ces quelques membres du gouvernement qu’il ne voulait pas accepter ; et également les rapports conflictuels – peut-être de cohabitation – qu’il entretenait avec le président ou la famille du président. Mais il n’est pas le fils de la maison ! J’essayais de lui expliquer que son ingérence dans la vie politique, constitutionnelle, n’était pas fondée. Qu’il n’avait aucun droit de le faire. Que le fait de pousser les députés à déposer une motion de censure équivalait pratiquement à une rébellion, à une incitation à la révolte, qu’il devait y renoncer. Quant à ses rapports conflictuels avec la famille, je m’apprêtais à en parler au président, à sa famille… Mais rien n’arrivait à le détourner de son objectif, qui était très clair : il voulait se substituer au président.
MFI : Donc, il n’y avait rien d’autre que quelqu’un qui tirait les manettes en sous-main dans le but de se substituer au président.
M. o. B. : C’est tout. J’ai oublié un détail important. Le général me disait qu’il ne voulait même pas que la motion soit votée – alors qu’il incitait les autres à la déposer ! –, qu’il préférait que le président se dédise directement. J’ai conseillé au président de ne pas le faire… Mais la pression du général a été plus forte : la motion n’a jamais été déposée et le président est finalement revenu sur ses nominations. Il a limogé son dernier gouvernement – qui n’avait d’ailleurs pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque dès l’instant où il avait été nommé, les problèmes avaient commencé. Donc, à aucun moment la légitimité du président n’a été mise en doute ni par les députés ni par le général – à ce qu’il laissait entendre en me disant : « Nous ne ferons pas de coup d’Etat et nous ne laisserons personne faire de coup d’Etat. Il n’en est pas question. Mais ces membres-là, on n’en veut pas… » Les constructions qui sont venues par la suite, quant au blocage des institutions, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas cela le fond du problème.
MFI : Pour justifier le coup d’Etat, certains ont affirmé que le bilan du président Sidi était négatif. Qu’en pensez-vous ?
Messaoud ould Boulkheir : Son bilan est loin d’être négatif tant sur le plan démocratique que sur le plan politique. Jamais les libertés n’ont été jouées aussi pleinement que dans la période où il a présidé aux destinées du pays. Jamais les médias n’ont été aussi ouverts à tous, majorité comme opposition. Jamais les débats n’ont été aussi contradictoires, sans tabous. Jamais les institutions parlementaires n’ont fonctionné ainsi, en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Jamais l’opposition n’a eu tel rang d’institution, une institution constitutionnelle reconnue par l’Etat. Le chef de file de l’opposition était la quatrième personnalité de l’Etat, exactement après moi, président de l’Assemblée, qui vient après le président du Sénat et après le président de la République.
MFI : Et sur le plan politique ?
M. o. B. : Le président Sidi a pu, grâce à son esprit d’ouverture et son sens du devoir, mettre au devant les problèmes structurels ou conjoncturels du pays. Pour la première fois, on a fait voter une loi incriminant l’esclavage alors que tous les régimes précédents l’avaient nié. Il a accepté le retour des déportés après les événements de 1989, ainsi que le principe du dédommagement et du désintéressement des victimes et de leurs ayant-droits. Ce sont des problèmes majeurs et il fallait du courage et de la conviction politiques, du patriotisme pour oser les approcher. En termes économiques, nous étions en progression malgré la mauvaise conjoncture dont on ne pouvait pas rendre responsable un président après seulement un an et demi d’exercice.
MFI : Cette ingérence militaire dans le processus démocratique signifie-t-elle que la Mauritanie reste une « démocratie militaire » ?
M. o. B. : Mais c’est justement ce qu’on essaye d’éviter ! Lorsque les militaires ont fait leur coup d’Etat avec le général Abdul Aziz en 2005, ils s’étaient eux-mêmes engagés à rentrer dans leurs casernes. Devant l’Union européenne, ils ont pris l’engagement ferme qu’après des élections libres et transparentes, ils ne s’ingéreraient plus dans la vie politique. Nous, démocrates, nous ne pouvons pas exercer cette liberté que nous réclamons sous une tutelle de quelque nature qu’elle soit, militaire ou extramilitaire. Nous voulons que le jeu politique se fasse avec les partis et entités politiques. Et si, face à cette situation, nous exigeons le retour à l’ordre politique constitutionnel, notamment par le retour du président de la République légalement élu, c’est bien pour montrer qu’en aucun cas nous ne voulons composer avec les militaires comme acteurs politiques. Ni dans le présent ni dans le futur.
MFI : Un gouvernement civil peut-il se défendre contre la force des armes ?
M. o. B. : Les militaires, les armes… S’ils veulent les utiliser contre la population, la décimer…
MFI : Ce n’est pas le cas ?
M. o. B. : Ah, je ne sais pas ! Ils ont cette force-là. S’ils veulent se présenter en sauveurs, ils doivent savoir que le pays se construit autrement que par l’armée. Les militaires, cela fait trente ans qu’ils nous régentent. Toutes les situations que nous vivons sont la conséquence de leurs politiques. Nous ne leurs connaissons aucune qualité ni de gestion ni de probité ni de droiture. Absolument rien qui fasse que nous devrions composer avec eux. Ceux qui veulent faire de la politique n’ont qu’à quitter l’armée. Nous voulons que le pays soit livré à la population et qu’elle en fasse ce qu’elle veut à travers les voies démocratiques qu’elle s’est fixées.
MFI : En tant que président de l’Assemblée nationale, vous sentez-vous le garant de la démocratie ?
M. o. B. : Le garant du respect de la constitution, en principe, c’est le président de la République. Moi, je préside une institution qui malheureusement a été dévoyée par les militaires. La grande majorité des députés qui les soutiennent – au moins une cinquantaine – sont des Indépendants qui n’appartiennent à aucune formation politique. C’est sur eux que les militaires s’appuient pour chercher une légalité à ce qu’ils font. Mais un député putschiste qui viole délibérément la constitution sur la base de laquelle il a été élu ne peut se prévaloir, de mon point de vue, d’aucune légitimité. Si le Parlement est resté en l’état sans être dissous ou mis de côté par les putschistes, c’est bien qu’ils comptent sur ces gens-là. Ils ont besoin d’un fond de soi-disant légalité.
MFI : Mais alors vous, vous acceptez de jouer ce rôle-là ?
M. o. B. : Moi, je suis fort dans ma position. Je suis minoritaire, certainement. Nous sommes à peu près le tiers des députés à avoir rejeté ce coup d’Etat et à avoir déclaré nul et non avenu tout ce qui se passe sous ce régime que nous ne reconnaissons pas. Mais puisqu’ils ont pris sur eux de ne pas dissoudre l’Assemblée, nous faisons comme nous pouvons. Et ceci d’autant plus qu’ils ne se sont pas contentés de mettre l’Assemblée entre parenthèse. Ils se sont arrogés, à travers leur Charte constitutionnelle, comme ils l’appellent, un droit de législateur. Nous sommes là pour amuser la galerie.
MFI : Certains ont avancé que Sidi était un candidat des militaires – pour contrer les politiques dont vous-même, d’ailleurs.
M. o. B. : Peut-être. Je dirais que Sidi a été un candidat que les militaires ont soutenu mais il n’est pas le seul candidat à l’avoir été en tout ou partie de cette façon. En fait, en 2007, les militaires se sont partagés entre deux candidats : le leader de l’opposition actuelle – ou passée, je ne sais pas –, Ahmed ould Daddah, et Abdallahi. Mais si les militaires ont réussi à les faire parvenir au deuxième tour, aucun d’eux n’a obtenu 25 % de l’électorat. Du coup, beaucoup d’autres Mauritaniens, sans être aux ordres des militaires, ont soutenu l’un ou l’autre au deuxième tour. Ce fut le cas de mon parti avec Sidi, après avoir été moi-même candidat au premier tour*.
Propos recueillis en novembre 2008 par Antoinette Delafin
via flamnet.net
MFI : Comment s’est nouée la crise parlementaire qui a conduit à la situation actuelle ?
Messaoud ould Boulkheir : Ce n’est pas au niveau du Parlement que s’est nouée la situation. Certains parlementaires, de connivence avec le général Abdul Aziz, ont accepté de servir de faire-valoir à un coup d’Etat militaire, mais la situation qui prévalait juste avant n’était pas conflictuelle au point d’aboutir nécessairement au départ du Président. Il n’a jamais été question, même au plus fort de la crise autour de la motion de censure, de remettre en cause l’autorité du président Sidi ould Cheikh Abdallahi. Tout au plus ces parlementaires mettaient-ils en avant qu’il avait fait appel à des ministres de l’ancien régime qu’ils considéraient souillés par les pratiques anciennes et qu’ils contestaient. Mais ils n’ont jamais contesté la légitimité du président.
MFI : De quoi s’agissait-il alors ?
M. o. B. : La vérité, c’est que le général a des ambitions. Il avait déjà des ambitions au moment du coup d’Etat du 3 août 2005. Il n’est pas allé – il a hésité ou il n’a pas pu aller – jusqu’au bout de sa logique. A l’époque, il avait fait appel à un officier plus gradé que lui, et plus au fait des affaires de l’Etat vu le temps passé aux côtés du président déchu Maaouiya ould Sid’Ahmed Taya. Depuis lors, son ambition n’a cessé de grandir, et il a dû forcer le président de la junte, Ely ould Mohamed Vall, à appliquer ce sur quoi ils s’étaient entendus, à savoir partir au bout des dix-huit mois.
MFI : C’était tout à son honneur…
M. o. B. : Il l’a fait simplement parce qu’il ne voulait pas de concurrent. Et surtout, parce qu’il ne voulait pas avoir à renverser un militaire qu’il avait lui-même placé là ! Dès l’instant où le président civil a été élu, il n’a eu de cesse de le déstabiliser. Par le biais, pensait-il, des parlementaires. Mais puisqu’il n’existait aucune disposition constitutionnelle ou légale permettant au Parlement – nous sommes sous régime présidentiel – d’aboutir au départ d’un président élu au suffrage universel pour cinq ans, ce qu’il voulait organiser en définitive, et cela de l’aveu même de certains putschistes ou de parlementaires, c’était une émeute. Une soi-disant prise de force du Palais présidentiel au cours de laquelle la Garde présidentielle, composée d’éléments que commande le général, allait lui donner l’occasion d’intervenir pour dire : « La situation devient intenable, le président n’est plus ceci ou cela... » C’est ce qu’il préparait. Et quand le président en a eu la certitude, il l’a limogé ainsi que ses compagnons.
MFI : N’était-ce pas une erreur ?
M. o. B. : Non, c’est ce qui l’a sauvé. De toute façon, on préparait un autre scénario où on allait dire que la vie du président était en danger ou que la population le rejetait, donnant ainsi un fond de légitimité populaire à son départ. Quand le président a senti cela, il a procédé au limogeage. Et puisque le général voulait le pouvoir à tout prix, lui et ses amis l’ont renversé.
MFI : La crise ne s’est donc pas jouée sur un débat ou un autre au sein de l’Assemblée ?
M. o. B. : Pas du tout. Le conflit, je vous l’ai dit, résidait dans le fait qu’on voulait faire signer une motion de censure pour récuser un gouvernement nouvellement désigné, au prétexte que certains de ses membres avaient servi avec ould Taya. Personnellement, j’ai fait le facilitateur entre le général et le président parce qu’il n’était un secret pour personne que certains députés étaient manipulés par le général. C’est lui qui les poussait à déposer la motion de censure. Lors de nos discussions pendant le conflit, il a mis en avant ces quelques membres du gouvernement qu’il ne voulait pas accepter ; et également les rapports conflictuels – peut-être de cohabitation – qu’il entretenait avec le président ou la famille du président. Mais il n’est pas le fils de la maison ! J’essayais de lui expliquer que son ingérence dans la vie politique, constitutionnelle, n’était pas fondée. Qu’il n’avait aucun droit de le faire. Que le fait de pousser les députés à déposer une motion de censure équivalait pratiquement à une rébellion, à une incitation à la révolte, qu’il devait y renoncer. Quant à ses rapports conflictuels avec la famille, je m’apprêtais à en parler au président, à sa famille… Mais rien n’arrivait à le détourner de son objectif, qui était très clair : il voulait se substituer au président.
MFI : Donc, il n’y avait rien d’autre que quelqu’un qui tirait les manettes en sous-main dans le but de se substituer au président.
M. o. B. : C’est tout. J’ai oublié un détail important. Le général me disait qu’il ne voulait même pas que la motion soit votée – alors qu’il incitait les autres à la déposer ! –, qu’il préférait que le président se dédise directement. J’ai conseillé au président de ne pas le faire… Mais la pression du général a été plus forte : la motion n’a jamais été déposée et le président est finalement revenu sur ses nominations. Il a limogé son dernier gouvernement – qui n’avait d’ailleurs pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque dès l’instant où il avait été nommé, les problèmes avaient commencé. Donc, à aucun moment la légitimité du président n’a été mise en doute ni par les députés ni par le général – à ce qu’il laissait entendre en me disant : « Nous ne ferons pas de coup d’Etat et nous ne laisserons personne faire de coup d’Etat. Il n’en est pas question. Mais ces membres-là, on n’en veut pas… » Les constructions qui sont venues par la suite, quant au blocage des institutions, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas cela le fond du problème.
MFI : Pour justifier le coup d’Etat, certains ont affirmé que le bilan du président Sidi était négatif. Qu’en pensez-vous ?
Messaoud ould Boulkheir : Son bilan est loin d’être négatif tant sur le plan démocratique que sur le plan politique. Jamais les libertés n’ont été jouées aussi pleinement que dans la période où il a présidé aux destinées du pays. Jamais les médias n’ont été aussi ouverts à tous, majorité comme opposition. Jamais les débats n’ont été aussi contradictoires, sans tabous. Jamais les institutions parlementaires n’ont fonctionné ainsi, en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Jamais l’opposition n’a eu tel rang d’institution, une institution constitutionnelle reconnue par l’Etat. Le chef de file de l’opposition était la quatrième personnalité de l’Etat, exactement après moi, président de l’Assemblée, qui vient après le président du Sénat et après le président de la République.
MFI : Et sur le plan politique ?
M. o. B. : Le président Sidi a pu, grâce à son esprit d’ouverture et son sens du devoir, mettre au devant les problèmes structurels ou conjoncturels du pays. Pour la première fois, on a fait voter une loi incriminant l’esclavage alors que tous les régimes précédents l’avaient nié. Il a accepté le retour des déportés après les événements de 1989, ainsi que le principe du dédommagement et du désintéressement des victimes et de leurs ayant-droits. Ce sont des problèmes majeurs et il fallait du courage et de la conviction politiques, du patriotisme pour oser les approcher. En termes économiques, nous étions en progression malgré la mauvaise conjoncture dont on ne pouvait pas rendre responsable un président après seulement un an et demi d’exercice.
MFI : Cette ingérence militaire dans le processus démocratique signifie-t-elle que la Mauritanie reste une « démocratie militaire » ?
M. o. B. : Mais c’est justement ce qu’on essaye d’éviter ! Lorsque les militaires ont fait leur coup d’Etat avec le général Abdul Aziz en 2005, ils s’étaient eux-mêmes engagés à rentrer dans leurs casernes. Devant l’Union européenne, ils ont pris l’engagement ferme qu’après des élections libres et transparentes, ils ne s’ingéreraient plus dans la vie politique. Nous, démocrates, nous ne pouvons pas exercer cette liberté que nous réclamons sous une tutelle de quelque nature qu’elle soit, militaire ou extramilitaire. Nous voulons que le jeu politique se fasse avec les partis et entités politiques. Et si, face à cette situation, nous exigeons le retour à l’ordre politique constitutionnel, notamment par le retour du président de la République légalement élu, c’est bien pour montrer qu’en aucun cas nous ne voulons composer avec les militaires comme acteurs politiques. Ni dans le présent ni dans le futur.
MFI : Un gouvernement civil peut-il se défendre contre la force des armes ?
M. o. B. : Les militaires, les armes… S’ils veulent les utiliser contre la population, la décimer…
MFI : Ce n’est pas le cas ?
M. o. B. : Ah, je ne sais pas ! Ils ont cette force-là. S’ils veulent se présenter en sauveurs, ils doivent savoir que le pays se construit autrement que par l’armée. Les militaires, cela fait trente ans qu’ils nous régentent. Toutes les situations que nous vivons sont la conséquence de leurs politiques. Nous ne leurs connaissons aucune qualité ni de gestion ni de probité ni de droiture. Absolument rien qui fasse que nous devrions composer avec eux. Ceux qui veulent faire de la politique n’ont qu’à quitter l’armée. Nous voulons que le pays soit livré à la population et qu’elle en fasse ce qu’elle veut à travers les voies démocratiques qu’elle s’est fixées.
MFI : En tant que président de l’Assemblée nationale, vous sentez-vous le garant de la démocratie ?
M. o. B. : Le garant du respect de la constitution, en principe, c’est le président de la République. Moi, je préside une institution qui malheureusement a été dévoyée par les militaires. La grande majorité des députés qui les soutiennent – au moins une cinquantaine – sont des Indépendants qui n’appartiennent à aucune formation politique. C’est sur eux que les militaires s’appuient pour chercher une légalité à ce qu’ils font. Mais un député putschiste qui viole délibérément la constitution sur la base de laquelle il a été élu ne peut se prévaloir, de mon point de vue, d’aucune légitimité. Si le Parlement est resté en l’état sans être dissous ou mis de côté par les putschistes, c’est bien qu’ils comptent sur ces gens-là. Ils ont besoin d’un fond de soi-disant légalité.
MFI : Mais alors vous, vous acceptez de jouer ce rôle-là ?
M. o. B. : Moi, je suis fort dans ma position. Je suis minoritaire, certainement. Nous sommes à peu près le tiers des députés à avoir rejeté ce coup d’Etat et à avoir déclaré nul et non avenu tout ce qui se passe sous ce régime que nous ne reconnaissons pas. Mais puisqu’ils ont pris sur eux de ne pas dissoudre l’Assemblée, nous faisons comme nous pouvons. Et ceci d’autant plus qu’ils ne se sont pas contentés de mettre l’Assemblée entre parenthèse. Ils se sont arrogés, à travers leur Charte constitutionnelle, comme ils l’appellent, un droit de législateur. Nous sommes là pour amuser la galerie.
MFI : Certains ont avancé que Sidi était un candidat des militaires – pour contrer les politiques dont vous-même, d’ailleurs.
M. o. B. : Peut-être. Je dirais que Sidi a été un candidat que les militaires ont soutenu mais il n’est pas le seul candidat à l’avoir été en tout ou partie de cette façon. En fait, en 2007, les militaires se sont partagés entre deux candidats : le leader de l’opposition actuelle – ou passée, je ne sais pas –, Ahmed ould Daddah, et Abdallahi. Mais si les militaires ont réussi à les faire parvenir au deuxième tour, aucun d’eux n’a obtenu 25 % de l’électorat. Du coup, beaucoup d’autres Mauritaniens, sans être aux ordres des militaires, ont soutenu l’un ou l’autre au deuxième tour. Ce fut le cas de mon parti avec Sidi, après avoir été moi-même candidat au premier tour*.
Propos recueillis en novembre 2008 par Antoinette Delafin
via flamnet.net
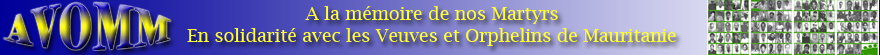
 Actualités
Actualités



















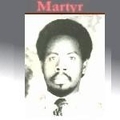
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)