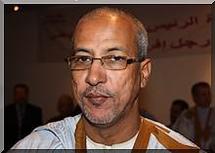
«Je ne regrette pas ma vie si ma mort peut être utile à la Mauritanie», c’est, allant aux poteaux d’exécution, ce qu’écrivait le lieutenant-colonel Ahmed Salem Ould Sidi dans une lettre publiée et republiée et dont le contenu est aujourd’hui connu comme le testament de ce grand officier. Tous les mauritaniens qui lisent connaissent et apprécient cette phrase d’un condamné.
Mais qui connaît les derniers mots de Sarr Amadou devant la Cour Spéciale de Justice qui devait le condamner à mort en octobre 1987 ? «Si ma tête devait servir l’unité du pays, coupez-la. Si ma personne peut encore servir la Mauritanie, épargnez-la».
L’un et l’autre des propos réhabilitent le combat des deux officiers et de leurs compagnons. Et quoi que nous soyons pour ou contre la justesse de ces combats, il restera toujours l’exigence de vérité pour le peuple mauritanien.
J’ai été à Kaédi. Je fais partie de ces mauritaniens – nombreux heureusement, peu mis en avant malheureusement – qui ont dénoncé en son temps exactions et répressions. Ciblées ou pas. Des Mauritaniens – toutes origines confondues – se sont élevés en 1989, 1990 et années suivantes pour dire non aux choix absurdes de l’époque.
Les actes honteux et malheureux n’étaient pas faits au nom du peuple mauritanien. Ils n’étaient pas approuvés par ce peuple. Et si les manipulations de l’époque sous-entendaient l’engagement d’une communauté derrière les maîtres du moment, il n’en était rien. Peu de gens d’ailleurs savaient exactement la réalité des événements.
C’est là où se situe le devoir de vérité. Le peuple mauritanien – toutes composantes confondues – a le droit de savoir. Il doit savoir. A ceux qui disent «illi laahi yirdim maa yejhar» (celui qui veut enterrer ne déterre pas), nous disons que seule une catharsis collective peut guérir nos plaies ouvertes.
Ouvertes tant que nous n’avons décidé de les refermer sérieusement. Cela commence par des gestes forts, comme la retrouvaille de Kaédi. Mais cela passe nécessairement par :
L’ouverture d’un débat national sur les atteintes aux droits de l’Homme : causes et manifestations. Donner la parole aux survivants des geôles, aux victimes des répressions, aux témoins des exactions commises sous les régimes du passé. Mettre en exergue le rôle de la dénonciation sur le moment pour faire la démonstration que la répression n’a jamais fait l’objet d’un engagement populaire.
Agir dans le sens de la dépolitisation de la question. Dépassionner les rapports. Et surtout amener les organisations de droits de l’Homme à reprendre leur vraie vocation qui est justement celle de défendre l’intégrité de l’Homme mauritanien, et non continuer à être une excroissance des formations politiques.
Faire du moment un point de départ de convergence sociale en amenant tous les acteurs à adopter une attitude qui va dans le sens de la justice et de la vérité et non de l’exploitation politicienne.
En 1992, je faisais partie d’un groupe de journalistes – en fait trois : Bah Ould Saleck de Mauritanie-Nouvelles, Sy Tijane de L’Eveil Hebdo et moi pour Al Bayane – qui étaient allés sur les lieux de l’un des crimes commis à l’époque : Sory Malé.
«Sory Malé : La terre accuse», le titre d’un dossier de presse qui tentait de faire la lumière sur une partie – une partie seulement – des atrocités commises en ces années sombres de dictature.
17 ans après, nous avons toujours besoin de savoir ce qui s’est passé. Pas pour faire le procès du passé, mais pour déterminer les origines de la dérive et ses manifestations.
Le processus lancé à Kaédi doit nécessairement aboutir à placer la Mauritanie dans la perspective du dépassement définitif de ce passé macabre.
Source: latribune via CRIDEM
Mais qui connaît les derniers mots de Sarr Amadou devant la Cour Spéciale de Justice qui devait le condamner à mort en octobre 1987 ? «Si ma tête devait servir l’unité du pays, coupez-la. Si ma personne peut encore servir la Mauritanie, épargnez-la».
L’un et l’autre des propos réhabilitent le combat des deux officiers et de leurs compagnons. Et quoi que nous soyons pour ou contre la justesse de ces combats, il restera toujours l’exigence de vérité pour le peuple mauritanien.
J’ai été à Kaédi. Je fais partie de ces mauritaniens – nombreux heureusement, peu mis en avant malheureusement – qui ont dénoncé en son temps exactions et répressions. Ciblées ou pas. Des Mauritaniens – toutes origines confondues – se sont élevés en 1989, 1990 et années suivantes pour dire non aux choix absurdes de l’époque.
Les actes honteux et malheureux n’étaient pas faits au nom du peuple mauritanien. Ils n’étaient pas approuvés par ce peuple. Et si les manipulations de l’époque sous-entendaient l’engagement d’une communauté derrière les maîtres du moment, il n’en était rien. Peu de gens d’ailleurs savaient exactement la réalité des événements.
C’est là où se situe le devoir de vérité. Le peuple mauritanien – toutes composantes confondues – a le droit de savoir. Il doit savoir. A ceux qui disent «illi laahi yirdim maa yejhar» (celui qui veut enterrer ne déterre pas), nous disons que seule une catharsis collective peut guérir nos plaies ouvertes.
Ouvertes tant que nous n’avons décidé de les refermer sérieusement. Cela commence par des gestes forts, comme la retrouvaille de Kaédi. Mais cela passe nécessairement par :
L’ouverture d’un débat national sur les atteintes aux droits de l’Homme : causes et manifestations. Donner la parole aux survivants des geôles, aux victimes des répressions, aux témoins des exactions commises sous les régimes du passé. Mettre en exergue le rôle de la dénonciation sur le moment pour faire la démonstration que la répression n’a jamais fait l’objet d’un engagement populaire.
Agir dans le sens de la dépolitisation de la question. Dépassionner les rapports. Et surtout amener les organisations de droits de l’Homme à reprendre leur vraie vocation qui est justement celle de défendre l’intégrité de l’Homme mauritanien, et non continuer à être une excroissance des formations politiques.
Faire du moment un point de départ de convergence sociale en amenant tous les acteurs à adopter une attitude qui va dans le sens de la justice et de la vérité et non de l’exploitation politicienne.
En 1992, je faisais partie d’un groupe de journalistes – en fait trois : Bah Ould Saleck de Mauritanie-Nouvelles, Sy Tijane de L’Eveil Hebdo et moi pour Al Bayane – qui étaient allés sur les lieux de l’un des crimes commis à l’époque : Sory Malé.
«Sory Malé : La terre accuse», le titre d’un dossier de presse qui tentait de faire la lumière sur une partie – une partie seulement – des atrocités commises en ces années sombres de dictature.
17 ans après, nous avons toujours besoin de savoir ce qui s’est passé. Pas pour faire le procès du passé, mais pour déterminer les origines de la dérive et ses manifestations.
Le processus lancé à Kaédi doit nécessairement aboutir à placer la Mauritanie dans la perspective du dépassement définitif de ce passé macabre.
Source: latribune via CRIDEM

 Actualités
Actualités




















![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



